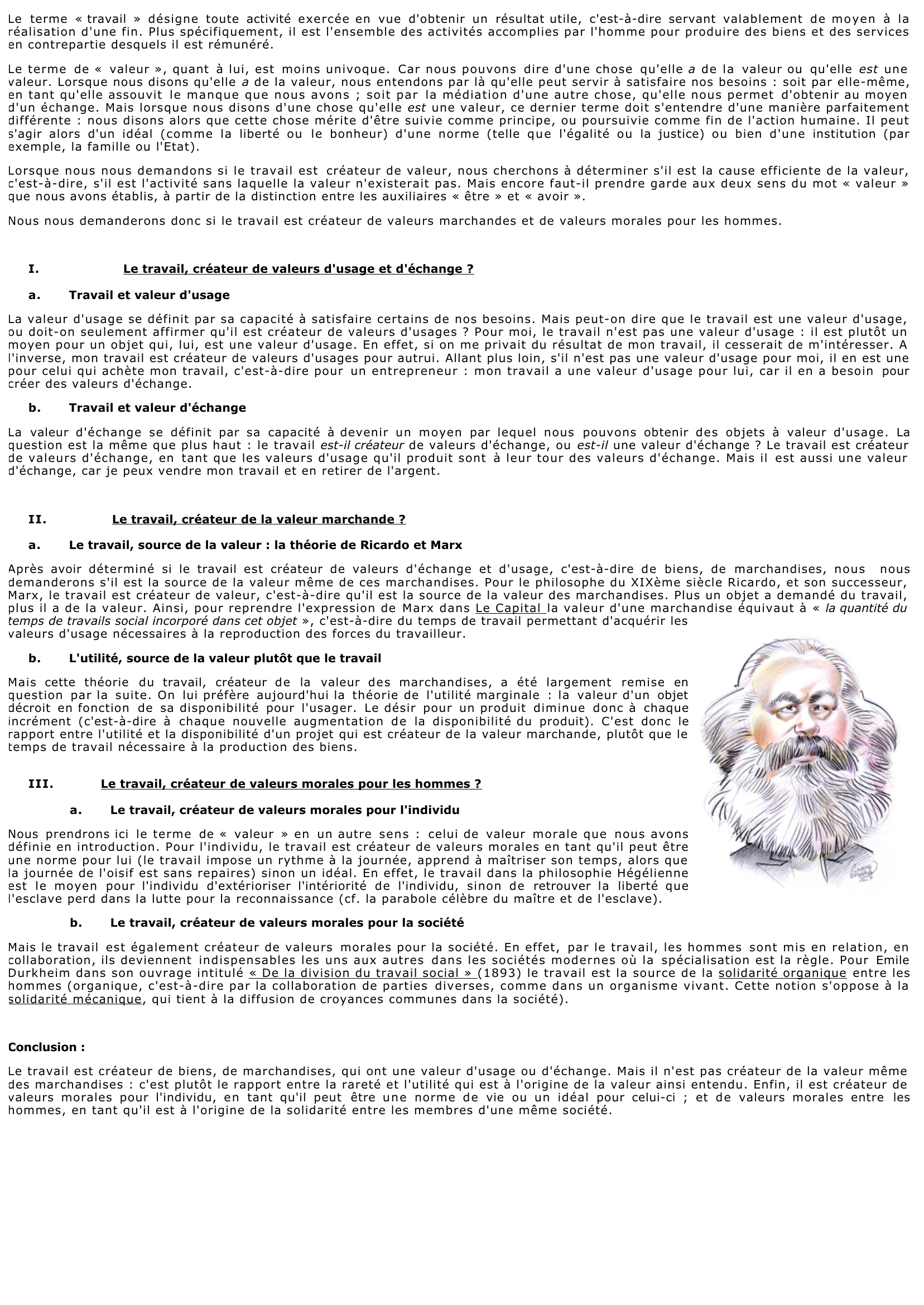Le travail est il créateur de valeur ?
Extrait du document
«
Le terme « travail » désigne toute activité exercée en vue d'obtenir un résultat utile, c'est-à-dire servant valablement d e m o y e n à la
réalisation d'une fin.
Plus spécifiquement, il est l'ensemble des activités accomplies par l'homme pour produire des biens et des services
en contrepartie desquels il est rémunéré.
Le terme de « valeur », quant à lui, est moins univoque.
Car nous pouvons dire d'une chose qu'elle a de la valeur ou qu'elle est une
valeur.
Lorsque nous disons qu'elle a de la valeur, nous entendons par là qu'elle peut servir à satisfaire nos besoins : soit par elle-même,
en tant qu'elle assouvit le manque que nous avons ; soit par la médiation d'une autre chose, qu'elle nous permet d'obtenir au moyen
d'un échange.
Mais lorsque nous disons d'une chose qu'elle est une valeur, ce dernier terme doit s'entendre d'une manière parfaitement
différente : nous disons alors que cette chose mérite d'être suivie comme principe, ou poursuivie comme fin de l'action humaine.
Il peut
s'agir alors d'un idéal (comme la liberté ou le bonheur) d'une norme (telle q u e l'égalité ou la justice) ou bien d'une institution (par
exemple, la famille ou l'Etat).
Lorsque nous nous demandons si le travail est créateur de valeur, nous cherchons à déterminer s'il est la cause efficiente de la valeur,
c'est-à-dire, s'il est l'activité sans laquelle la valeur n'existerait pas.
Mais encore faut-il prendre garde aux deux sens du mot « valeur »
que nous avons établis, à partir de la distinction entre les auxiliaires « être » et « avoir ».
Nous nous demanderons donc si le travail est créateur de valeurs marchandes et de valeurs morales pour les hommes.
I.
a.
Le travail, créateur de valeurs d'usage et d'échange ?
Travail et valeur d'usage
La valeur d'usage se définit par sa capacité à satisfaire certains de nos besoins.
Mais peut-on dire que le travail est une valeur d'usage,
ou doit-on seulement affirmer qu'il est créateur de valeurs d'usages ? Pour moi, le travail n'est pas une valeur d'usage : il est plutôt un
moyen pour un objet qui, lui, est une valeur d'usage.
En effet, si on me privait du résultat de mon travail, il cesserait de m'intéresser.
A
l'inverse, mon travail est créateur de valeurs d'usages pour autrui.
Allant plus loin, s'il n'est pas une valeur d'usage pour moi, il en est une
pour celui qui achète mon travail, c'est-à-dire pour un entrepreneur : mon travail a une valeur d'usage pour lui, car il en a besoin pour
créer des valeurs d'échange.
b.
Travail et valeur d'échange
La valeur d'échange se définit par sa capacité à devenir un moyen par lequel nous pouvons obtenir des objets à valeur d'usage.
La
question est la même que plus haut : le travail est-il créateur de valeurs d'échange, ou est-il une valeur d'échange ? Le travail est créateur
de valeurs d'échange, en tant que les valeurs d'usage qu'il produit sont à leur tour des valeurs d'échange.
Mais il est aussi une valeur
d'échange, car je peux vendre mon travail et en retirer de l'argent.
II.
a.
Le travail, créateur de la valeur marchande ?
Le travail, source de la valeur : la théorie de Ricardo et Marx
Après avoir déterminé si le travail est créateur de valeurs d'échange et d'usage, c'est-à-dire d e biens, de marchandises, nous nous
demanderons s'il est la source de la valeur même de ces marchandises.
Pour le philosophe du XIXème siècle Ricardo, et son successeur,
Marx, le travail est créateur de valeur, c'est-à-dire qu'il est la source de la valeur des marchandises.
Plus un objet a demandé du travail,
plus il a de la valeur.
Ainsi, pour reprendre l'expression de Marx dans Le Capital la valeur d'une marchandise équivaut à « la quantité du
temps de travails social incorporé dans cet objet », c'est-à-dire du temps de travail permettant d'acquérir les
valeurs d'usage nécessaires à la reproduction des forces du travailleur.
b.
L'utilité, source de la valeur plutôt que le travail
Mais cette théorie du travail, créateur d e la valeur des marchandises, a été largement remise en
question par la suite.
On lui préfère aujourd'hui la théorie de l'utilité marginale : la valeur d'un objet
décroit en fonction de sa disponibilité pour l'usager.
Le désir pour un produit diminue donc à chaque
incrément (c'est-à-dire à chaque nouvelle augmentation d e la disponibilité du produit).
C'est donc le
rapport entre l'utilité et la disponibilité d'un projet qui est créateur de la valeur marchande, plutôt que le
temps de travail nécessaire à la production des biens.
III.
Le travail, créateur de valeurs morales pour les hommes ?
a.
Le travail, créateur de valeurs morales pour l'individu
Nous prendrons ici le terme de « valeur » en un autre sens : celui de valeur morale que nous avons
définie en introduction.
Pour l'individu, le travail est créateur de valeurs morales en tant qu'il peut être
une norme pour lui (le travail impose un rythme à la journée, apprend à maîtriser son temps, alors que
la journée de l'oisif est sans repaires) sinon un idéal.
En effet, le travail dans la philosophie Hégélienne
est le moyen pour l'individu d'extérioriser l'intériorité d e l'individu, sinon d e retrouver la liberté que
l'esclave perd dans la lutte pour la reconnaissance (cf.
la parabole célèbre du maître et de l'esclave).
b.
Le travail, créateur de valeurs morales pour la société
Mais le travail est également créateur de valeurs morales pour la société.
En effet, par le travail, les hommes sont mis en relation, en
collaboration, ils deviennent indispensables les uns aux autres dans les sociétés modernes où la spécialisation est la règle.
Pour Emile
Durkheim dans son ouvrage intitulé « De la division du travail social » (1893) le travail est la source de la solidarité organique entre les
hommes (organique, c'est-à-dire par la collaboration de parties diverses, comme dans un organisme vivant.
Cette notion s'oppose à la
solidarité mécanique, qui tient à la diffusion de croyances communes dans la société).
Conclusion :
Le travail est créateur de biens, de marchandises, qui ont une valeur d'usage ou d'échange.
Mais il n'est pas créateur de la valeur même
des marchandises : c'est plutôt le rapport entre la rareté et l'utilité qui est à l'origine de la valeur ainsi entendu.
Enfin, il est créateur de
valeurs morales pour l'individu, en tant qu'il peut être u n e norme d e vie ou un idéal pour celui-ci ; et d e valeurs morales entre les
hommes, en tant qu'il est à l'origine de la solidarité entre les membres d'une même société..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Les romantiques voyaient dans l'affectivité le facteur essentiel du travail créateur. Pourtant, Diderot nous dit : « Les grands poètes, les grands acteurs, et peut-être en général tous les grands imitateurs de la nature sont les êtres les moins sensibles
- L'artiste est-il le seul à faire un travail créateur ?
- Sujet : Le travail technique est-il une transformation de l’homme ?
- [De l'acte créateur]
- Travail/Nature/technique: le travail est-il le propre de l'homme ?