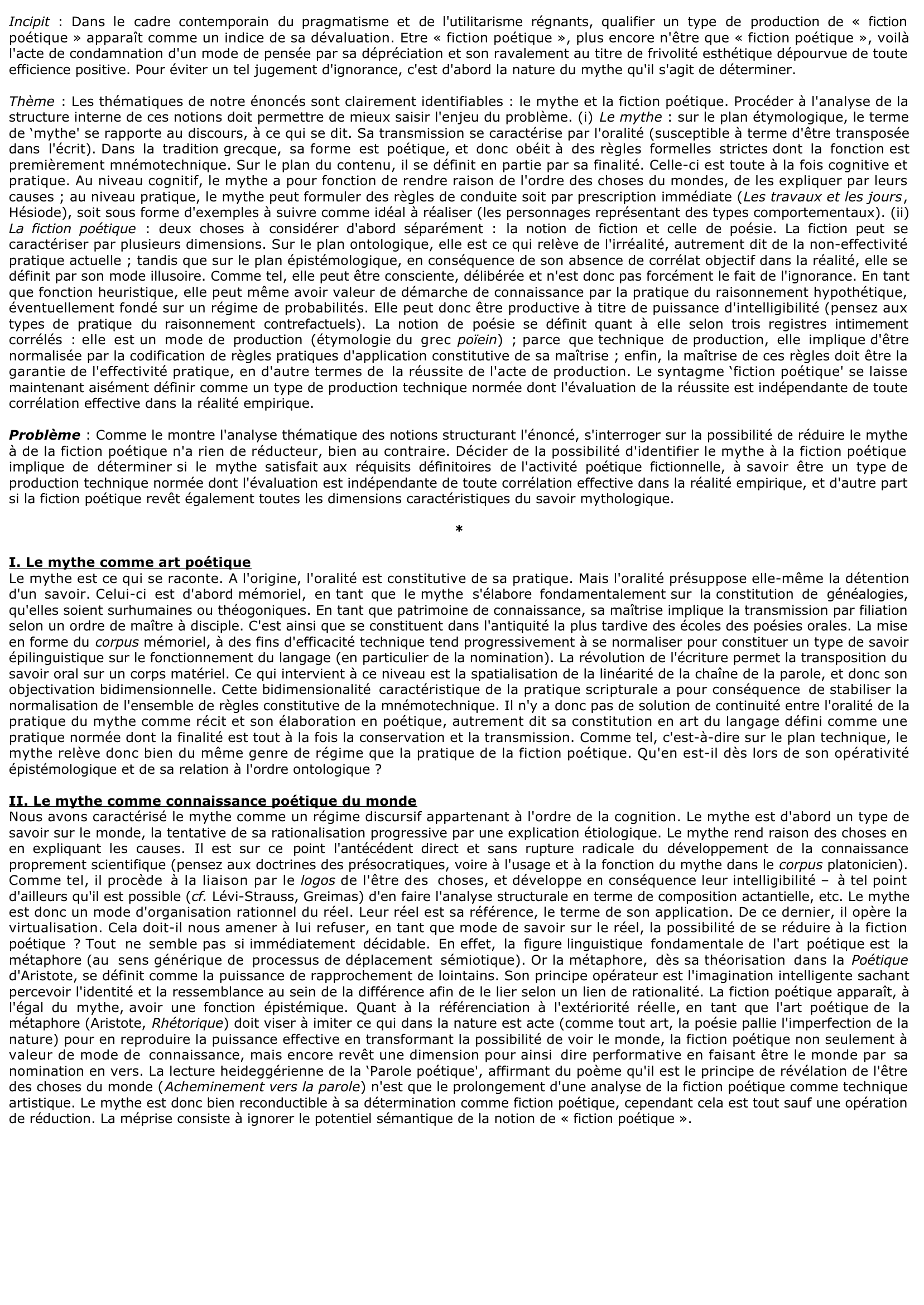Le mythe n'est-il qu'une fiction poétique ?
Extrait du document
«
Incipit : Dans le cadre contemporain du pragmatisme et de l'utilitarisme régnants, qualifier un type de production de « fiction
poétique » apparaît comme un indice de sa dévaluation.
Etre « fiction poétique », plus encore n'être que « fiction poétique », voilà
l'acte de condamnation d'un mode de pensée par sa dépréciation et son ravalement au titre de frivolité esthétique dépourvue de toute
efficience positive.
Pour éviter un tel jugement d'ignorance, c'est d'abord la nature du mythe qu'il s'agit de déterminer.
Thème : Les thématiques de notre énoncés sont clairement identifiables : le mythe et la fiction poétique.
Procéder à l'analyse de la
structure interne de ces notions doit permettre de mieux saisir l'enjeu du problème.
(i) Le mythe : sur le plan étymologique, le terme
de ‘mythe' se rapporte au discours, à ce qui se dit.
Sa transmission se caractérise par l'oralité (susceptible à terme d'être transposée
dans l'écrit).
Dans la tradition grecque, sa forme est poétique, et donc obéit à des règles formelles strictes dont la fonction est
premièrement mnémotechnique.
Sur le plan du contenu, il se définit en partie par sa finalité.
Celle-ci est toute à la fois cognitive et
pratique.
Au niveau cognitif, le mythe a pour fonction de rendre raison de l'ordre des choses du mondes, de les expliquer par leurs
causes ; au niveau pratique, le mythe peut formuler des règles de conduite soit par prescription immédiate (Les travaux et les jours,
Hésiode), soit sous forme d'exemples à suivre comme idéal à réaliser (les personnages représentant des types comportementaux).
(ii)
La fiction poétique : deux choses à considérer d'abord séparément : la notion de fiction et celle de poésie.
La fiction peut se
caractériser par plusieurs dimensions.
Sur le plan ontologique, elle est ce qui relève de l'irréalité, autrement dit de la non-effectivité
pratique actuelle ; tandis que sur le plan épistémologique, en conséquence de son absence de corrélat objectif dans la réalité, elle se
définit par son mode illusoire.
Comme tel, elle peut être consciente, délibérée et n'est donc pas forcément le fait de l'ignorance.
En tant
que fonction heuristique, elle peut même avoir valeur de démarche de connaissance par la pratique du raisonnement hypothétique,
éventuellement fondé sur un régime de probabilités.
Elle peut donc être productive à titre de puissance d'intelligibilité (pensez aux
types de pratique du raisonnement contrefactuels).
La notion de poésie se définit quant à elle selon trois registres intimement
corrélés : elle est un mode de production (étymologie du grec poïein) ; parce que technique de production, elle implique d'être
normalisée par la codification de règles pratiques d'application constitutive de sa maîtrise ; enfin, la maîtrise de ces règles doit être la
garantie de l'effectivité pratique, en d'autre termes de la réussite de l'acte de production.
Le syntagme ‘fiction poétique' se laisse
maintenant aisément définir comme un type de production technique normée dont l'évaluation de la réussite est indépendante de toute
corrélation effective dans la réalité empirique.
Problème : Comme le montre l'analyse thématique des notions structurant l'énoncé, s'interroger sur la possibilité de réduire le mythe
à de la fiction poétique n'a rien de réducteur, bien au contraire.
Décider de la possibilité d'identifier le mythe à la fiction poétique
implique de déterminer si le mythe satisfait aux réquisits définitoires de l'activité poétique fictionnelle, à savoir être un type de
production technique normée dont l'évaluation est indépendante de toute corrélation effective dans la réalité empirique, et d'autre part
si la fiction poétique revêt également toutes les dimensions caractéristiques du savoir mythologique.
*
I.
Le mythe comme art poétique
Le mythe est ce qui se raconte.
A l'origine, l'oralité est constitutive de sa pratique.
Mais l'oralité présuppose elle-même la détention
d'un savoir.
Celui-ci est d'abord mémoriel, en tant que le mythe s'élabore fondamentalement sur la constitution de généalogies,
qu'elles soient surhumaines ou théogoniques.
En tant que patrimoine de connaissance, sa maîtrise implique la transmission par filiation
selon un ordre de maître à disciple.
C'est ainsi que se constituent dans l'antiquité la plus tardive des écoles des poésies orales.
La mise
en forme du corpus mémoriel, à des fins d'efficacité technique tend progressivement à se normaliser pour constituer un type de savoir
épilinguistique sur le fonctionnement du langage (en particulier de la nomination).
La révolution de l'écriture permet la transposition du
savoir oral sur un corps matériel.
Ce qui intervient à ce niveau est la spatialisation de la linéarité de la chaîne de la parole, et donc son
objectivation bidimensionnelle.
Cette bidimensionalité caractéristique de la pratique scripturale a pour conséquence de stabiliser la
normalisation de l'ensemble de règles constitutive de la mnémotechnique.
Il n'y a donc pas de solution de continuité entre l'oralité de la
pratique du mythe comme récit et son élaboration en poétique, autrement dit sa constitution en art du langage défini comme une
pratique normée dont la finalité est tout à la fois la conservation et la transmission.
Comme tel, c'est-à-dire sur le plan technique, le
mythe relève donc bien du même genre de régime que la pratique de la fiction poétique.
Qu'en est-il dès lors de son opérativité
épistémologique et de sa relation à l'ordre ontologique ?
II.
Le mythe comme connaissance poétique du monde
Nous avons caractérisé le mythe comme un régime discursif appartenant à l'ordre de la cognition.
Le mythe est d'abord un type de
savoir sur le monde, la tentative de sa rationalisation progressive par une explication étiologique.
Le mythe rend raison des choses en
en expliquant les causes.
Il est sur ce point l'antécédent direct et sans rupture radicale du développement de la connaissance
proprement scientifique (pensez aux doctrines des présocratiques, voire à l'usage et à la fonction du mythe dans le corpus platonicien).
Comme tel, il procède à la liaison par le logos de l'être des choses, et développe en conséquence leur intelligibilité – à tel point
d'ailleurs qu'il est possible (cf.
Lévi-Strauss, Greimas) d'en faire l'analyse structurale en terme de composition actantielle, etc.
Le mythe
est donc un mode d'organisation rationnel du réel.
Leur réel est sa référence, le terme de son application.
De ce dernier, il opère la
virtualisation.
Cela doit-il nous amener à lui refuser, en tant que mode de savoir sur le réel, la possibilité de se réduire à la fiction
poétique ? Tout ne semble pas si immédiatement décidable.
En effet, la figure linguistique fondamentale de l'art poétique est la
métaphore (au sens générique de processus de déplacement sémiotique).
Or la métaphore, dès sa théorisation dans la Poétique
d'Aristote, se définit comme la puissance de rapprochement de lointains.
Son principe opérateur est l'imagination intelligente sachant
percevoir l'identité et la ressemblance au sein de la différence afin de le lier selon un lien de rationalité.
La fiction poétique apparaît, à
l'égal du mythe, avoir une fonction épistémique.
Quant à la référenciation à l'extériorité réelle, en tant que l'art poétique de la
métaphore (Aristote, Rhétorique) doit viser à imiter ce qui dans la nature est acte (comme tout art, la poésie pallie l'imperfection de la
nature) pour en reproduire la puissance effective en transformant la possibilité de voir le monde, la fiction poétique non seulement à
valeur de mode de connaissance, mais encore revêt une dimension pour ainsi dire performative en faisant être le monde par sa
nomination en vers.
La lecture heideggérienne de la ‘Parole poétique', affirmant du poème qu'il est le principe de révélation de l'être
des choses du monde (Acheminement vers la parole) n'est que le prolongement d'une analyse de la fiction poétique comme technique
artistique.
Le mythe est donc bien reconductible à sa détermination comme fiction poétique, cependant cela est tout sauf une opération
de réduction.
La méprise consiste à ignorer le potentiel sémantique de la notion de « fiction poétique »..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Poétique d'Aristote
- Camus,le mythe de Sisyphe
- Que fait l'écriture poétique et romanesque à l'événement historique violent?
- LE MYTHE DE PROMETHEE (PLATON)
- Le mythe d'Er et l'Orphisme