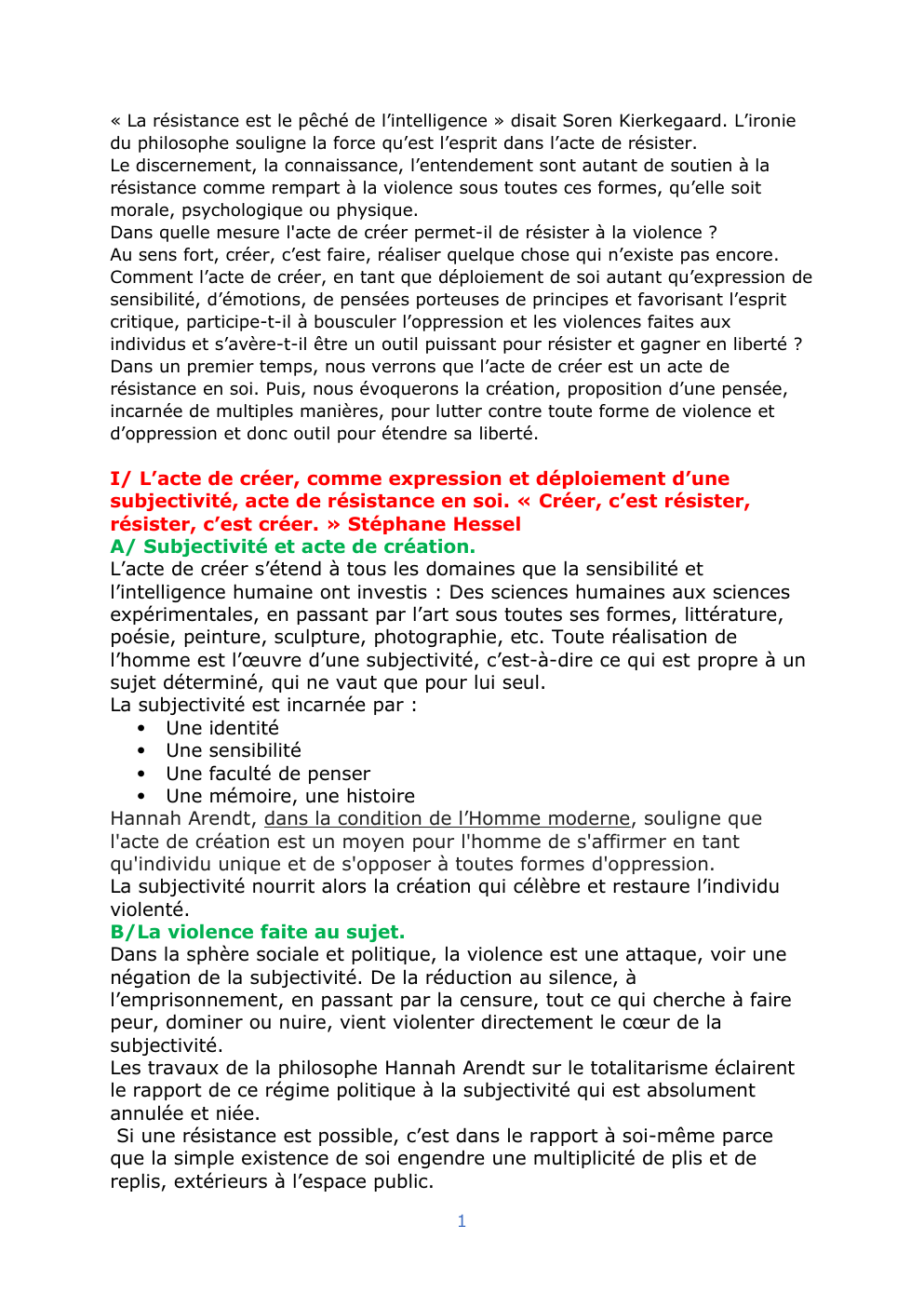l'acte de créer permet-il de résister contre la violence?
Publié le 21/09/2025
Extrait du document
«
« La résistance est le pêché de l’intelligence » disait Soren Kierkegaard.
L’ironie
du philosophe souligne la force qu’est l’esprit dans l’acte de résister.
Le discernement, la connaissance, l’entendement sont autant de soutien à la
résistance comme rempart à la violence sous toutes ces formes, qu’elle soit
morale, psychologique ou physique.
Dans quelle mesure l'acte de créer permet-il de résister à la violence ?
Au sens fort, créer, c’est faire, réaliser quelque chose qui n’existe pas encore.
Comment l’acte de créer, en tant que déploiement de soi autant qu’expression de
sensibilité, d’émotions, de pensées porteuses de principes et favorisant l’esprit
critique, participe-t-il à bousculer l’oppression et les violences faites aux
individus et s’avère-t-il être un outil puissant pour résister et gagner en liberté ?
Dans un premier temps, nous verrons que l’acte de créer est un acte de
résistance en soi.
Puis, nous évoquerons la création, proposition d’une pensée,
incarnée de multiples manières, pour lutter contre toute forme de violence et
d’oppression et donc outil pour étendre sa liberté.
I/ L’acte de créer, comme expression et déploiement d’une
subjectivité, acte de résistance en soi.
« Créer, c’est résister,
résister, c’est créer.
» Stéphane Hessel
A/ Subjectivité et acte de création.
L’acte de créer s’étend à tous les domaines que la sensibilité et
l’intelligence humaine ont investis : Des sciences humaines aux sciences
expérimentales, en passant par l’art sous toutes ses formes, littérature,
poésie, peinture, sculpture, photographie, etc.
Toute réalisation de
l’homme est l’œuvre d’une subjectivité, c’est-à-dire ce qui est propre à un
sujet déterminé, qui ne vaut que pour lui seul.
La subjectivité est incarnée par :
Une identité
Une sensibilité
Une faculté de penser
Une mémoire, une histoire
Hannah Arendt, dans la condition de l’Homme moderne, souligne que
l'acte de création est un moyen pour l'homme de s'affirmer en tant
qu'individu unique et de s'opposer à toutes formes d'oppression.
La subjectivité nourrit alors la création qui célèbre et restaure l’individu
violenté.
B/La violence faite au sujet.
Dans la sphère sociale et politique, la violence est une attaque, voir une
négation de la subjectivité.
De la réduction au silence, à
l’emprisonnement, en passant par la censure, tout ce qui cherche à faire
peur, dominer ou nuire, vient violenter directement le cœur de la
subjectivité.
Les travaux de la philosophe Hannah Arendt sur le totalitarisme éclairent
le rapport de ce régime politique à la subjectivité qui est absolument
annulée et niée.
Si une résistance est possible, c’est dans le rapport à soi-même parce
que la simple existence de soi engendre une multiplicité de plis et de
replis, extérieurs à l’espace public.
1
Exemple : Winston, le héros du personnage de 1984 de Georges Orwell,
lutte pour préserver dans l’anonymat une différence, un chez soi, (…), par
la pensée, dans le désir, dans le souvenir.
C/ Créer, c’est s’emparer de son l’existence, se positionner dans le
monde et s’affranchir de sa condition.
La création, sublimation de la violence et espace de liberté
Ce rapport à soi-même, parce que la simple existence de soi permet un
repli à soi, extérieur à l’espace public, est, dans une certaine mesure, une
mise à l’abri de la violence.
Exemple : Nâzim Hikmet a écrit une grande partie de son œuvre poétique
emprisonné par le gouvernement turc.
Comme l’indique les vers qui
suivent, par la puissance de l’imagination, la subjectivité du poète est
refuge, évasion et espace de liberté, en prison.
Dans la poésie, l’emprisonnement est sublimé, en tant que transformation
du drame au profit de l’œuvre d’art.
« Je suis dans la clarté qui s'avance
Mes mains sont toutes pleines de désir
Le monde est beau
Mes yeux ne se lassent pas de regarder les arbres
Les arbres si verts, les arbres si pleins d'espoir
Un sentier s'en va à travers les mûriers
Je suis à la fenêtre de l'infirmerie
Je ne sens pas l'odeur des médicaments
Les oeillets ont dû s'ouvrir quelque part
Être captif, là n'est pas la question
Il s'agit de ne pas se rendre
Voilà.
»
La création comme processus d’émancipation.
Créer, c’est, au sens littéral, produire quelque chose qui n’existe pas.
La
création devient finalement réalisation d’un autre soi, déploiement à l’infini
du sujet.
En ce sens, la création s’apparente à un rempart contre l’immobilisme et
est à l’origine du nouveau.
Cela peut impliquer un affranchissement du monde tel qu’il est parfois figé
et l’émancipation par rapport aux déterminismes potentiellement
enfermant (sociaux, économiques, culturels) afin de pouvoir s’inventer ou
se réinventer.
Par exemple, Edouard Louis, dans En finir avec Eddy bellegueule, décrit
l’émancipation de sa condition initiale.
En écrivant, il partage sa
transformation autant que l’écriture participe, en elle-même à sa
transformation.
2
Il s’émancipe en écrivant et partage un roman personnel et politique qui
met en lumière la trajectoire d’un transfuge de classe.
Le roman témoigne
de la conquête d’une forme de libération.
II/ Créer, en tant que proposer une pensée au monde et aux
autres pour résister à la violence.
A/ L’acte de création, expression de sa spécificité comme moyen
de transformation sociale.
L'art peut susciter des émotions et des réflexions qui remettent en
question l'ordre établi.
La création, comme expression d’injustices faites à
un humain ou groupe d’humains vulnérabilisés a alors vocation à susciter
les émotions, l’indignation nécessaires à l’empathie et à la solidarité,
autant qu’à éveiller....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- En quoi peut-on dire que la violence est au cœur des régimes totalitaires et de leur idéologie ?
- acte 1 scene 5 malade imaginaire
- [De l'acte créateur]
- Séquence 3 : Le Malade imaginaire de Molière. Analyse linéaire n°12 scène 10 acte III
- Démocratie et violence en côte d'ivoire: contribution à l'émergence d'une société nouvelle