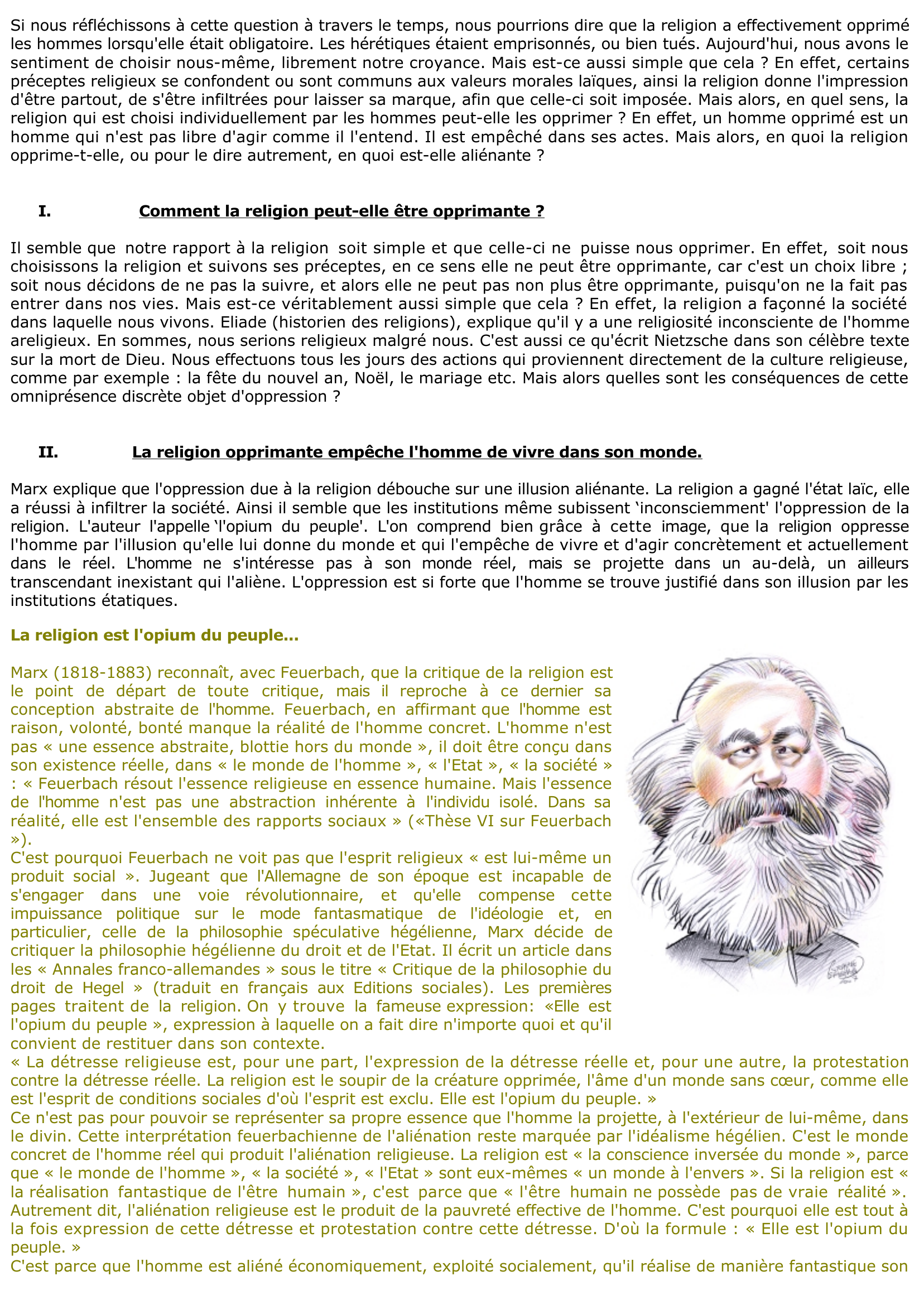La religion opprime-t-elle les hommes?
Extrait du document
«
Si nous réfléchissons à cette question à travers le temps, nous pourrions dire que la religion a effectivement opprimé
les hommes lorsqu'elle était obligatoire.
Les hérétiques étaient emprisonnés, ou bien tués.
Aujourd'hui, nous avons le
sentiment de choisir nous-même, librement notre croyance.
Mais est-ce aussi simple que cela ? En effet, certains
préceptes religieux se confondent ou sont communs aux valeurs morales laïques, ainsi la religion donne l'impression
d'être partout, de s'être infiltrées pour laisser sa marque, afin que celle-ci soit imposée.
Mais alors, en quel sens, la
religion qui est choisi individuellement par les hommes peut-elle les opprimer ? En effet, un homme opprimé est un
homme qui n'est pas libre d'agir comme il l'entend.
Il est empêché dans ses actes.
Mais alors, en quoi la religion
opprime-t-elle, ou pour le dire autrement, en quoi est-elle aliénante ?
I.
Comment la religion peut-elle être opprimante ?
Il semble que notre rapport à la religion soit simple et que celle-ci ne puisse nous opprimer.
En effet, soit nous
choisissons la religion et suivons ses préceptes, en ce sens elle ne peut être opprimante, car c'est un choix libre ;
soit nous décidons de ne pas la suivre, et alors elle ne peut pas non plus être opprimante, puisqu'on ne la fait pas
entrer dans nos vies.
Mais est-ce véritablement aussi simple que cela ? En effet, la religion a façonné la société
dans laquelle nous vivons.
Eliade (historien des religions), explique qu'il y a une religiosité inconsciente de l'homme
areligieux.
En sommes, nous serions religieux malgré nous.
C'est aussi ce qu'écrit Nietzsche dans son célèbre texte
sur la mort de Dieu.
Nous effectuons tous les jours des actions qui proviennent directement de la culture religieuse,
comme par exemple : la fête du nouvel an, Noël, le mariage etc.
Mais alors quelles sont les conséquences de cette
omniprésence discrète objet d'oppression ?
II.
La religion opprimante empêche l'homme de vivre dans son monde.
Marx explique que l'oppression due à la religion débouche sur une illusion aliénante.
La religion a gagné l'état laïc, elle
a réussi à infiltrer la société.
Ainsi il semble que les institutions même subissent ‘inconsciemment' l'oppression de la
religion.
L'auteur l'appelle ‘l'opium du peuple'.
L'on comprend bien grâce à cette image, que la religion oppresse
l'homme par l'illusion qu'elle lui donne du monde et qui l'empêche de vivre et d'agir concrètement et actuellement
dans le réel.
L'homme ne s'intéresse pas à son monde réel, mais se projette dans un au-delà, un ailleurs
transcendant inexistant qui l'aliène.
L'oppression est si forte que l'homme se trouve justifié dans son illusion par les
institutions étatiques.
La religion est l'opium du peuple...
Marx (1818-1883) reconnaît, avec Feuerbach, que la critique de la religion est
le point de départ de toute critique, mais il reproche à ce dernier sa
conception abstraite de l'homme.
Feuerbach, en affirmant que l'homme est
raison, volonté, bonté manque la réalité de l'homme concret.
L'homme n'est
pas « une essence abstraite, blottie hors du monde », il doit être conçu dans
son existence réelle, dans « le monde de l'homme », « l'Etat », « la société »
: « Feuerbach résout l'essence religieuse en essence humaine.
Mais l'essence
de l'homme n'est pas une abstraction inhérente à l'individu isolé.
Dans sa
réalité, elle est l'ensemble des rapports sociaux » («Thèse VI sur Feuerbach
»).
C'est pourquoi Feuerbach ne voit pas que l'esprit religieux « est lui-même un
produit social ».
Jugeant que l'Allemagne de son époque est incapable de
s'engager dans une voie révolutionnaire, et qu'elle compense cette
impuissance politique sur le mode fantasmatique de l'idéologie et, en
particulier, celle de la philosophie spéculative hégélienne, Marx décide de
critiquer la philosophie hégélienne du droit et de l'Etat.
Il écrit un article dans
les « Annales franco-allemandes » sous le titre « Critique de la philosophie du
droit de Hegel » (traduit en français aux Editions sociales).
Les premières
pages traitent de la religion.
On y trouve la fameuse expression: «Elle est
l'opium du peuple », expression à laquelle on a fait dire n'importe quoi et qu'il
convient de restituer dans son contexte.
« La détresse religieuse est, pour une part, l'expression de la détresse réelle et, pour une autre, la protestation
contre la détresse réelle.
La religion est le soupir de la créature opprimée, l'âme d'un monde sans cœur, comme elle
est l'esprit de conditions sociales d'où l'esprit est exclu.
Elle est l'opium du peuple.
»
Ce n'est pas pour pouvoir se représenter sa propre essence que l'homme la projette, à l'extérieur de lui-même, dans
le divin.
Cette interprétation feuerbachienne de l'aliénation reste marquée par l'idéalisme hégélien.
C'est le monde
concret de l'homme réel qui produit l'aliénation religieuse.
La religion est « la conscience inversée du monde », parce
que « le monde de l'homme », « la société », « l'Etat » sont eux-mêmes « un monde à l'envers ».
Si la religion est «
la réalisation fantastique de l'être humain », c'est parce que « l'être humain ne possède pas de vraie réalité ».
Autrement dit, l'aliénation religieuse est le produit de la pauvreté effective de l'homme.
C'est pourquoi elle est tout à
la fois expression de cette détresse et protestation contre cette détresse.
D'où la formule : « Elle est l'opium du
peuple.
»
C'est parce que l'homme est aliéné économiquement, exploité socialement, qu'il réalise de manière fantastique son.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- L'espoir fait-il vivre les hommes ?
- EC2 : Caractérisez la mobilité sociale des hommes par rapport à leur père.
- Tant que les hommes massacreront les bêtes, ils s'entre-tueront (Pythagore)
- étude linéaire exhortation aux hommes olympe de gouge
- Etude linéaire exhortation aux hommes olympe de gouge