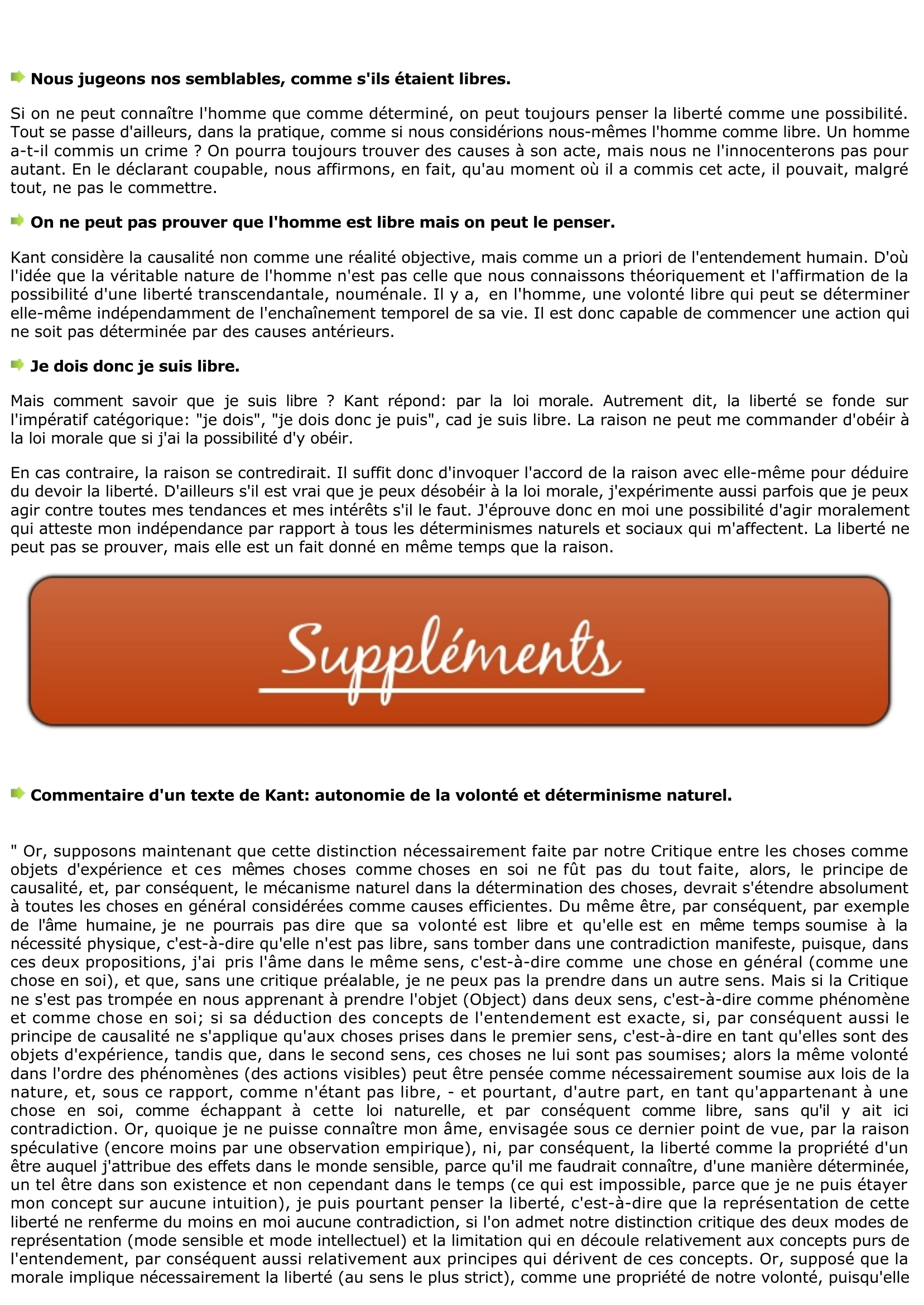La liberté est-elle un fait ?
Extrait du document
«
Nous jugeons nos semblables, comme s'ils étaient libres.
Si on ne peut connaître l'homme que comme déterminé, on peut toujours penser la liberté comme une possibilité.
Tout se passe d'ailleurs, dans la pratique, comme si nous considérions nous-mêmes l'homme comme libre.
Un homme
a-t-il commis un crime ? On pourra toujours trouver des causes à son acte, mais nous ne l'innocenterons pas pour
autant.
En le déclarant coupable, nous affirmons, en fait, qu'au moment où il a commis cet acte, il pouvait, malgré
tout, ne pas le commettre.
On ne peut pas prouver que l'homme est libre mais on peut le penser.
Kant considère la causalité non comme une réalité objective, mais comme un a priori de l'entendement humain.
D'où
l'idée que la véritable nature de l'homme n'est pas celle que nous connaissons théoriquement et l'affirmation de la
possibilité d'une liberté transcendantale, nouménale.
Il y a, en l'homme, une volonté libre qui peut se déterminer
elle-même indépendamment de l'enchaînement temporel de sa vie.
Il est donc capable de commencer une action qui
ne soit pas déterminée par des causes antérieurs.
Je dois donc je suis libre.
Mais comment savoir que je suis libre ? Kant répond: par la loi morale.
Autrement dit, la liberté se fonde sur
l'impératif catégorique: "je dois", "je dois donc je puis", cad je suis libre.
La raison ne peut me commander d'obéir à
la loi morale que si j'ai la possibilité d'y obéir.
En cas contraire, la raison se contredirait.
Il suffit donc d'invoquer l'accord de la raison avec elle-même pour déduire
du devoir la liberté.
D'ailleurs s'il est vrai que je peux désobéir à la loi morale, j'expérimente aussi parfois que je peux
agir contre toutes mes tendances et mes intérêts s'il le faut.
J'éprouve donc en moi une possibilité d'agir moralement
qui atteste mon indépendance par rapport à tous les déterminismes naturels et sociaux qui m'affectent.
La liberté ne
peut pas se prouver, mais elle est un fait donné en même temps que la raison.
Commentaire d'un texte de Kant: autonomie de la volonté et déterminisme naturel.
" Or, supposons maintenant que cette distinction nécessairement faite par notre Critique entre les choses comme
objets d'expérience et ces mêmes choses comme choses en soi ne fût pas du tout faite, alors, le principe de
causalité, et, par conséquent, le mécanisme naturel dans la détermination des choses, devrait s'étendre absolument
à toutes les choses en général considérées comme causes efficientes.
Du même être, par conséquent, par exemple
de l'âme humaine, je ne pourrais pas dire que sa volonté est libre et qu'elle est en même temps soumise à la
nécessité physique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas libre, sans tomber dans une contradiction manifeste, puisque, dans
ces deux propositions, j'ai pris l'âme dans le même sens, c'est-à-dire comme une chose en général (comme une
chose en soi), et que, sans une critique préalable, je ne peux pas la prendre dans un autre sens.
Mais si la Critique
ne s'est pas trompée en nous apprenant à prendre l'objet (Object) dans deux sens, c'est-à-dire comme phénomène
et comme chose en soi; si sa déduction des concepts de l'entendement est exacte, si, par conséquent aussi le
principe de causalité ne s'applique qu'aux choses prises dans le premier sens, c'est-à-dire en tant qu'elles sont des
objets d'expérience, tandis que, dans le second sens, ces choses ne lui sont pas soumises; alors la même volonté
dans l'ordre des phénomènes (des actions visibles) peut être pensée comme nécessairement soumise aux lois de la
nature, et, sous ce rapport, comme n'étant pas libre, - et pourtant, d'autre part, en tant qu'appartenant à une
chose en soi, comme échappant à cette loi naturelle, et par conséquent comme libre, sans qu'il y ait ici
contradiction.
Or, quoique je ne puisse connaître mon âme, envisagée sous ce dernier point de vue, par la raison
spéculative (encore moins par une observation empirique), ni, par conséquent, la liberté comme la propriété d'un
être auquel j'attribue des effets dans le monde sensible, parce qu'il me faudrait connaître, d'une manière déterminée,
un tel être dans son existence et non cependant dans le temps (ce qui est impossible, parce que je ne puis étayer
mon concept sur aucune intuition), je puis pourtant penser la liberté, c'est-à-dire que la représentation de cette
liberté ne renferme du moins en moi aucune contradiction, si l'on admet notre distinction critique des deux modes de
représentation (mode sensible et mode intellectuel) et la limitation qui en découle relativement aux concepts purs de
l'entendement, par conséquent aussi relativement aux principes qui dérivent de ces concepts.
Or, supposé que la
morale implique nécessairement la liberté (au sens le plus strict), comme une propriété de notre volonté, puisqu'elle.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Liberté de manchot - Augustin
- « La liberté consiste à faire ce que chacun désire» Mill
- L’Arabie Saoudite et la liberté d’expression: peut-on parler de liberté?
- Bergson étude de texte: liberté et invention
- La liberté peut-elle être sans loi ?