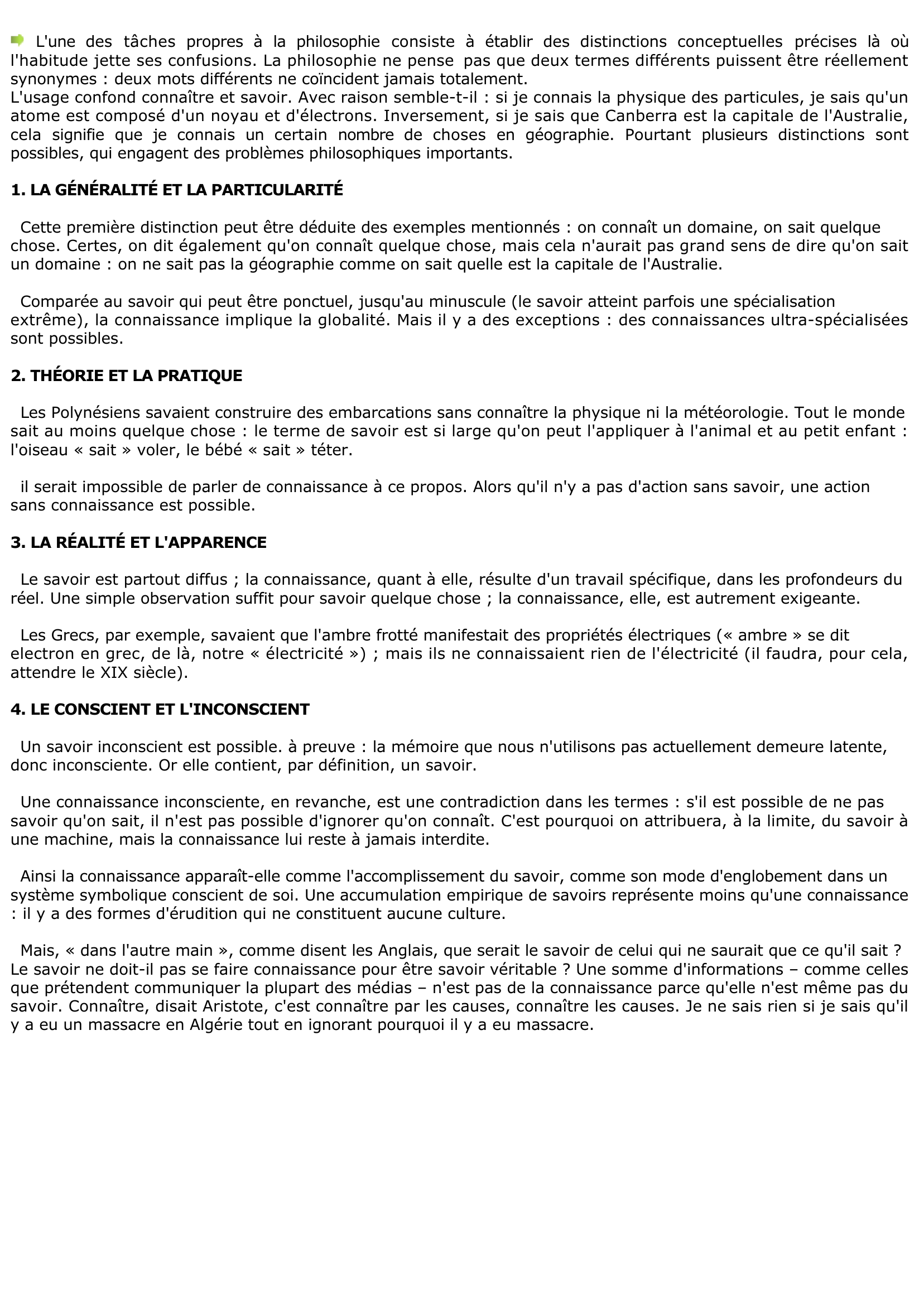Connaître et savoir
Extrait du document
«
L'une des tâches propres à la philosophie consiste à établir des distinctions conceptuelles précises là où
l'habitude jette ses confusions.
La philosophie ne pense pas que deux termes différents puissent être réellement
synonymes : deux mots différents ne coïncident jamais totalement.
L'usage confond connaître et savoir.
Avec raison semble-t-il : si je connais la physique des particules, je sais qu'un
atome est composé d'un noyau et d'électrons.
Inversement, si je sais que Canberra est la capitale de l'Australie,
cela signifie que je connais un certain nombre de choses en géographie.
Pourtant plusieurs distinctions sont
possibles, qui engagent des problèmes philosophiques importants.
1.
LA GÉNÉRALITÉ ET LA PARTICULARITÉ
Cette première distinction peut être déduite des exemples mentionnés : on connaît un domaine, on sait quelque
chose.
Certes, on dit également qu'on connaît quelque chose, mais cela n'aurait pas grand sens de dire qu'on sait
un domaine : on ne sait pas la géographie comme on sait quelle est la capitale de l'Australie.
Comparée au savoir qui peut être ponctuel, jusqu'au minuscule (le savoir atteint parfois une spécialisation
extrême), la connaissance implique la globalité.
Mais il y a des exceptions : des connaissances ultra-spécialisées
sont possibles.
2.
THÉORIE ET LA PRATIQUE
Les Polynésiens savaient construire des embarcations sans connaître la physique ni la météorologie.
Tout le monde
sait au moins quelque chose : le terme de savoir est si large qu'on peut l'appliquer à l'animal et au petit enfant :
l'oiseau « sait » voler, le bébé « sait » téter.
il serait impossible de parler de connaissance à ce propos.
Alors qu'il n'y a pas d'action sans savoir, une action
sans connaissance est possible.
3.
LA RÉALITÉ ET L'APPARENCE
Le savoir est partout diffus ; la connaissance, quant à elle, résulte d'un travail spécifique, dans les profondeurs du
réel.
Une simple observation suffit pour savoir quelque chose ; la connaissance, elle, est autrement exigeante.
Les Grecs, par exemple, savaient que l'ambre frotté manifestait des propriétés électriques (« ambre » se dit
electron en grec, de là, notre « électricité ») ; mais ils ne connaissaient rien de l'électricité (il faudra, pour cela,
attendre le XIX siècle).
4.
LE CONSCIENT ET L'INCONSCIENT
Un savoir inconscient est possible.
à preuve : la mémoire que nous n'utilisons pas actuellement demeure latente,
donc inconsciente.
Or elle contient, par définition, un savoir.
Une connaissance inconsciente, en revanche, est une contradiction dans les termes : s'il est possible de ne pas
savoir qu'on sait, il n'est pas possible d'ignorer qu'on connaît.
C'est pourquoi on attribuera, à la limite, du savoir à
une machine, mais la connaissance lui reste à jamais interdite.
Ainsi la connaissance apparaît-elle comme l'accomplissement du savoir, comme son mode d'englobement dans un
système symbolique conscient de soi.
Une accumulation empirique de savoirs représente moins qu'une connaissance
: il y a des formes d'érudition qui ne constituent aucune culture.
Mais, « dans l'autre main », comme disent les Anglais, que serait le savoir de celui qui ne saurait que ce qu'il sait ?
Le savoir ne doit-il pas se faire connaissance pour être savoir véritable ? Une somme d'informations – comme celles
que prétendent communiquer la plupart des médias – n'est pas de la connaissance parce qu'elle n'est même pas du
savoir.
Connaître, disait Aristote, c'est connaître par les causes, connaître les causes.
Je ne sais rien si je sais qu'il
y a eu un massacre en Algérie tout en ignorant pourquoi il y a eu massacre..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Toutes les propositions de logique disent la même chose. A savoir rien. Wittgenstein
- Le pouvoir produit du savoir; pouvoir et savoir s'impliquent directement l'un l'autre. Michel Foucault
- Connaître le monde viking
- Le sexe, sphinx ou volonté de savoir ? Michel Foucault
- Savoir est-ce cesser de croire ?