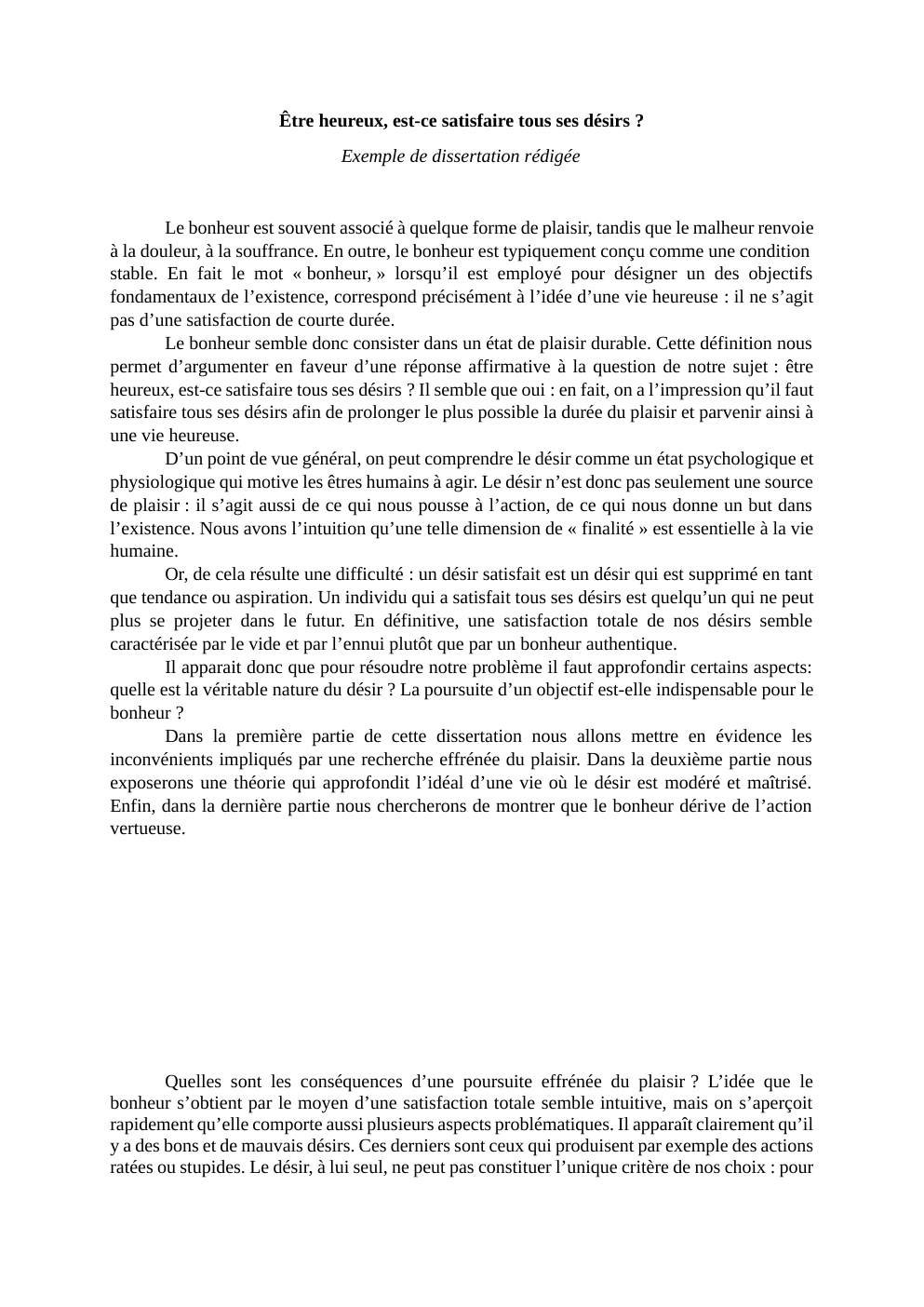Être heureux, est-ce satisfaire tous ses désirs ? Exemple de dissertation rédigée
Publié le 29/10/2025
Extrait du document
«
Être heureux, est-ce satisfaire tous ses désirs ?
Exemple de dissertation rédigée
Le bonheur est souvent associé à quelque forme de plaisir, tandis que le malheur renvoie
à la douleur, à la souffrance.
En outre, le bonheur est typiquement conçu comme une condition
stable.
En fait le mot « bonheur, » lorsqu’il est employé pour désigner un des objectifs
fondamentaux de l’existence, correspond précisément à l’idée d’une vie heureuse : il ne s’agit
pas d’une satisfaction de courte durée.
Le bonheur semble donc consister dans un état de plaisir durable.
Cette définition nous
permet d’argumenter en faveur d’une réponse affirmative à la question de notre sujet : être
heureux, est-ce satisfaire tous ses désirs ? Il semble que oui : en fait, on a l’impression qu’il faut
satisfaire tous ses désirs afin de prolonger le plus possible la durée du plaisir et parvenir ainsi à
une vie heureuse.
D’un point de vue général, on peut comprendre le désir comme un état psychologique et
physiologique qui motive les êtres humains à agir.
Le désir n’est donc pas seulement une source
de plaisir : il s’agit aussi de ce qui nous pousse à l’action, de ce qui nous donne un but dans
l’existence.
Nous avons l’intuition qu’une telle dimension de « finalité » est essentielle à la vie
humaine.
Or, de cela résulte une difficulté : un désir satisfait est un désir qui est supprimé en tant
que tendance ou aspiration.
Un individu qui a satisfait tous ses désirs est quelqu’un qui ne peut
plus se projeter dans le futur.
En définitive, une satisfaction totale de nos désirs semble
caractérisée par le vide et par l’ennui plutôt que par un bonheur authentique.
Il apparait donc que pour résoudre notre problème il faut approfondir certains aspects:
quelle est la véritable nature du désir ? La poursuite d’un objectif est-elle indispensable pour le
bonheur ?
Dans la première partie de cette dissertation nous allons mettre en évidence les
inconvénients impliqués par une recherche effrénée du plaisir.
Dans la deuxième partie nous
exposerons une théorie qui approfondit l’idéal d’une vie où le désir est modéré et maîtrisé.
Enfin, dans la dernière partie nous chercherons de montrer que le bonheur dérive de l’action
vertueuse.
Quelles sont les conséquences d’une poursuite effrénée du plaisir ? L’idée que le
bonheur s’obtient par le moyen d’une satisfaction totale semble intuitive, mais on s’aperçoit
rapidement qu’elle comporte aussi plusieurs aspects problématiques.
Il apparaît clairement qu’il
y a des bons et de mauvais désirs.
Ces derniers sont ceux qui produisent par exemple des actions
ratées ou stupides.
Le désir, à lui seul, ne peut pas constituer l’unique critère de nos choix : pour
être efficace, notre comportement doit s’appuyer sur la raison.
Souvent nous devons par
exemple prévoir les conséquences de nos actes et refréner nos désirs présents afin d’obtenir
quelque chose de mieux dans le futur.
Cependant, une conception du bonheur basée sur la satisfaction illimitée du désir peut
être développée de manière raffinée et convaincante, comme le fait Calliclès dans le Gorgias de
Platon.
Selon Calliclès la vie heureuse n’est pas à la portée de tout le monde.
Seulement les
personnes appartenant à une élite restreinte possèdent les capacités intellectuelles et la force de
caractère nécessaires pour satisfaire tous les désirs qu’elles ont.
Ici « satisfaire tous ses désirs »
ne signifie pas agir sans discernement, en recherchant seulement un bien-être immédiat.
Le
bonheur de Calliclès est celui de la personne ambitieuse qui met tout en œuvre afin d’assouvir sa
soif de pouvoir et de domination.
L’intelligence et le courage de l’individu sont mis au service
d’un idéal de vie purement égoïste et immoral, mais qui d’autre part présente les attraits de la
difficulté et peut-être d’un certain héroïsme.
En outre Calliclès affirme que pour avoir une vie heureuse il faut « laisser prendre à ses
passions tout l’accroissement possible : » la poursuite du bonheur requiert la création des
nouveaux désirs.
Sur la base de cette idée nous pouvons répondre à l’argument formulé dans
l’introduction, pour lequel la recherche d’une satisfaction totale aboutirait à une condition de
vide et d’ennui.
Cette condition ne représente pas nécessairement la destination finale d’une vie
vouée à la satisfaction de tous les désirs: on peut toujours repousser l’obtention d’une telle
satisfaction totale, car les désirs d’un individu fort et ambitieux peuvent être sans cesse
renouvelés et augmentés.
L’interlocuteur de Calliclès, Socrate, se fait le porte-parole d’une conception du bonheur
complètement opposée : il faut modérer ses désirs, être tempérant.
Socrate compare la personne
tempérante à un homme qui possède des tonneaux pleins de vin, de miel et d’autres denrées
chères et très appréciées.
L’homme tempérant a rempli ces tonneaux avec effort et maintenant il
jouit de la possession de ses biens.
Par contre, selon Socrate, la personne déréglée est similaire à
un homme qui a de tonneaux percés.
L’homme avec les tonneaux percés peine pour se procurer
du vin et d’autres biens, et en plus il est contraint de toujours verser dans ses tonneaux qui ne
restent jamais pleins pour beaucoup de temps.
Cette allégorie signifie que la maîtrise de ses désirs permet d’atteindre la paix et la
tranquillité.
L’homme déréglé est contraint de parcourir une trajectoire absurde, parce que ses
désirs l’obligent toujours à se donner de la peine pour les satisfaire, sans pour cela atteindre une
condition de bonheur durable.
Calliclès n’est pas convaincu par le raisonnement de Socrate : au contraire, pour lui une
vie de satisfaction stable est une vie vide et inerte, qui manque de sensations et de jouissance.
Le
bonheur, pour Calliclès, provient de l’activité dans laquelle nous sommes engagé grâce au désir.
Le débat entre Calliclès et Socrate nous a montré deux conceptions du bonheur qui
semblent irréconciliables.
En dernière analyse, la perspective de Calliclès semble un peu trop
optimiste.
Calliclès sous-évalue le fait que le désir est manque : celui qui est privé de l’objet de
son désir souffre.
Les actions et les efforts qui naissent du désir peuvent être source de joie, mais
seulement à condition d’avoir l’espoir d’atteindre la satisfaction.
Cet espoir est absent dans la
vie de l’homme déréglé, car celui-ci désire toujours plus : ses désirs seront donc aussi très
difficiles à satisfaire, ce qui augmente proportionnellement les efforts et les risques de
frustration.
Calliclès affirme que l’homme satisfait vit « la vie d’une pierre : » nous retrouvons
encore l’idée selon laquelle sans l’activité du désir l’existence humaine n’a pas de sens.
Cependant, la discussion de cette partie a mis en évidence que l’être humain ne peut pas trouver
un vrai sens ou une vraie finalité dans le déréglément : la recherche effrénée du plaisir donne
lieu à un cercle vicieux où l’accomplissement du désir laisse la place à une nouvelle privation.
Il est donc nécessaire d’approfondir l’idéal d’une vie où les désirs sont modérés en vue
de l’obtention du bonheur : au moins pour le moment, cette dernière option semble être la
meilleure.
Dans la prochaine partie nous allons donc considérer une théorie selon laquelle il est
nécessaire d’abandonner certains types de désir.
La modération du désir permet-elle d’atteindre le bonheur ? Le philosophe grec Epicure
répond par l’affirmative : nous pouvons trouver un développement de cette idée dans la Lettre à
Ménécée.
Selon Epicure le bonheur consiste dans le plaisir, mais il faut être attentif à bien
comprendre la nature de cette expérience.
La plupart des êtres humains s’en font une idée
erronée : le plaisir serait quelque chose qui peut être accumulée.
De ce point de vue, afin d’être
heureux il faudra satisfaire tous ses désirs afin d’augmenter la quantité de plaisir ressentie.
Mais
il s’agit d’une erreur : le plaisir selon Epicure est seulement absence de douleur (physique et
psychologique.) « Une fois que la douleur est partie, » écrit Epicure, « le plaisir peut se
diversifier mais il ne peut pas être augmenté.
»
La découverte de cette vérité est indispensable pour obtenir le bonheur, qui est conçu par
Epicure comme un état de paix intérieure, d’absence de trouble.
En fait, c’est seulement grâce à
une compréhension exacte de la nature du plaisir qu’il est possible de faire un tri dans ses désirs,
en éliminant ceux qui sont nuisibles.
Epicure classifie les désirs en trois typologies : les désirs
naturels et nécessaires, les désirs naturels et non-nécessaires, et enfin les désirs qui ne sont ni
naturels ni nécessaires.
Epicure appelle « naturels » les désirs qui sont innées : ce sont par exemple les désirs de
manger, de boire ou de dormir.
Par contre les désirs non naturels sont « artificiels, » c’est-à-dire
qu’ils sont produits par les hommes dans le contexte de la vie en société : nous pouvons
considérer le désir d’être célèbre, ou bien le désir d’exercer du pouvoir sur les autres.
En outre,
pour Epicure, les désirs sont nécessaires s’ils engendrent de la douleur lorsqu’ils ne sont pas
satisfaits.
Un désir qui n’est pas nécessaire est un désir qui ne sert pas à calmer la douleur.
Ainsi,
par exemple, un....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Etre heureux, est-ce satisfaire tous ses désirs?
- Doit-on satisfaire, maîtriser ou renoncer à ses désirs ?
- Doit-on supprimer ses désirs pour être heureux ?
- l'Etat doit-il chercher à satisfaire les désirs des citoyens ?
- Etre heureux est-ce assouvir tous ses désirs ?