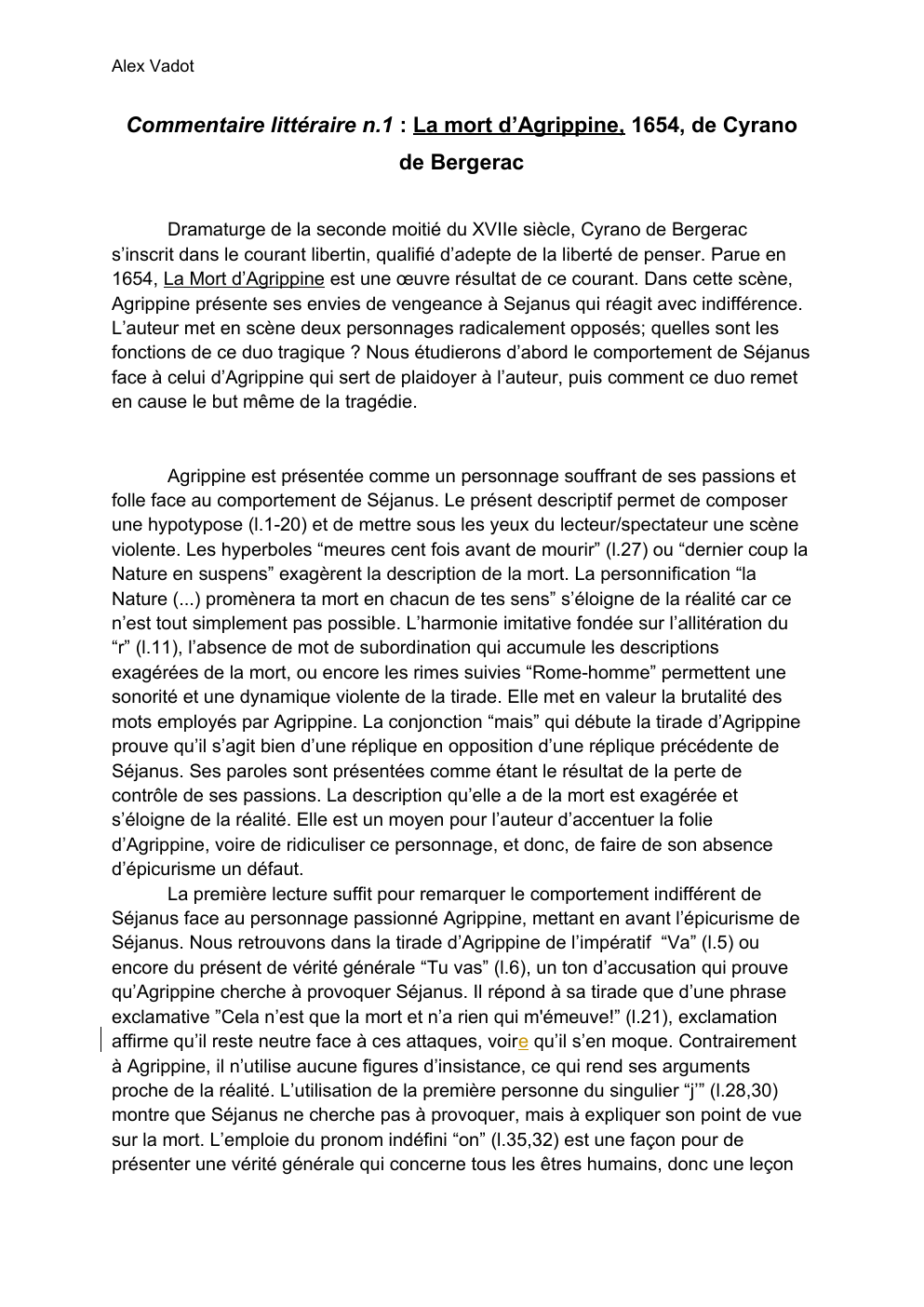Commentaire La Mort d'Agrippine
Publié le 23/04/2025
Extrait du document
«
Commentaire littéraire n.1 : La mort d’Agrippine, 1654, de Cyrano
de Bergerac
Dramaturge de la seconde moitié du XVIIe siècle, Cyrano de Bergerac
s’inscrit dans le courant libertin, qualifié d’adepte de la liberté de penser.
Parue en
1654, La Mort d’Agrippine est une œuvre résultat de ce courant.
Dans cette scène,
Agrippine présente ses envies de vengeance à Sejanus qui réagit avec indifférence.
L’auteur met en scène deux personnages radicalement opposés; quelles sont les
fonctions de ce duo tragique ? Nous étudierons d’abord le comportement de Séjanus
face à celui d’Agrippine qui sert de plaidoyer à l’auteur, puis comment ce duo remet
en cause le but même de la tragédie.
Agrippine est présentée comme un personnage souffrant de ses passions et
folle face au comportement de Séjanus.
Le présent descriptif permet de composer
une hypotypose (l.1-20) et de mettre sous les yeux du lecteur/spectateur une scène
violente.
Les hyperboles “meures cent fois avant de mourir” (l.27) ou “dernier coup la
Nature en suspens” exagèrent la description de la mort.
La personnification “la
Nature (...) promènera ta mort en chacun de tes sens” s’éloigne de la réalité car ce
n’est tout simplement pas possible.
L’harmonie imitative fondée sur l’allitération du
“r” (l.11), l’absence de mot de subordination qui accumule les descriptions
exagérées de la mort, ou encore les rimes suivies “Rome-homme” permettent une
sonorité et une dynamique violente de la tirade.
Elle met en valeur la brutalité des
mots employés par Agrippine.
La conjonction “mais” qui débute la tirade d’Agrippine
prouve qu’il s’agit bien d’une réplique en opposition d’une réplique précédente de
Séjanus.
Ses paroles sont présentées comme étant le résultat de la perte de
contrôle de ses passions.
La description qu’elle a de la mort est exagérée et
s’éloigne de la réalité.
Elle est un moyen pour l’auteur d’accentuer la folie
d’Agrippine, voire de ridiculiser ce personnage, et donc, de faire de son absence
d’épicurisme un défaut.
La première lecture suffit pour remarquer le comportement indifférent de
Séjanus face au personnage passionné Agrippine, mettant en avant l’épicurisme de
Séjanus.
Nous retrouvons dans la tirade d’Agrippine de l’impératif “Va” (l.5) ou
encore du présent de vérité générale “Tu vas” (l.6), un ton d’accusation qui prouve
qu’Agrippine cherche à provoquer Séjanus.
Il répond à sa tirade que d’une phrase
exclamative ”Cela n’est que la mort et n’a rien qui m'émeuve!” (l.21), exclamation
affirme qu’il reste neutre face à ces attaques, voire qu’il s’en moque.
Contrairement
à Agrippine, il n’utilise aucune figures d’insistance, ce qui rend ses arguments
proche de la réalité.
L’utilisation de la première personne du singulier “j’” (l.28,30)
montre que Séjanus ne cherche pas à provoquer, mais à expliquer son point de vue
sur la mort.
L’emploie du pronom indéfini “on” (l.35,32) est une façon pour de
présenter une vérité générale qui concerne tous les êtres humains, donc une leçon
Alex Vadot
philosophique.
Le lecteur/spectateur se sentira en conséquence concerné.
Séjanus
étant présenté comme un personnage sage dans cette scène, il sera plus simple de
convaincre le spectateur/lecteur par la suite.
L’opposition entre un personnage ataraxique et un personnage passionné
sert de plaidoyer à l’auteur, qui défend la pensée épicurienne.
Dans les répliques de
Séjanus sont expliquées plusieurs fois cette mentalité matérialiste: “Étais-je
malheureux, lorsque je n’étais pas?” (l.23), “un état sans douleur” (l.30) ou encore “ni
trouble ni terreur” (l.31).
Elles permettent à l’auteur d'expliquer directement au
lecteur/spectateur ce qu’est l’épicurisme.
Ils forment en même temps des arguments
construits, fidèles à la réalité grâce à l’absence de figures d’insistance.
La question
rhétorique “Étais-je malheureux, lorsque je n’étais pas” (l.23) et l’utilisation de
l’imparfait “étais” qui marque cette affirmation dans la durée est un moyen pour
l’auteur de toucher le lecteur/spectateur.
Ceci provoque chez le lecteur/spectateur
une réflexion grâce à laquelle il est davantage probable qu’il soit en accord avec les
affirmations de Séjanus.
Le volume de parole est aussi réparti de façon à ce que les
arguments de Séjanus soient mis en avant.
C’est lui qui a le dernier mot et arrête le
dialogue par une conclusion à ses arguments : “Vivant, parce qu’on est, mort, parce
qu’on est rien.”(l.35).
Ce paradoxe, qui décrit une réalité sur la vie, permet de
stimuler la réflexion du lecteur/spectateur.
L’auteur s’est donc servi de cette scène
comme plaidoyer pour défendre sa pensée.....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- MÉTHODOLOGIE DU COMMENTAIRE DE PHILOSOPHIE
- La mort de Jules César
- ROME, OU LE CULTE DE LA MORT VOLONTAIRE
- commentaire philo Leibniz Monadologie et la justice
- commentaire de texte thérèse desqueroux