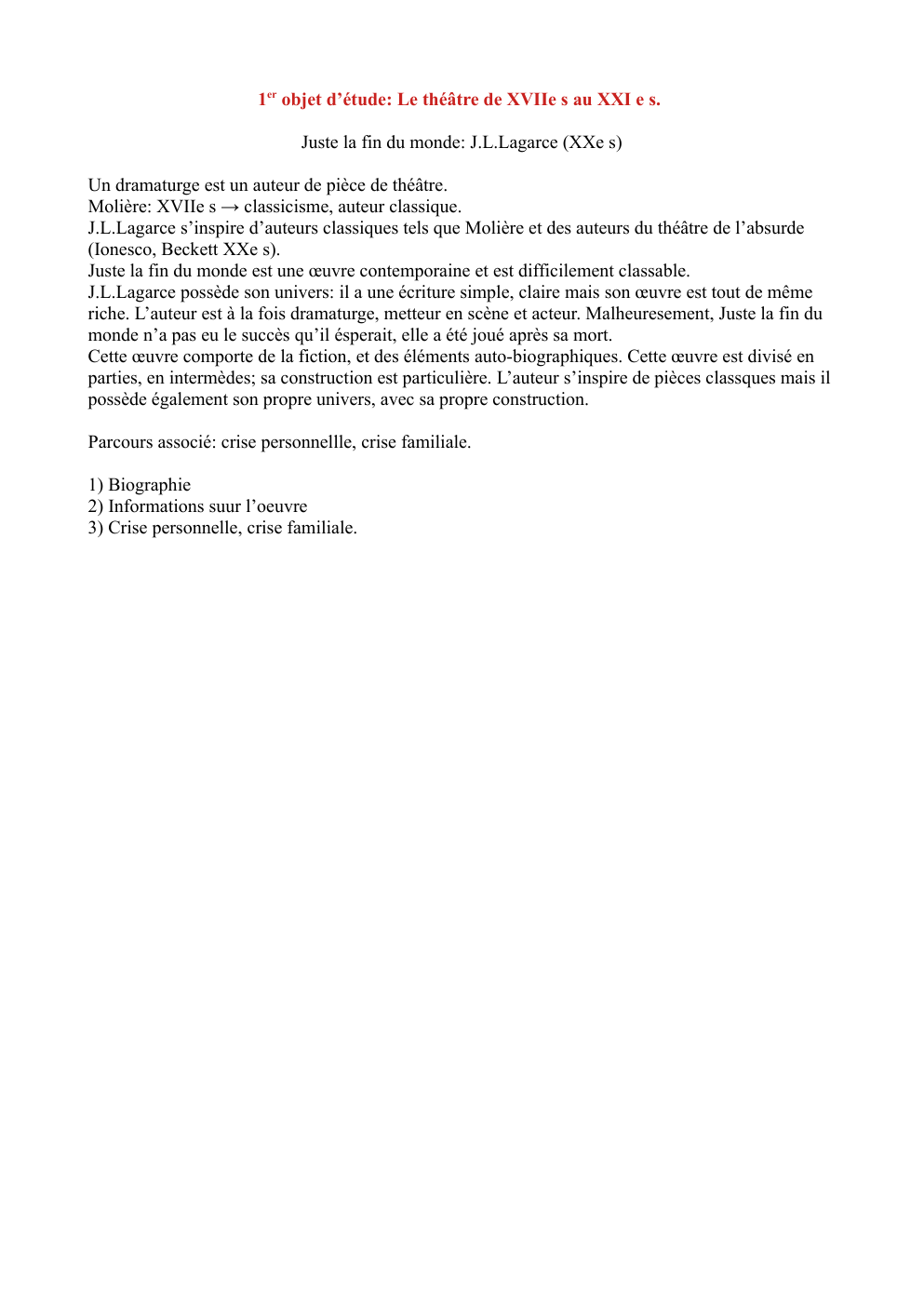1er objet d'étude: le théâtre
Publié le 09/03/2025
Extrait du document
«
1er objet d’étude: Le théâtre de XVIIe s au XXI e s.
Juste la fin du monde: J.L.Lagarce (XXe s)
Un dramaturge est un auteur de pièce de théâtre.
Molière: XVIIe s → classicisme, auteur classique.
J.L.Lagarce s’inspire d’auteurs classiques tels que Molière et des auteurs du théâtre de l’absurde
(Ionesco, Beckett XXe s).
Juste la fin du monde est une œuvre contemporaine et est difficilement classable.
J.L.Lagarce possède son univers: il a une écriture simple, claire mais son œuvre est tout de même
riche.
L’auteur est à la fois dramaturge, metteur en scène et acteur.
Malheuresement, Juste la fin du
monde n’a pas eu le succès qu’il ésperait, elle a été joué après sa mort.
Cette œuvre comporte de la fiction, et des éléments auto-biographiques.
Cette œuvre est divisé en
parties, en intermèdes; sa construction est particulière.
L’auteur s’inspire de pièces classques mais il
possède également son propre univers, avec sa propre construction.
Parcours associé: crise personnellle, crise familiale.
1) Biographie
2) Informations suur l’oeuvre
3) Crise personnelle, crise familiale.
Commentaire
1.
Lire plusieurs fois le texte
2.
Éxaminer l’objet d’étude, le paratexte (élément autour du texte)
3.
Noter vos impressions et vos idées sur le cahier de brouillon
4.
Questionner le texte: qui?où?quand?comment?pourquoi? Situation d’énonciation:Qui s’adresse à
qui? Quel est le sens du texte? Quel est l’intêret du texte?Quels sont les temps verbaux
prédominants? Quelles sont les tonalités du texte? Quels sont les symboles? Qu’est ce qui nous
surprend? Quels sont les enjeux (objectifs) du texte? Quelles sont les spécificités de ce passage?
5.
Repérer des procédés d’écriture dominants sur le texte qui sont accompagnés chacun d’une idée.
6.
Chercher une ou plusieurs problématiques à partir de tout ce qui a été noté → il faudra en
selectionner une.
7.
Faire un plan détaillé à partir de la problématique.
Astuce: Si vous retrouvez les mots clés de la problématique dans les grandes parties, c’est que vous
répondez correctement à la problématique.
Il faut retrouver les mots clés du titre de la première partie dans son explication.
Idée + procédé
Commentaire: explication + interprétation: on explique le texte et les sens
(devoir argumentatif)
À éviter: la paraphrase, ce n’est pas une narration.
Si on répète dans l’idée les mots du texte, c’est
qu’il y a un problème.
Un paragraphe argumentatif: idée + des exemples
L’idée est satisfaisante que si elle est claire et précise.
Commencer le paragraphe par un connecteur, on saute une ligne entre la première grande partie et la
deuxième grande partie.
On met un alinéa entre chaque paragraphe (petit 1).
Quand on a ecrit une premiere grande partie, il faut résumer très briévèment et annoncer la suite,
c’est une transition.
Dans un commentaire, on peut faire un rapprochement/une ouverture avec une
autre œuvre (texte (il faut que ce soit précis et développé un peu), une question… ),
Andromaque, Jean Racine, XVIIème siècle
1er objet d’étude: le théâtre du XVIIème au XXI ème siècle
Parcours associé: crise personelle, crise familiale
Tragédie classique
Racine: dramaturge, auteur de tragédies
Tragédies de Racines: Phèdre; Bérénice; Britanicus; Iphigénie.
Les auteurs classiques s’inspiraient des auteurs antiques.
Jean Racine est le plus illustre représentant de la tragédie classique française.
Andromage, 1667, est
le premiès succès de Racine.
Cette pièce s’organise autour d’une chaîne d’amour contrariés.
L’extrait est un monologue qui ouvre le dernier acte (V).
Hermione a contraint Oreste d’assasiner
Pyrrhus.
Problématique:
Comment Racine entretient-il la tension dramatique dans ce monologue?
Plan détaillé:
I.
Le monologue masque des évenements cruciaux qui se déroulent hors-scène.
1.
En vertue du principe de bienséance, un assasinat ne peut pas être représenter sur scène.
2.
Les circonstances qui aboutissent à la crise tragique sont rappelées.
3.
Hermione annonce l’imminence du dénouement.
II.
Hermione exprime des sentiments excessifs et contradictoires.
1.
Les sentiments sont troublés (rythme haché, rupture syntaxique).
2.
Le personnage féminin met en avant sa souffrance intérieur (champ lexical de la douleur) et se
montre dominée par elle.
3.
Hermione formule des sentiments contradictoires (antithèse amour/haine).
III.
Le personnage révèle ses hésitations.
1.
L’odre donné n’est pas assumé (question rhétorique, prééminance du coeur).
2.
Herminone argumente pour se convaincre elle-même de la légitimité de son ordre.
3.
Le rappel nostalgique du passé entraine le retournement final.
Conclusion:
Racine entretient la tension dramatique en exploitant les différentes fonctions du monologue:
Substitut à l’action, lyrisme du personnage.
Il viendra → futur simple
Il va venir → futur proche
En commentaire, on utilise le présent et non le futur proche.
La dissertation:
Sur une œuvre complète, donc il faudra utiliser des exemples sur cette œuvre
•
•
•
•
•
•
Lire le sujet (citation, une question, les deux)
Noter vos impressions
Analyser le sujet, questionner le sujet (intêret, thèmes, qui, comment… )
Entourer les mots clés du sujet, puis les définir pour être sur du sens
Noter: idée+exemple (littéraire) → qui répondent à la question (précis et développés)
Faire un plan pour ordonner nos idées
Explication linéaire – Oral
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Une brève introduction
Lecture à voix haute de l’extrait
Annoncer la problématique/projet de lecture
Annonce des mouvements
Rappeler l’intitulé du premier mouvement et indiquer sa délimitation (ligne à ligne…)
Explication du premier mouvement
Passer au deuxième mouvement
Recommencer pour chaque mouvement
Courte conclusion
1er objet d’étude: le théâtre
Sujet de dissertation n°1
Un critique contemporain écrit au sujet du théâtre de Jean-Luc Lagarce que bien souvent, la «crise»
a déjà eu lieu avant que ne commence l’action.
Ce propos vous semble-t-il rendre compte de la
pièce de Jean Luc Lagarce, Juste la fin du monde?
I.
Une dramaturgie rétrospective (une histoire théâtrale liée au passé): la crise passé envahit le
présent scénique.
La pièce de Jean Luc Lagarce déploie sous nos yeux une action qui n’en est pass tout à fait
une: il ne se passe presque rien.
Entre l’annonce faite par Louis dans le prologue de dire sa mort
prochaine et l’épilogue qui montre que ce projet n’a pas été accompli, il ne semble pas effet pas n’y
avoir d’action au présent.
Bien au contraire, les discours des personnages sont sans cesse tournés
vers le passé: Suzanne évoque ce qu’elle est devenue en l’absence de Louis (partie 1 scène 3), la
mère raconte «l’histoire d’avant» (partie 1 scène 4), Antoine revient sur la rivalité entre les deux
frères, qui remonte à l’enfance (partie 2, scène 3 et 4) si bien que la crise semble en effet avoir déjà
eu lieu.
Celle-ci peut être entendue de plusieurs façons: elle peut renvoyer au départ de Louis qui a
conduit à l’éclatement de la famille et à la fin de l’âge d’or raconté par la mère.
Elle peut renvoyer
plus précisément à la rivalité entre les deux frères qui a éclaté dès leur plus jeune âge.
Le conflit opposant des frères ennemis a d’ailleurs déjà eu lieu en litératture: on le trouve
dans la bible – Caïn tue son frère Abel – mais également dans un certain nombre de pièces antiques
et classiques – Étéocle et Polynice s’entretuent dans les Sept contre Thèbes (d’Eschyle) ou dans la
Thébaïde de Racine; Brittanicus est mis à mort par son frère Néro.
Lorsque Jean Luc Lagarce
reprend ce thème dans Juste la fin du monde, c’est encore une façon de tourner celle-ci vers le
passé, de porter un regard en arrière.
Ainsi, la crise semble en effet appartenir à un autre temps que le temps scénique, celui de la
représentation, et paraît s’inscrire en amont de l’action mise en scène au présent par la pièce.
II.
Crise personnelle, crise familiale, crise du langage
En effet, si la dramaturgie de Juste la fin du monde est tournée plutôt vers le passé, on ne
peut ignorer cependant qu’il y a bien des crises pendant le déroulement de la pièce: l’une
personnelle, l’autre familiale, une troisième plus générale affecte de la même façon la totalité des
personnages.
La crise personnelle est d’abord la crise identitaire de Louis: il est en effet jeté dans une
situation critique – celle de savoir qu’il va mourir.
Cette situation de trouble provoque en lui une
décision, celle de revoir les siens.
Le prologue de la pièce souligne cette volonté de revenir chez lui,
«je décidai».
Les différents monologues de la pièce, tous attribués à Louis, montrent bien un
personnage troublé, perturbé, apeuré et hanté par la mort (deuxième partie).
C’est toute la pièce qui
peut être interprétée comme la projection sur scène de l’intériorité bouleversé du personnage: Juste
la fin du monde serait un monodrame donnant accès à une crise intérieure.
1er objet d’étude:....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Étude linéaire du Préambule la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne Olympe de Gouges
- Le théâtre, continuité et renouvellement
- Manon Lescaut extrait 1 étude linéaire: Explication linéaire, extrait 1 : « J'avais marqué le temps de mon départ … ses malheurs et les miens. »
- L'Horloge de Baudelaire - étude linéaire
- étude linéaire exhortation aux hommes olympe de gouge