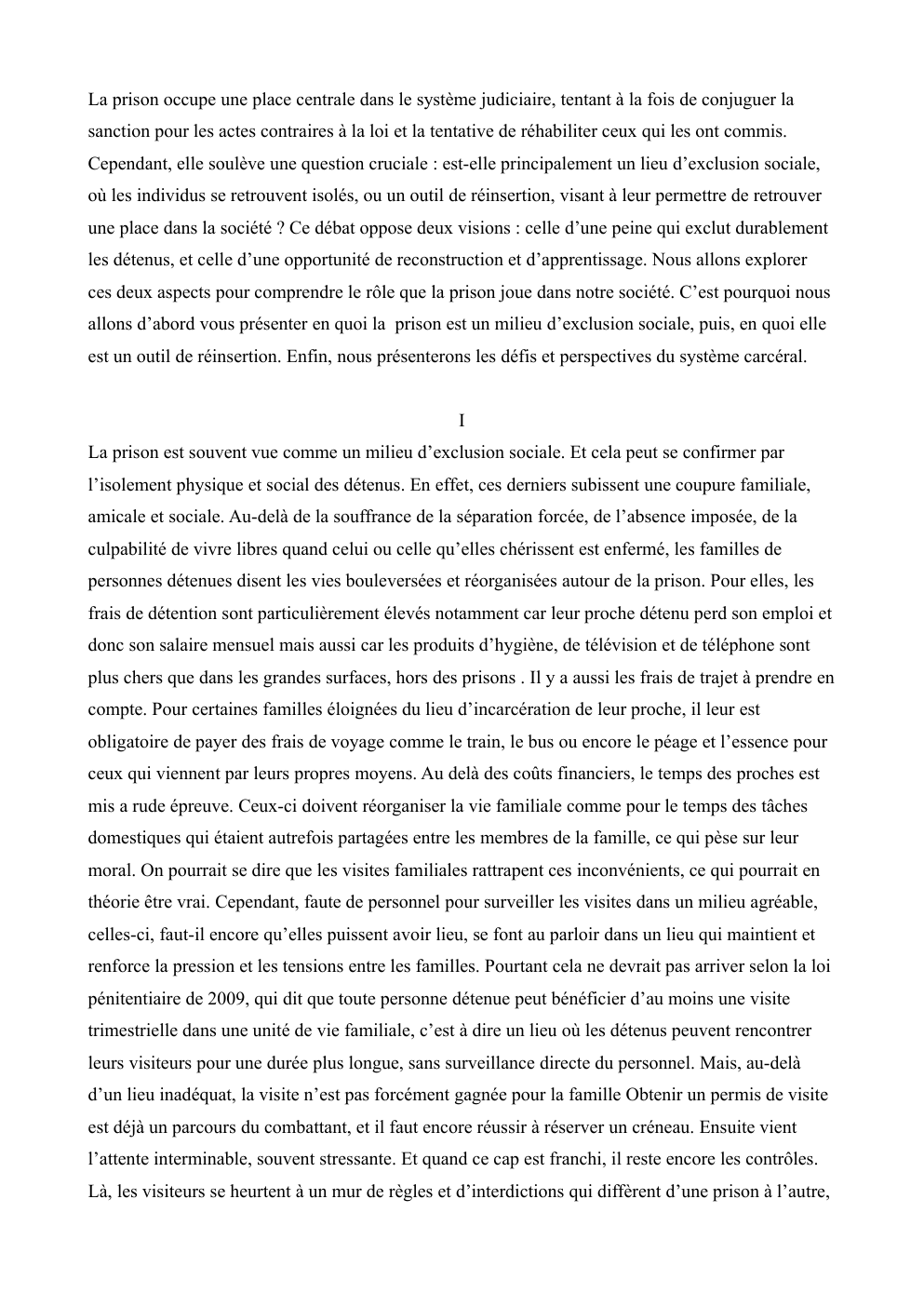Exposé prison : exclusion ou réinsertion ?
Publié le 26/06/2025
Extrait du document
«
La prison occupe une place centrale dans le système judiciaire, tentant à la fois de conjuguer la
sanction pour les actes contraires à la loi et la tentative de réhabiliter ceux qui les ont commis.
Cependant, elle soulève une question cruciale : est-elle principalement un lieu d’exclusion sociale,
où les individus se retrouvent isolés, ou un outil de réinsertion, visant à leur permettre de retrouver
une place dans la société ? Ce débat oppose deux visions : celle d’une peine qui exclut durablement
les détenus, et celle d’une opportunité de reconstruction et d’apprentissage.
Nous allons explorer
ces deux aspects pour comprendre le rôle que la prison joue dans notre société.
C’est pourquoi nous
allons d’abord vous présenter en quoi la prison est un milieu d’exclusion sociale, puis, en quoi elle
est un outil de réinsertion.
Enfin, nous présenterons les défis et perspectives du système carcéral.
I
La prison est souvent vue comme un milieu d’exclusion sociale.
Et cela peut se confirmer par
l’isolement physique et social des détenus.
En effet, ces derniers subissent une coupure familiale,
amicale et sociale.
Au-delà de la souffrance de la séparation forcée, de l’absence imposée, de la
culpabilité de vivre libres quand celui ou celle qu’elles chérissent est enfermé, les familles de
personnes détenues disent les vies bouleversées et réorganisées autour de la prison.
Pour elles, les
frais de détention sont particulièrement élevés notamment car leur proche détenu perd son emploi et
donc son salaire mensuel mais aussi car les produits d’hygiène, de télévision et de téléphone sont
plus chers que dans les grandes surfaces, hors des prisons .
Il y a aussi les frais de trajet à prendre en
compte.
Pour certaines familles éloignées du lieu d’incarcération de leur proche, il leur est
obligatoire de payer des frais de voyage comme le train, le bus ou encore le péage et l’essence pour
ceux qui viennent par leurs propres moyens.
Au delà des coûts financiers, le temps des proches est
mis a rude épreuve.
Ceux-ci doivent réorganiser la vie familiale comme pour le temps des tâches
domestiques qui étaient autrefois partagées entre les membres de la famille, ce qui pèse sur leur
moral.
On pourrait se dire que les visites familiales rattrapent ces inconvénients, ce qui pourrait en
théorie être vrai.
Cependant, faute de personnel pour surveiller les visites dans un milieu agréable,
celles-ci, faut-il encore qu’elles puissent avoir lieu, se font au parloir dans un lieu qui maintient et
renforce la pression et les tensions entre les familles.
Pourtant cela ne devrait pas arriver selon la loi
pénitentiaire de 2009, qui dit que toute personne détenue peut bénéficier d’au moins une visite
trimestrielle dans une unité de vie familiale, c’est à dire un lieu où les détenus peuvent rencontrer
leurs visiteurs pour une durée plus longue, sans surveillance directe du personnel.
Mais, au-delà
d’un lieu inadéquat, la visite n’est pas forcément gagnée pour la famille Obtenir un permis de visite
est déjà un parcours du combattant, et il faut encore réussir à réserver un créneau.
Ensuite vient
l’attente interminable, souvent stressante.
Et quand ce cap est franchi, il reste encore les contrôles.
Là, les visiteurs se heurtent à un mur de règles et d’interdictions qui diffèrent d’une prison à l’autre,
d’un surveillant à l’autre.
Celles-ci semblent parfois incohérentes et diffèrent également en fonction
des prisons.
Parmi ces interdictions, il y a l’interdiction d’apporter de la nourriture.
Elle empêche de recréer un
moment de partage, de redonner un peu de chaleur et de réconfort à une relation souvent mise à
rude épreuve par la séparation.
Certains prennent le risque de contourner cette règle, même si cela
peut leur coûter leur droit de visite.
Une fois les contrôles passés, la rencontre tant attendue peut
enfin commencer.
Mais dans quelles conditions ? Des locaux insalubres, des cabines minuscules à
l’hygiène douteuse, des parloirs collectifs où l’absence de cloisons rend toute intimité impossible.
Sous le regard parfois intrusif des surveillants, chaque minute compte.
En maison d’arrêt, les
familles n’ont souvent droit qu’à une demi-heure, quarante-cinq minutes au mieux, pour partager un
peu de temps avec un être cher.
Des années à vivre les parloirs dans de telles conditions, cela finit
par user.
Les prisonniers déclarent même qu’au bout d’un moment, les proches ne rendent plus
visite.
En effet, seuls 25 % des condamnés à des peines de plus de cinq ans reçoivent une visite
hebdomadaire.
Le téléphone pourrait être une alternative, mais les appels sont surtaxés, et les
cabines téléphoniques ne sont accessibles que sur des plages horaires limitées et aux heures où les
proches sont au travail ou à l’école.
Pour ne rien arranger, ces cabines se trouvent souvent dans des
lieux de passage.
L’intimité n’est qu’un lointain souvenir, d’autant que les appels peuvent être
écoutés et enregistrés.
Reste alors le courrier, dernier lien avec l’extérieur.
Mais là aussi, rien n’est
simple.
Les lettres peuvent être ouvertes, lues, et les échanges surveillés.
C’est donc un lien fragile
et filtré.
Au delà des liens familiaux, c’est la santé physique et mentale qui se dégrade.
Vivre en prison est
une expérience marquée par des souffrances multiples.
Dès l’arrivée, le détenu est confronté à une
perte brutale de son identité : ses biens personnels lui sont retirés, il est soumis à des fouilles et
plongé dans une rupture complète avec l’extérieur.
Cette étape agit comme un effacement de soi.
La
prison engendre des problèmes divers.
Le stress et l’angoisse, constants, provoquent des symptômes
physiques comme des problèmes dermatologiques ou des troubles liés à la sédentarité.
Psychologiquement, les détenus présentent des taux élevés de dépression, de troubles de la
personnalité ou encore de psychoses, bien au-delà de ceux observés dans la population générale.
À
cela s’ajoute un cadre de vie souvent insalubre et surpeuplé.
La proximité, l’ancienneté des
infrastructures et le manque d’intimité augmentent la violence et la détresse.
La promiscuité
constante impose une proximité physique forcée qui franchit les limites personnelles.
L’enfermement s’accompagne d’un sentiment de disparition dans la masse carcérale.
Le détenu perd
non seulement son espace personnel mais aussi la possibilité de se projeter dans le temps.
La
multiplication des attentes, l’absence de contrôle sur son environnement, et le sentiment d’être
observé en permanence alimentent cette souffrance.
De plus, les détenus sont souvent stigmatisés et
ce bien avant qu’ils ne soient officiellement considérés comme délinquants.
Cette étiquette, souvent
attribuée de manière diffuse, influence les trajectoires futures en enfermant l’individu dans une
image difficile à briser.
II
Avec de tels problèmes au sein du milieu carcéral, accompagner les détenus vers la réinsertion
sociale est une mission cruciale pour prévenir la récidive et réduire les inégalités sociales renforcées
par l’incarcération.
Les statistiques sont alarmantes : près de 63 % des anciens détenus qui ne
bénéficient pas d’un suivi adapté récidivent dans les cinq ans suivant leur libération.
Ces chiffres
reflètent une réalité souvent dramatique : de nombreux sortants de prison, notamment des jeunes, se
retrouvent sans ressources, sans formation, et parfois aux prises avec des addictions non traitées.
Cette situation les laisse encore plus fragilisés psychologiquement et socialement qu’à leur entrée
en détention, piégés dans une spirale de précarité.
En France, la loi pénitentiaire de 2009 impose
une obligation d’activité à toute personne incarcérée.
Pourtant, ce principe rencontre de nombreux
obstacles dans sa mise en œuvre, notamment en raison de la surpopulation carcérale et du manque
d’opportunités offertes dans les établissements pénitentiaires.
En prison les détenus peuvent travailler pour l’administration pénitentiaire, via des tâches liées au
fonctionnement des établissements (cuisine, blanchisserie, nettoyage), des entreprises privées,
souvent pour des activités de sous-traitance (assemblage, conditionnement) ou des structures
d’insertion par l’activité économique, destinées aux personnes éloignées de l’emploi.
Malgré ces
dispositifs, seulement 31 % des détenus occupent un emploi, un taux en déclin par rapport aux
décennies précédentes.
Le manque d’ateliers disponibles, la baisse de l’employabilité des détenus et
les contraintes de sécurité freinent l’accès au travail.
En outre la rémunération reste très inférieure
aux standards extérieurs, avec une moyenne de 2,23 à 5,26 euros par heure.
Le faible niveau de qualification des personnes incarcérées rend l’accès à la formation et à
l’éducation essentiel.
Seuls 15 % des détenus bénéficiaient d’une formation en 2018, alors que près
de la moitié étaient sans diplôme.
La loi de 2014 a confié aux régions la responsabilité de financer
et d’organiser ces formations, permettant une meilleure adaptation locale.
Environ 29 % des détenus
suivent une scolarité en détention.
Les cours, prioritairement destinés aux jeunes et aux personnes
sans diplôme, sont dispensés par des enseignants de l’Éducation nationale.
L’objectif est de combler
des lacunes importantes, notamment en français, tout en favorisant une réinsertion durable.
Les activités culturelles et sportives sont aussi des moyens de réinsertion.
En effet, les activités
artistiques et culturelles, organisées avec le soutien du ministère de la Culture, offrent aux détenus
une opportunité d’évasion....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Exposé peine de mort: ABOLITION DE LA PEINE DE MORT EN FRANCE
- exposé sur le spleen baudelairien
- Exposé phénoménologie
- L'exclusion sociale dans le village de la honte de Soro Guéfala
- Exposé Phèdre de Racine (résumé et analyse)