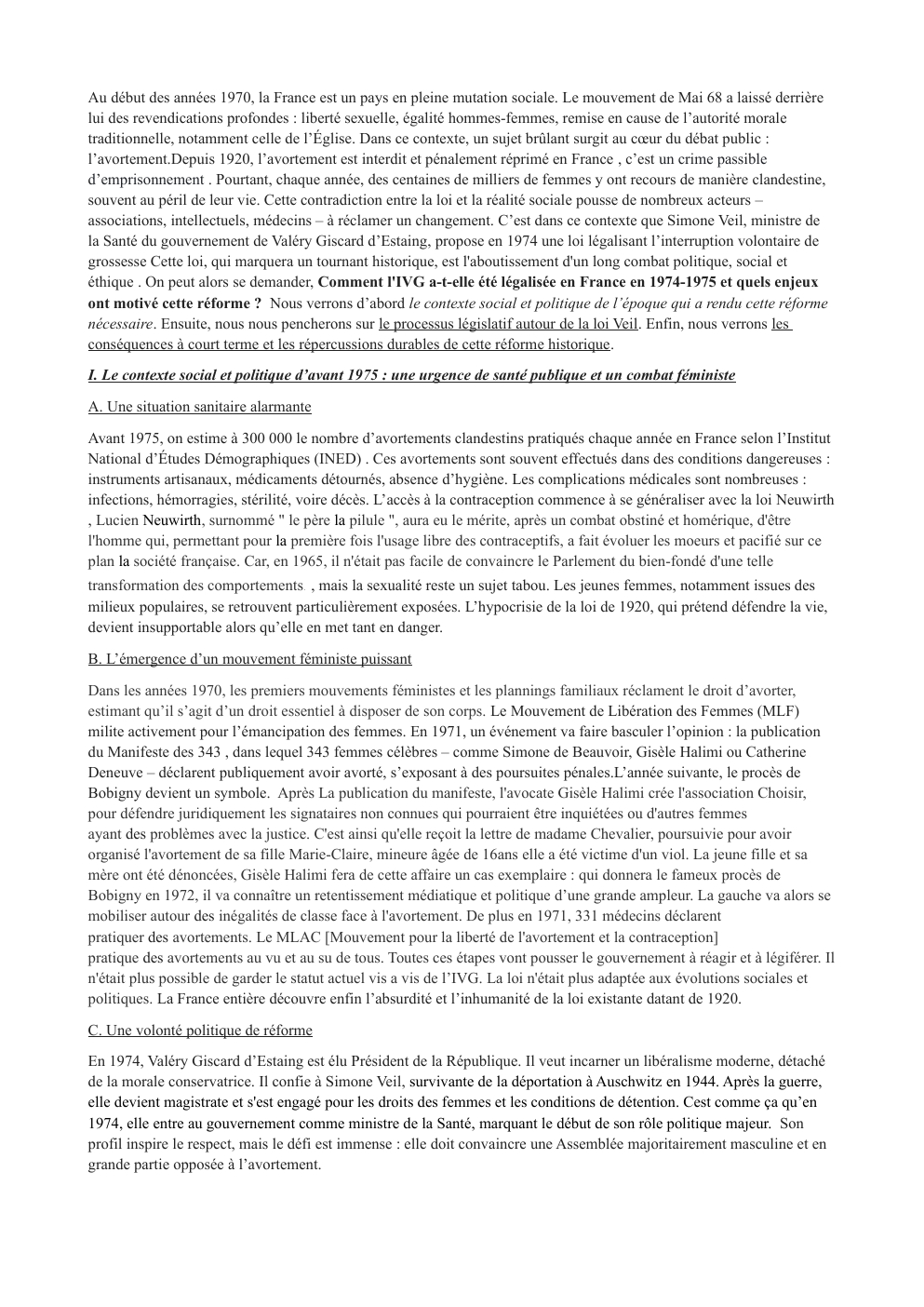exposé loi veil
Publié le 25/05/2025
Extrait du document
«
Au début des années 1970, la France est un pays en pleine mutation sociale.
Le mouvement de Mai 68 a laissé derrière
lui des revendications profondes : liberté sexuelle, égalité hommes-femmes, remise en cause de l’autorité morale
traditionnelle, notamment celle de l’Église.
Dans ce contexte, un sujet brûlant surgit au cœur du débat public :
l’avortement.Depuis 1920, l’avortement est interdit et pénalement réprimé en France , c’est un crime passible
d’emprisonnement .
Pourtant, chaque année, des centaines de milliers de femmes y ont recours de manière clandestine,
souvent au péril de leur vie.
Cette contradiction entre la loi et la réalité sociale pousse de nombreux acteurs –
associations, intellectuels, médecins – à réclamer un changement.
C’est dans ce contexte que Simone Veil, ministre de
la Santé du gouvernement de Valéry Giscard d’Estaing, propose en 1974 une loi légalisant l’interruption volontaire de
grossesse Cette loi, qui marquera un tournant historique, est l'aboutissement d'un long combat politique, social et
éthique .
On peut alors se demander, Comment l'IVG a-t-elle été légalisée en France en 1974-1975 et quels enjeux
ont motivé cette réforme ? Nous verrons d’abord le contexte social et politique de l’époque qui a rendu cette réforme
nécessaire.
Ensuite, nous nous pencherons sur le processus législatif autour de la loi Veil.
Enfin, nous verrons les
conséquences à court terme et les répercussions durables de cette réforme historique.
I.
Le contexte social et politique d’avant 1975 : une urgence de santé publique et un combat féministe
A.
Une situation sanitaire alarmante
Avant 1975, on estime à 300 000 le nombre d’avortements clandestins pratiqués chaque année en France selon l’Institut
National d’Études Démographiques (INED) .
Ces avortements sont souvent effectués dans des conditions dangereuses :
instruments artisanaux, médicaments détournés, absence d’hygiène.
Les complications médicales sont nombreuses :
infections, hémorragies, stérilité, voire décès.
L’accès à la contraception commence à se généraliser avec la loi Neuwirth
, Lucien Neuwirth, surnommé " le père la pilule ", aura eu le mérite, après un combat obstiné et homérique, d'être
l'homme qui, permettant pour la première fois l'usage libre des contraceptifs, a fait évoluer les moeurs et pacifié sur ce
plan la société française.
Car, en 1965, il n'était pas facile de convaincre le Parlement du bien-fondé d'une telle
transformation des comportements.
, mais la sexualité reste un sujet tabou.
Les jeunes femmes, notamment issues des
milieux populaires, se retrouvent particulièrement exposées.
L’hypocrisie de la loi de 1920, qui prétend défendre la vie,
devient insupportable alors qu’elle en met tant en danger.
B.
L’émergence d’un mouvement féministe puissant
Dans les années 1970, les premiers mouvements féministes et les plannings familiaux réclament le droit d’avorter,
estimant qu’il s’agit d’un droit essentiel à disposer de son corps.
Le Mouvement de Libération des Femmes (MLF)
milite activement pour l’émancipation des femmes.
En 1971, un événement va faire basculer l’opinion : la publication
du Manifeste des 343 , dans lequel 343 femmes célèbres – comme Simone de Beauvoir, Gisèle Halimi ou Catherine
Deneuve – déclarent publiquement avoir avorté, s’exposant à des poursuites pénales.L’année suivante, le procès de
Bobigny devient un symbole.
Après La publication du manifeste, l'avocate Gisèle Halimi crée l'association Choisir,
pour défendre juridiquement les signataires non connues qui pourraient être inquiétées ou d'autres femmes
ayant des problèmes avec la justice.
C'est ainsi qu'elle reçoit la lettre de madame Chevalier, poursuivie pour avoir
organisé l'avortement de sa fille Marie-Claire, mineure âgée de 16ans elle a été victime d'un viol.
La jeune fille et sa
mère ont été dénoncées, Gisèle Halimi fera de cette affaire un cas exemplaire : qui donnera le fameux procès de
Bobigny en 1972, il va connaître un retentissement médiatique et politique d’une grande ampleur.
La gauche va alors se
mobiliser autour des inégalités de classe face à l'avortement.
De plus en 1971, 331 médecins déclarent
pratiquer des avortements.
Le MLAC [Mouvement pour la liberté de l'avortement et la contraception]
pratique des avortements au vu et au su de tous.
Toutes ces étapes vont pousser le gouvernement à réagir et à légiférer.
Il
n'était plus possible de garder le statut actuel vis a vis de l’IVG.
La loi n'était plus adaptée aux évolutions sociales et
politiques.
La France entière découvre enfin l’absurdité et l’inhumanité de la loi existante datant de 1920.
C.
Une volonté politique de réforme
En 1974, Valéry Giscard d’Estaing est élu Président de la République.
Il veut incarner un libéralisme moderne, détaché
de la morale conservatrice.
Il confie à Simone Veil, survivante de la déportation à Auschwitz en 1944.
Après la guerre,
elle devient magistrate et s'est engagé pour les droits des femmes et les conditions de détention.
Cest comme ça qu’en
1974, elle entre au gouvernement comme ministre de la Santé, marquant le début de son rôle politique majeur.
Son
profil inspire le respect, mais le défi est immense : elle doit convaincre une Assemblée majoritairement masculine et en
grande partie opposée à l’avortement.
II.
La loi Veil : un débat parlementaire historique
A.
Un discours courageux et marquant
Le 26 novembre 1974, Simone Veil, alors ministre de la Santé dans le gouvernement de Jacques Chirac (Premier
ministre), sous la présidence de Valéry Giscard d’Estaing, défend à la tribune de l’Assemblée nationale le projet de loi
légalisant l’interruption volontaire de grossesse (IVG).
Ce discours, prononcé dans une Assemblée presque
exclusivement masculine, restera dans les mémoires comme l’un des plus marquants de la Ve République.Dès ses
premières phrases, Simone Veil choisit une posture à la fois personnelle et universelle.
Elle s’adresse à ses collègues
parlementaires avec une profonde sincérité :
« Je voudrais tout d’abord vous faire partager une conviction de femme – je m’excuse de le faire devant
cette Assemblée presque exclusivement composée d’hommes : aucune femme ne recourt de gaieté de
cœur à l’avortement.
»
Par ces mots, elle exprime la réalité vécue par des centaines de milliers de femmes en France, contraintes d’avorter dans
la clandestinité, souvent dans la peur, la douleur et au péril de leur santé.
À cette époque, on estime qu’environ 300 000
à 400 000 avortements illégaux sont pratiqués chaque année, causant des milliers de complications médicales.Simone
Veil refuse toute approche idéologique du sujet.
Pour elle, légaliser l’avortement n’est pas une incitation, mais une
nécessité sanitaire, sociale et humaine.
Elle affirme que le but de la loi est de rendre l’avortement plus rare, plus sûr, et
mieux encadré, et non d’en faire un acte banal.
Elle assume ce paradoxe : en autorisant l’IVG, on peut mieux prévenir
les situations de détresse et encourager la prévention par l’éducation sexuelle et la contraception.
B.
Une bataille parlementaire tendue et violente
Le débat parlementaire s’ouvre dans une atmosphère extrêmement tendue.
Les échanges durent plus de 25 heures, et
révèlent des clivages profonds au sein de la société française.De nombreux députés de droite, notamment issus du
Rassemblement pour la République (RPR) ou de l’aile conservatrice de l’Union pour la démocratie française (UDF),
s’opposent violemment au texte.
Certains vont jusqu’à comparer l’avortement à un “crime contre l’humanité”, une
référence choquante au regard du passé de déportée de Simone Veil, qui a survécu aux camps de concentration nazis.
D’autres dénoncent un risque de “dérive eugéniste”, accusant la loi d’ouvrir la porte à une société qui sélectionnerait les
naissances.Malgré ces attaques parfois d’une rare violence, Simone Veil reste calme et digne.
Son courage force le
respect, y compris chez certains de ses adversaires.
Durant cette période, elle reçoit également des courriers anonymes,
des insultes, et même des menaces de mort, souvent teintées d’un antisémitisme virulent.Face à cette opposition, la
gauche apporte un soutien clair au projet.
François Mitterrand, alors premier secrétaire du Parti socialiste et chef de
l’opposition, demande à ses députés de voter en faveur de la loi.
Il est rejoint par d’autres figures majeures de la
gauche :Robert Badinter, juriste et futur ministre de la Justice, Michel Rocard, député socialiste, Jacques Delors, député
PS et futur président de la Commission européenne.Du côté de la majorité, certaines figures centristes comme Jean
Lecanuet, président du Centre des démocrates sociaux, apportent aussi leur soutien, rompant avec une partie de leur
camp.
Le 29 novembre 1974, après des jours de débats enflammés, la loi est adoptée à l’Assemblée nationale par 284
voix contre 189.
Elle sera ensuite adoptée au Sénat et promulguée le 17 janvier 1975.
C.
Le contenu et la portée de la loi
La loi dite "Veil" ne crée pas un droit illimité à l’avortement, mais elle encadre strictement sa pratique.
Voici ses
principales dispositions :
• L’IVG est autorisée jusqu’à la 10e semaine de grossesse (ce délai sera prolongé à 14 semaines en 2001, puis à
16 semaines en 2022).
• L’acte doit être réalisé en milieu hospitalier, par un médecin habilité.
• Un entretien médical préalable est obligatoire, afin d’informer la patiente sur les alternatives et les aides
possibles.
• Un délai de réflexion de 8 jours est imposé entre la demande d’avortement et l’intervention.
• Les professionnels de santé peuvent invoquer une clause de conscience, mais doivent orienter la patiente vers
un autre praticien.
III.
Une loi aux conséquences majeures et toujours....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- « La loi de l’homme est la loi du langage » JACQUES LACAN
- Exposé peine de mort: ABOLITION DE LA PEINE DE MORT EN FRANCE
- exposé sur le spleen baudelairien
- Exposé phénoménologie
- La liberté peut-elle être sans loi ?