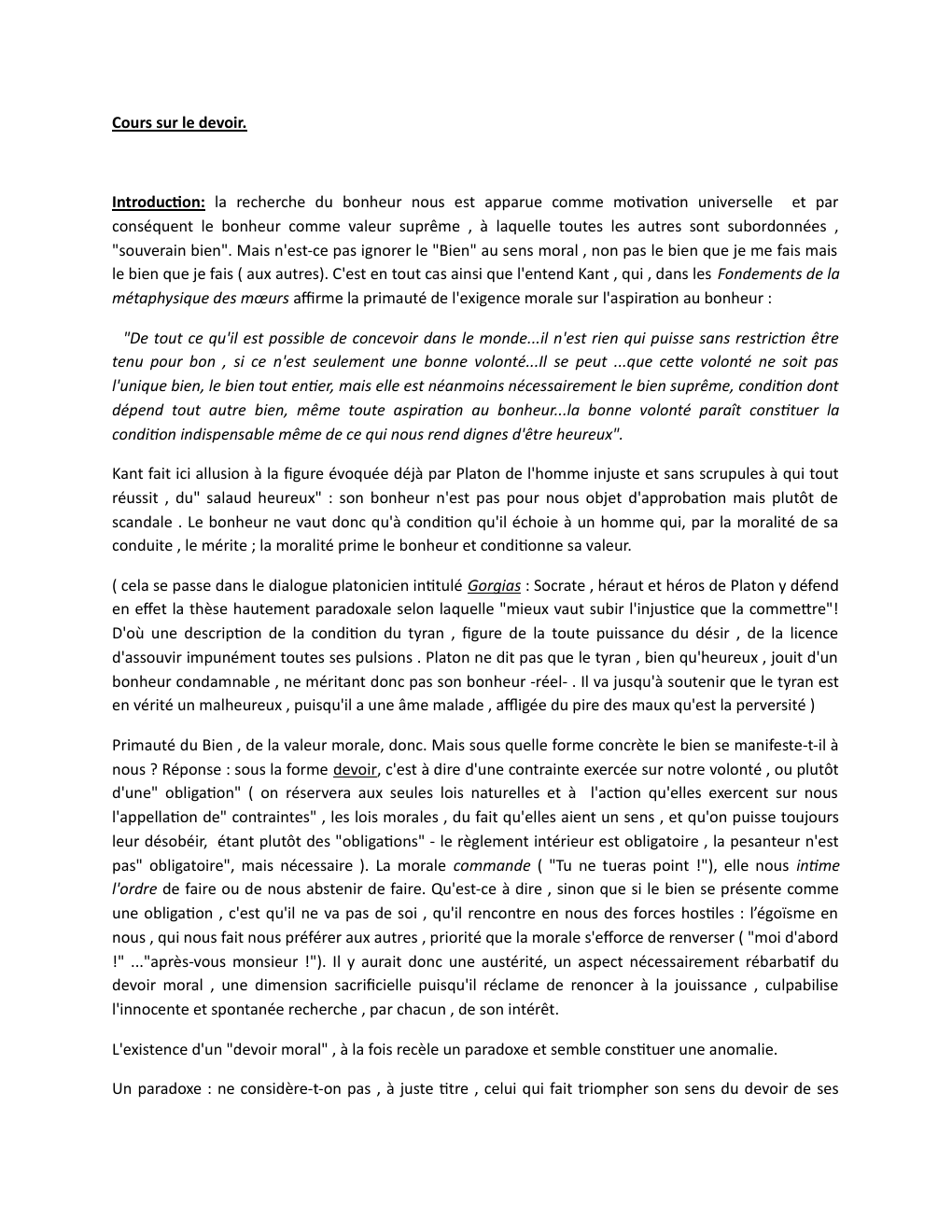Le devoir cour de philosophie
Publié le 10/04/2025
Extrait du document
«
Cours sur le devoir.
Introduction: la recherche du bonheur nous est apparue comme motivation universelle et par
conséquent le bonheur comme valeur suprême , à laquelle toutes les autres sont subordonnées ,
"souverain bien".
Mais n'est-ce pas ignorer le "Bien" au sens moral , non pas le bien que je me fais mais
le bien que je fais ( aux autres).
C'est en tout cas ainsi que l'entend Kant , qui , dans les Fondements de la
métaphysique des mœurs affirme la primauté de l'exigence morale sur l'aspiration au bonheur :
"De tout ce qu'il est possible de concevoir dans le monde...il n'est rien qui puisse sans restriction être
tenu pour bon , si ce n'est seulement une bonne volonté...Il se peut ...que cette volonté ne soit pas
l'unique bien, le bien tout entier, mais elle est néanmoins nécessairement le bien suprême, condition dont
dépend tout autre bien, même toute aspiration au bonheur...la bonne volonté paraît constituer la
condition indispensable même de ce qui nous rend dignes d'être heureux".
Kant fait ici allusion à la figure évoquée déjà par Platon de l'homme injuste et sans scrupules à qui tout
réussit , du" salaud heureux" : son bonheur n'est pas pour nous objet d'approbation mais plutôt de
scandale .
Le bonheur ne vaut donc qu'à condition qu'il échoie à un homme qui, par la moralité de sa
conduite , le mérite ; la moralité prime le bonheur et conditionne sa valeur.
( cela se passe dans le dialogue platonicien intitulé Gorgias : Socrate , héraut et héros de Platon y défend
en effet la thèse hautement paradoxale selon laquelle "mieux vaut subir l'injustice que la commettre"!
D'où une description de la condition du tyran , figure de la toute puissance du désir , de la licence
d'assouvir impunément toutes ses pulsions .
Platon ne dit pas que le tyran , bien qu'heureux , jouit d'un
bonheur condamnable , ne méritant donc pas son bonheur -réel- .
Il va jusqu'à soutenir que le tyran est
en vérité un malheureux , puisqu'il a une âme malade , affligée du pire des maux qu'est la perversité )
Primauté du Bien , de la valeur morale, donc.
Mais sous quelle forme concrète le bien se manifeste-t-il à
nous ? Réponse : sous la forme devoir, c'est à dire d'une contrainte exercée sur notre volonté , ou plutôt
d'une" obligation" ( on réservera aux seules lois naturelles et à l'action qu'elles exercent sur nous
l'appellation de" contraintes" , les lois morales , du fait qu'elles aient un sens , et qu'on puisse toujours
leur désobéir, étant plutôt des "obligations" - le règlement intérieur est obligatoire , la pesanteur n'est
pas" obligatoire", mais nécessaire ).
La morale commande ( "Tu ne tueras point !"), elle nous intime
l'ordre de faire ou de nous abstenir de faire.
Qu'est-ce à dire , sinon que si le bien se présente comme
une obligation , c'est qu'il ne va pas de soi , qu'il rencontre en nous des forces hostiles : l’égoïsme en
nous , qui nous fait nous préférer aux autres , priorité que la morale s'efforce de renverser ( "moi d'abord
!" ..."après-vous monsieur !").
Il y aurait donc une austérité, un aspect nécessairement rébarbatif du
devoir moral , une dimension sacrificielle puisqu'il réclame de renoncer à la jouissance , culpabilise
l'innocente et spontanée recherche , par chacun , de son intérêt.
L'existence d'un "devoir moral" , à la fois recèle un paradoxe et semble constituer une anomalie.
Un paradoxe : ne considère-t-on pas , à juste titre , celui qui fait triompher son sens du devoir de ses
désirs comme un homme libre , et celui qui cède à la tentation comme étant l'esclave de ses passions ?
L'accomplissement du devoir serait donc l'acte libre par excellence , alors même que le devoir parle la
langue de la contrainte, de l'autorité qui, du dehors, s'exerce sur la volonté ! Il y a une hétéronomie du
devoir ( j'ai beau m'y efforcer, je ne peux pas étouffer la voix de la conscience en moi , elle parle
indépendamment de ma volonté ) , et pourtant , je ne serais jamais aussi libre que quand je m'y soumets
...
Une anomalie : comment un être vivant , dont le fondamental ressort est de se conserver , dont la
motivation principale est de "s'efforcer de persévérer dans son être" (Spinoza), comment un être dont
l'attachement instinctif à soi est infiniment renforcé par la conscience de soi et de sa finitude , comment
un être à l’égoïsme incommensurable...
( Pascal : "...il n'y a personne qui ne se mette au-dessus de tout le reste du monde..." Schopenhauer :
"...dans l'hypothèse où chacun aurait le choix entre son propre anéantissement et celui du reste du
monde ,il n'est nul besoin de préciser ce que ce que la grande majorité préférerait..." )
...
est-il donc capable sinon d'abnégation , du moins de son exigence ? N'y a-t-il pas quelque chose,
donc , de surnaturel , de miraculeux, de surhumain dans notre vocation morale ? D'où vient donc qu'on
ressente en soi l'appel du devoir , où en situer l'origine , faut-il y voir une confirmation, voire une preuve
de l'existence d'une sur-nature ( Rousseau : " Conscience !Conscience ! instinct divin , immortelle et
céleste voix..." ) ou bien n'y a-t-il pas une origine naturelle à notre aptitude à lutter contre notre propre
nature ?
( C’est l’occasion de préciser le sens de cette distinction : chercher l’origine / chercher le fondement.
La
recherche des origines est historique et porte sur les causes , il s’agit de remonter à la première
apparition d’un phénomène , à sa première forme connue , dans le but d’expliquer son existence ; la
recherche du fondement porte plutôt sur la légitimité du phénomène en question.
Ainsi , chercher les
« fondements de la morale », comme nous allons le faire, revient à s’interroger sur ce qui fait la valeur
des valeurs , à chercher à identifier un principe à la valeur évidente , dont toutes les constructions
éthiques des différentes civilisations dériveraient et tireraient leur caractère authentiquement moral.
Rechercher l’origine de la morale – comme le fait Nietzsche dans Généalogie de la morale – c’est se
demander quelles motivations – pas nécessairement morales ! – ont pu amener les hommes à inventer
des doctrines morales , des systèmes de valeur , notamment religieux , comme par exemple la volonté
de domination , la volonté d’affaiblir les forts en les culpabilisant ; l’origine de l’humanité , c’est
l’animalité , mais son fondement , c’est sa liberté et sa moralité , sa capacité à échapper , justement , à
son destin animal ).
I) L’origine sociale du sentiment du devoir.
D’après Bergson ( extrait des deux sources ) le devoir a une origine sociale ( même si il revient à certains
individus d’exception – Socrate , Jésus …- d’élargir le champ des devoirs à l’humanité entière en en
changeant la signification , passant d’un rôle de conservation , d’ordre à un effet d’expansion, de progrès)
, il exprime notre appartenance au groupe et notre soumission à sa loi de conservation .
C’est qu’on peut
comparer une société humaine ( et a fortiori animale ) à un organisme , dont la viabilité dépend de
l’observation, par les éléments qui le composent , d’un certain nombre de règles visant à coordonner
leurs mouvements pour la plus grande utilité du tout auquel ils appartiennent et dont ils dépendent
étroitement.
Les devoirs humains , les obligations qui nous tiennent les uns aux autres n’ont sans doute
pas la rigidité et la nécessité de l’instinct social chez les animaux : ils varient et progressent , semblent
donc marqués du sceau de la liberté individuelle .
Toutefois , si chez l’homme, il est vrai qu’aucune règle
en particulier n’est nécessaire , le fait qu’il faille bien qu’il y ait des règles, quant à lui , est nécessaire et
ne souffre pas d’exceptions .
Le fait qu’il y ait des devoirs et qu’ils s’imposent à nous de façon nécessaire
renvoie donc à l’inclusion de l’individu dans une société , à la naturalité de l’être humain , à l’existence en
lui d’un « moi social » , et nullement à une prétendue autonomie du sujet doué de raison , tirant de son
propre fond rationnel les motifs de ses actes moraux.
L'individu est un être social qui accomplit spontanément ( quoiqu'après apprentissage et avec
conscience ) ses obligations envers le tout , c'est à dire aussi lui même en tant qu'à ce tout , il
appartient , à cette totalité, il s'identifie ( notion de "moi social" ).
Cette quasi- automaticité du sens
moral semble pourtant en contradiction avec le caractère rationnel et contraint avec lequel on le
représente ( les philosophes ) .
Le devoir ne s'exprime-t-il pas au moyen d'une formule impérative ? ( ex:
règle d'or , "ne fais pas à autrui..." ) Mais c'est l'exception, explique Bergson , le recours à des raisons
morales....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- LA PHILOSOPHIE DE COUR : DE PHILIPPE LE BEL À CHARLES LE SAGE
- LE DEVOIR (cours de philosophie)
- Philosophie : Conscience/ Inconscient
- MÉTHODOLOGIE DU COMMENTAIRE DE PHILOSOPHIE
- [Affinités de l'art et de la philosophie] Bergson