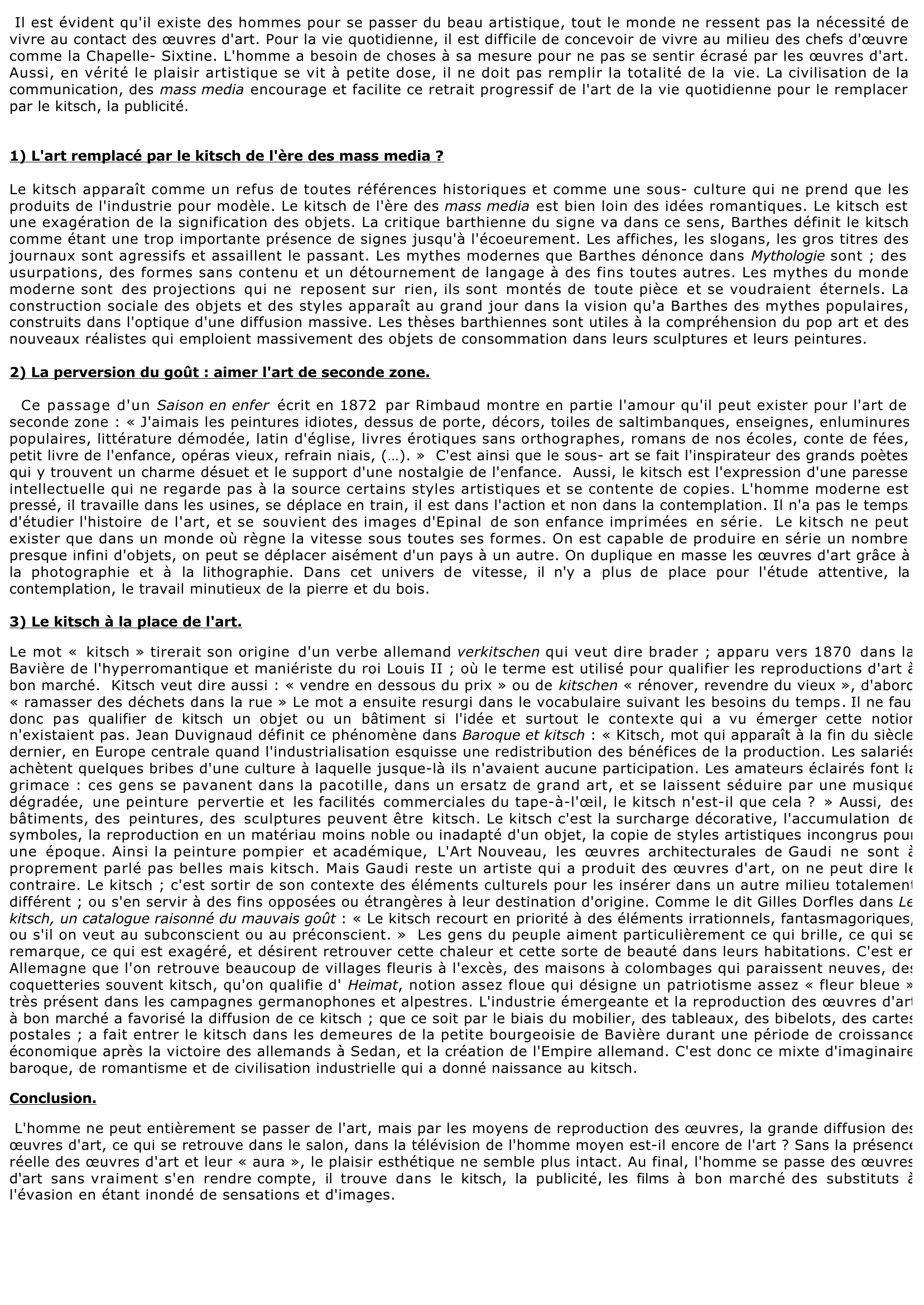Y a-t-il des hommes qui puissent se passer du beau artistique?
Extrait du document
«
Il est évident qu'il existe des hommes pour se passer du beau artistique, tout le monde ne ressent pas la nécessité de
vivre au contact des œuvres d'art.
Pour la vie quotidienne, il est difficile de concevoir de vivre au milieu des chefs d'œuvre
comme la Chapelle- Sixtine.
L'homme a besoin de choses à sa mesure pour ne pas se sentir écrasé par les œuvres d'art.
Aussi, en vérité le plaisir artistique se vit à petite dose, il ne doit pas remplir la totalité de la vie.
La civilisation de la
communication, des mass media encourage et facilite ce retrait progressif de l'art de la vie quotidienne pour le remplacer
par le kitsch, la publicité.
1) L'art remplacé par le kitsch de l'ère des mass media ?
Le kitsch apparaît comme un refus de toutes références historiques et comme une sous- culture qui ne prend que les
produits de l'industrie pour modèle.
Le kitsch de l'ère des mass media est bien loin des idées romantiques.
Le kitsch est
une exagération de la signification des objets.
La critique barthienne du signe va dans ce sens, Barthes définit le kitsch
comme étant une trop importante présence de signes jusqu'à l'écoeurement.
Les affiches, les slogans, les gros titres des
journaux sont agressifs et assaillent le passant.
Les mythes modernes que Barthes dénonce dans Mythologie sont ; des
usurpations, des formes sans contenu et un détournement de langage à des fins toutes autres.
Les mythes du monde
moderne sont des projections qui ne reposent sur rien, ils sont montés de toute pièce et se voudraient éternels.
La
construction sociale des objets et des styles apparaît au grand jour dans la vision qu'a Barthes des mythes populaires,
construits dans l'optique d'une diffusion massive.
Les thèses barthiennes sont utiles à la compréhension du pop art et des
nouveaux réalistes qui emploient massivement des objets de consommation dans leurs sculptures et leurs peintures.
2) La perversion du goût : aimer l'art de seconde zone.
Ce passage d'un Saison en enfer écrit en 1872 par Rimbaud montre en partie l'amour qu'il peut exister pour l'art de
seconde zone : « J'aimais les peintures idiotes, dessus de porte, décors, toiles de saltimbanques, enseignes, enluminures
populaires, littérature démodée, latin d'église, livres érotiques sans orthographes, romans de nos écoles, conte de fées,
petit livre de l'enfance, opéras vieux, refrain niais, (…).
» C'est ainsi que le sous- art se fait l'inspirateur des grands poètes
qui y trouvent un charme désuet et le support d'une nostalgie de l'enfance.
Aussi, le kitsch est l'expression d'une paresse
intellectuelle qui ne regarde pas à la source certains styles artistiques et se contente de copies.
L'homme moderne est
pressé, il travaille dans les usines, se déplace en train, il est dans l'action et non dans la contemplation.
Il n'a pas le temps
d'étudier l'histoire de l'art, et se souvient des images d'Epinal de son enfance imprimées en série.
Le kitsch ne peut
exister que dans un monde où règne la vitesse sous toutes ses formes.
On est capable de produire en série un nombre
presque infini d'objets, on peut se déplacer aisément d'un pays à un autre.
On duplique en masse les œuvres d'art grâce à
la photographie et à la lithographie.
Dans cet univers de vitesse, il n'y a plus de place pour l'étude attentive, la
contemplation, le travail minutieux de la pierre et du bois.
3) Le kitsch à la place de l'art.
Le mot « kitsch » tirerait son origine d'un verbe allemand verkitschen qui veut dire brader ; apparu vers 1870 dans la
Bavière de l'hyperromantique et maniériste du roi Louis II ; où le terme est utilisé pour qualifier les reproductions d'art à
bon marché.
Kitsch veut dire aussi : « vendre en dessous du prix » ou de kitschen « rénover, revendre du vieux », d'abord
« ramasser des déchets dans la rue » Le mot a ensuite resurgi dans le vocabulaire suivant les besoins du temps.
Il ne faut
donc pas qualifier de kitsch un objet ou un bâtiment si l'idée et surtout le contexte qui a vu émerger cette notion
n'existaient pas.
Jean Duvignaud définit ce phénomène dans Baroque et kitsch : « Kitsch, mot qui apparaît à la fin du siècle
dernier, en Europe centrale quand l'industrialisation esquisse une redistribution des bénéfices de la production.
Les salariés
achètent quelques bribes d'une culture à laquelle jusque-là ils n'avaient aucune participation.
Les amateurs éclairés font la
grimace : ces gens se pavanent dans la pacotille, dans un ersatz de grand art, et se laissent séduire par une musique
dégradée, une peinture pervertie et les facilités commerciales du tape-à-l'œil, le kitsch n'est-il que cela ? » Aussi, des
bâtiments, des peintures, des sculptures peuvent être kitsch.
Le kitsch c'est la surcharge décorative, l'accumulation de
symboles, la reproduction en un matériau moins noble ou inadapté d'un objet, la copie de styles artistiques incongrus pour
une époque.
Ainsi la peinture pompier et académique, L'Art Nouveau, les œuvres architecturales de Gaudi ne sont à
proprement parlé pas belles mais kitsch.
Mais Gaudi reste un artiste qui a produit des œuvres d'art, on ne peut dire le
contraire.
Le kitsch ; c'est sortir de son contexte des éléments culturels pour les insérer dans un autre milieu totalement
différent ; ou s'en servir à des fins opposées ou étrangères à leur destination d'origine.
Comme le dit Gilles Dorfles dans Le
kitsch, un catalogue raisonné du mauvais goût : « Le kitsch recourt en priorité à des éléments irrationnels, fantasmagoriques,
ou s'il on veut au subconscient ou au préconscient.
» Les gens du peuple aiment particulièrement ce qui brille, ce qui se
remarque, ce qui est exagéré, et désirent retrouver cette chaleur et cette sorte de beauté dans leurs habitations.
C'est en
Allemagne que l'on retrouve beaucoup de villages fleuris à l'excès, des maisons à colombages qui paraissent neuves, des
coquetteries souvent kitsch, qu'on qualifie d' Heimat, notion assez floue qui désigne un patriotisme assez « fleur bleue »
très présent dans les campagnes germanophones et alpestres.
L'industrie émergeante et la reproduction des œuvres d'art
à bon marché a favorisé la diffusion de ce kitsch ; que ce soit par le biais du mobilier, des tableaux, des bibelots, des cartes
postales ; a fait entrer le kitsch dans les demeures de la petite bourgeoisie de Bavière durant une période de croissance
économique après la victoire des allemands à Sedan, et la création de l'Empire allemand.
C'est donc ce mixte d'imaginaire
baroque, de romantisme et de civilisation industrielle qui a donné naissance au kitsch.
Conclusion.
L'homme ne peut entièrement se passer de l'art, mais par les moyens de reproduction des œuvres, la grande diffusion des
œuvres d'art, ce qui se retrouve dans le salon, dans la télévision de l'homme moyen est-il encore de l'art ? Sans la présence
réelle des œuvres d'art et leur « aura », le plaisir esthétique ne semble plus intact.
Au final, l'homme se passe des œuvres
d'art sans vraiment s'en rendre compte, il trouve dans le kitsch, la publicité, les films à bon marché des substituts à
l'évasion en étant inondé de sensations et d'images..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- L'espoir fait-il vivre les hommes ?
- La création artistique
- EC2 : Caractérisez la mobilité sociale des hommes par rapport à leur père.
- Tant que les hommes massacreront les bêtes, ils s'entre-tueront (Pythagore)
- étude linéaire exhortation aux hommes olympe de gouge