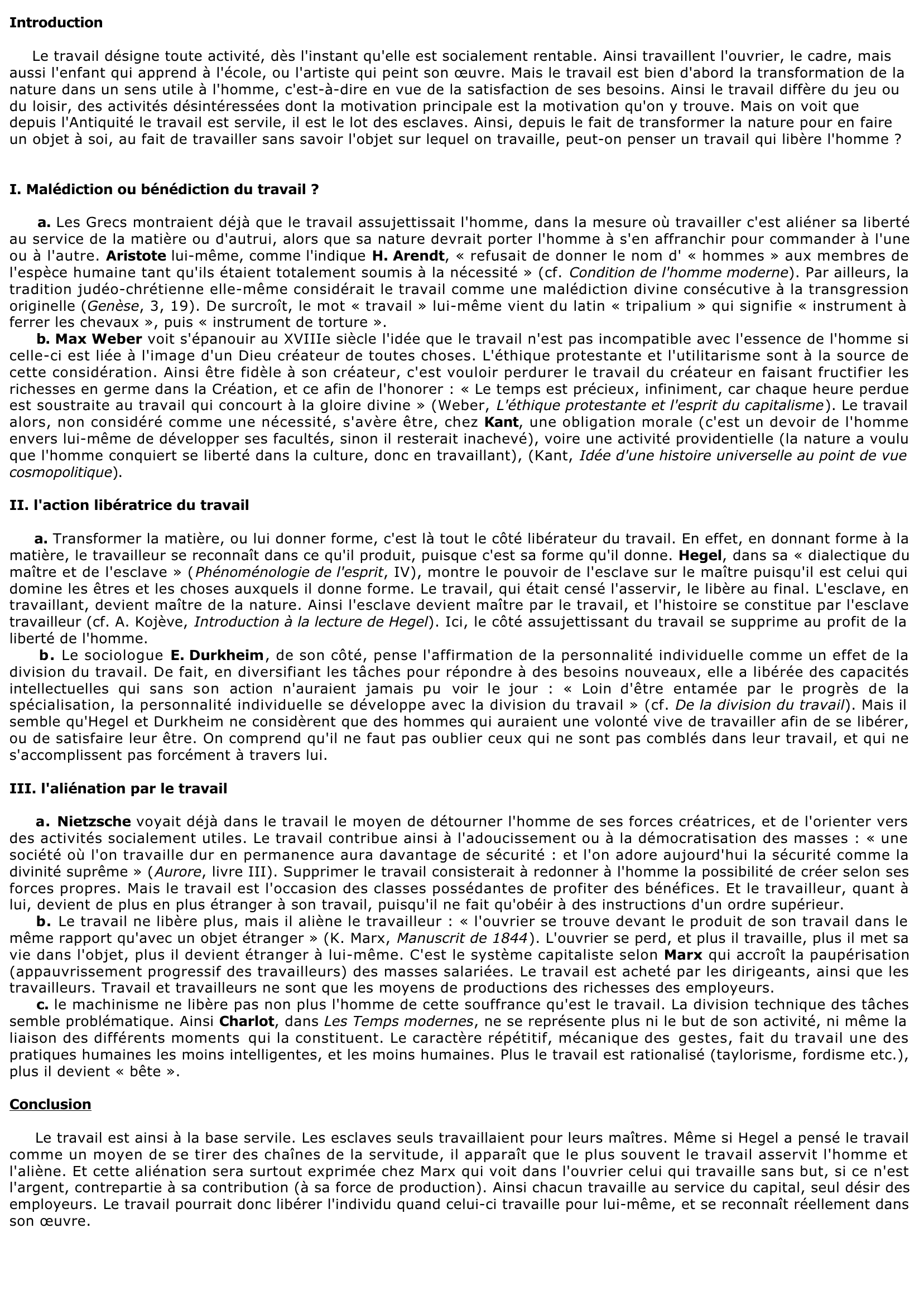Tout travail est-il servile ?
Extrait du document
«
Introduction
Le travail désigne toute activité, dès l'instant qu'elle est socialement rentable.
Ainsi travaillent l'ouvrier, le cadre, mais
aussi l'enfant qui apprend à l'école, ou l'artiste qui peint son œuvre.
Mais le travail est bien d'abord la transformation de la
nature dans un sens utile à l'homme, c'est-à-dire en vue de la satisfaction de ses besoins.
Ainsi le travail diffère du jeu ou
du loisir, des activités désintéressées dont la motivation principale est la motivation qu'on y trouve.
Mais on voit que
depuis l'Antiquité le travail est servile, il est le lot des esclaves.
Ainsi, depuis le fait de transformer la nature pour en faire
un objet à soi, au fait de travailler sans savoir l'objet sur lequel on travaille, peut-on penser un travail qui libère l'homme ?
I.
Malédiction ou bénédiction du travail ?
a.
Les Grecs montraient déjà que le travail assujettissait l'homme, dans la mesure où travailler c'est aliéner sa liberté
au service de la matière ou d'autrui, alors que sa nature devrait porter l'homme à s'en affranchir pour commander à l'une
ou à l'autre.
Aristote lui-même, comme l'indique H.
Arendt, « refusait de donner le nom d' « hommes » aux membres de
l'espèce humaine tant qu'ils étaient totalement soumis à la nécessité » (cf.
Condition de l'homme moderne).
Par ailleurs, la
tradition judéo-chrétienne elle-même considérait le travail comme une malédiction divine consécutive à la transgression
originelle (Genèse, 3, 19).
De surcroît, le mot « travail » lui-même vient du latin « tripalium » qui signifie « instrument à
ferrer les chevaux », puis « instrument de torture ».
b.
Max Weber voit s'épanouir au XVIIIe siècle l'idée que le travail n'est pas incompatible avec l'essence de l'homme si
celle-ci est liée à l'image d'un Dieu créateur de toutes choses.
L'éthique protestante et l'utilitarisme sont à la source de
cette considération.
Ainsi être fidèle à son créateur, c'est vouloir perdurer le travail du créateur en faisant fructifier les
richesses en germe dans la Création, et ce afin de l'honorer : « Le temps est précieux, infiniment, car chaque heure perdue
est soustraite au travail qui concourt à la gloire divine » (Weber, L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme).
Le travail
alors, non considéré comme une nécessité, s'avère être, chez Kant, une obligation morale (c'est un devoir de l'homme
envers lui-même de développer ses facultés, sinon il resterait inachevé), voire une activité providentielle (la nature a voulu
que l'homme conquiert se liberté dans la culture, donc en travaillant), (Kant, Idée d'une histoire universelle au point de vue
cosmopolitique).
II.
l'action libératrice du travail
a.
Transformer la matière, ou lui donner forme, c'est là tout le côté libérateur du travail.
En effet, en donnant forme à la
matière, le travailleur se reconnaît dans ce qu'il produit, puisque c'est sa forme qu'il donne.
Hegel, dans sa « dialectique du
maître et de l'esclave » ( Phénoménologie de l'esprit, IV), montre le pouvoir de l'esclave sur le maître puisqu'il est celui qui
domine les êtres et les choses auxquels il donne forme.
Le travail, qui était censé l'asservir, le libère au final.
L'esclave, en
travaillant, devient maître de la nature.
Ainsi l'esclave devient maître par le travail, et l'histoire se constitue par l'esclave
travailleur (cf.
A.
Kojève, Introduction à la lecture de Hegel).
Ici, le côté assujettissant du travail se supprime au profit de la
liberté de l'homme.
b.
Le sociologue E.
Durkheim, de son côté, pense l'affirmation de la personnalité individuelle comme un effet de la
division du travail.
De fait, en diversifiant les tâches pour répondre à des besoins nouveaux, elle a libérée des capacités
intellectuelles qui sans son action n'auraient jamais pu voir le jour : « Loin d'être entamée par le progrès de la
spécialisation, la personnalité individuelle se développe avec la division du travail » (cf.
De la division du travail).
Mais il
semble qu'Hegel et Durkheim ne considèrent que des hommes qui auraient une volonté vive de travailler afin de se libérer,
ou de satisfaire leur être.
On comprend qu'il ne faut pas oublier ceux qui ne sont pas comblés dans leur travail, et qui ne
s'accomplissent pas forcément à travers lui.
III.
l'aliénation par le travail
a.
Nietzsche voyait déjà dans le travail le moyen de détourner l'homme de ses forces créatrices, et de l'orienter vers
des activités socialement utiles.
Le travail contribue ainsi à l'adoucissement ou à la démocratisation des masses : « une
société où l'on travaille dur en permanence aura davantage de sécurité : et l'on adore aujourd'hui la sécurité comme la
divinité suprême » (Aurore, livre III).
Supprimer le travail consisterait à redonner à l'homme la possibilité de créer selon ses
forces propres.
Mais le travail est l'occasion des classes possédantes de profiter des bénéfices.
Et le travailleur, quant à
lui, devient de plus en plus étranger à son travail, puisqu'il ne fait qu'obéir à des instructions d'un ordre supérieur.
b.
Le travail ne libère plus, mais il aliène le travailleur : « l'ouvrier se trouve devant le produit de son travail dans le
même rapport qu'avec un objet étranger » (K.
Marx, Manuscrit de 1844).
L'ouvrier se perd, et plus il travaille, plus il met sa
vie dans l'objet, plus il devient étranger à lui-même.
C'est le système capitaliste selon Marx qui accroît la paupérisation
(appauvrissement progressif des travailleurs) des masses salariées.
Le travail est acheté par les dirigeants, ainsi que les
travailleurs.
Travail et travailleurs ne sont que les moyens de productions des richesses des employeurs.
c.
le machinisme ne libère pas non plus l'homme de cette souffrance qu'est le travail.
La division technique des tâches
semble problématique.
Ainsi Charlot, dans Les Temps modernes, ne se représente plus ni le but de son activité, ni même la
liaison des différents moments qui la constituent.
Le caractère répétitif, mécanique des gestes, fait du travail une des
pratiques humaines les moins intelligentes, et les moins humaines.
Plus le travail est rationalisé (taylorisme, fordisme etc.),
plus il devient « bête ».
Conclusion
Le travail est ainsi à la base servile.
Les esclaves seuls travaillaient pour leurs maîtres.
Même si Hegel a pensé le travail
comme un moyen de se tirer des chaînes de la servitude, il apparaît que le plus souvent le travail asservit l'homme et
l'aliène.
Et cette aliénation sera surtout exprimée chez Marx qui voit dans l'ouvrier celui qui travaille sans but, si ce n'est
l'argent, contrepartie à sa contribution (à sa force de production).
Ainsi chacun travaille au service du capital, seul désir des
employeurs.
Le travail pourrait donc libérer l'individu quand celui-ci travaille pour lui-même, et se reconnaît réellement dans
son œuvre..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Sujet : Le travail technique est-il une transformation de l’homme ?
- Travail/Nature/technique: le travail est-il le propre de l'homme ?
- Le travail est il libérateur ?
- travail et bonheur
- Dissetation Le Travail nous rend il plus humain ?