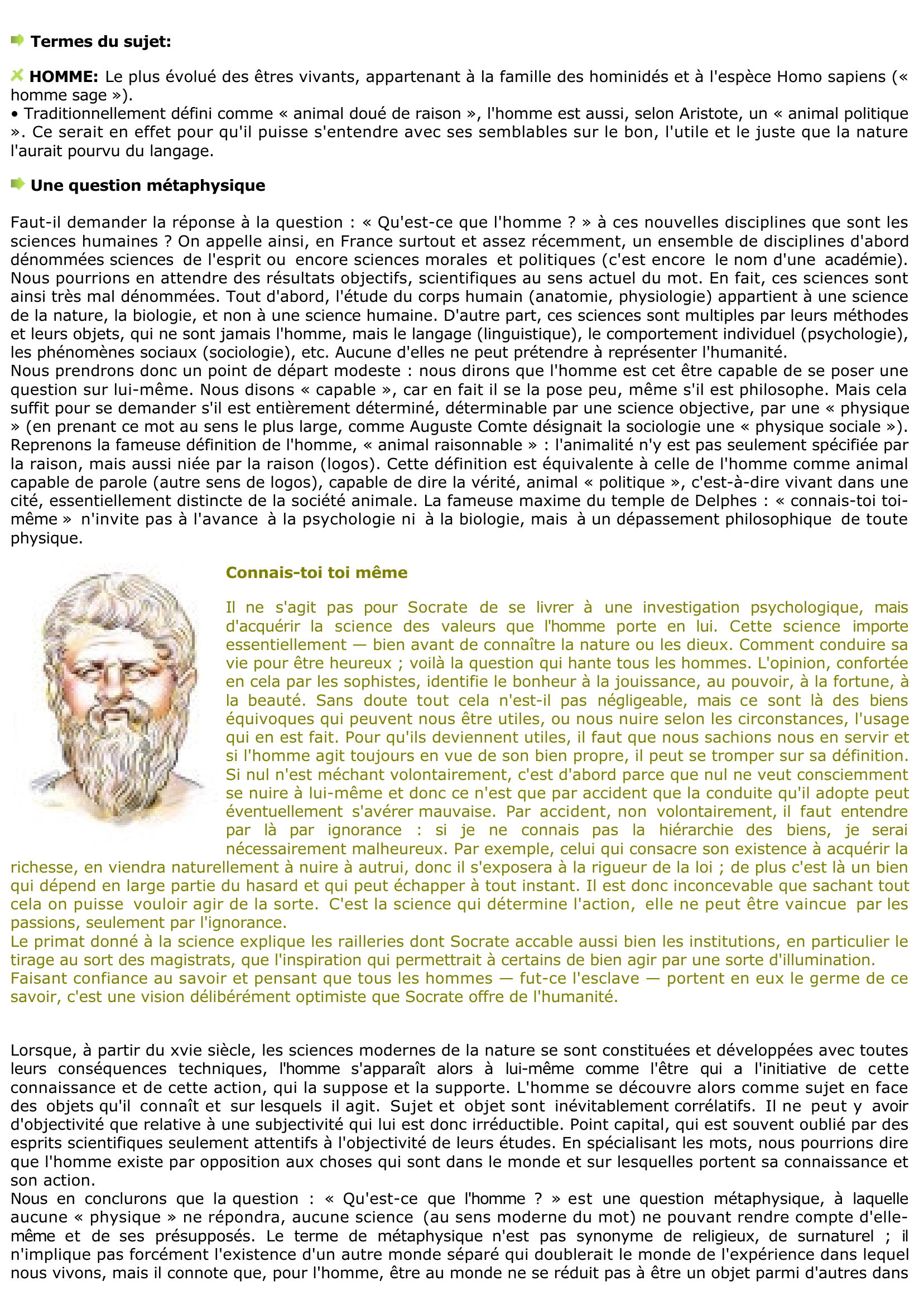Qu'est-ce que l'homme ?
Extrait du document
«
Termes du sujet:
HOMME: Le plus évolué des êtres vivants, appartenant à la famille des hominidés et à l'espèce Homo sapiens («
homme sage »).
• Traditionnellement défini comme « animal doué de raison », l'homme est aussi, selon Aristote, un « animal politique
».
Ce serait en effet pour qu'il puisse s'entendre avec ses semblables sur le bon, l'utile et le juste que la nature
l'aurait pourvu du langage.
Une question métaphysique
Faut-il demander la réponse à la question : « Qu'est-ce que l'homme ? » à ces nouvelles disciplines que sont les
sciences humaines ? On appelle ainsi, en France surtout et assez récemment, un ensemble de disciplines d'abord
dénommées sciences de l'esprit ou encore sciences morales et politiques (c'est encore le nom d'une académie).
Nous pourrions en attendre des résultats objectifs, scientifiques au sens actuel du mot.
En fait, ces sciences sont
ainsi très mal dénommées.
Tout d'abord, l'étude du corps humain (anatomie, physiologie) appartient à une science
de la nature, la biologie, et non à une science humaine.
D'autre part, ces sciences sont multiples par leurs méthodes
et leurs objets, qui ne sont jamais l'homme, mais le langage (linguistique), le comportement individuel (psychologie),
les phénomènes sociaux (sociologie), etc.
Aucune d'elles ne peut prétendre à représenter l'humanité.
Nous prendrons donc un point de départ modeste : nous dirons que l'homme est cet être capable de se poser une
question sur lui-même.
Nous disons « capable », car en fait il se la pose peu, même s'il est philosophe.
Mais cela
suffit pour se demander s'il est entièrement déterminé, déterminable par une science objective, par une « physique
» (en prenant ce mot au sens le plus large, comme Auguste Comte désignait la sociologie une « physique sociale »).
Reprenons la fameuse définition de l'homme, « animal raisonnable » : l'animalité n'y est pas seulement spécifiée par
la raison, mais aussi niée par la raison (logos).
Cette définition est équivalente à celle de l'homme comme animal
capable de parole (autre sens de logos), capable de dire la vérité, animal « politique », c'est-à-dire vivant dans une
cité, essentiellement distincte de la société animale.
La fameuse maxime du temple de Delphes : « connais-toi toimême » n'invite pas à l'avance à la psychologie ni à la biologie, mais à un dépassement philosophique de toute
physique.
Connais-toi toi même
Il ne s'agit pas pour Socrate de se livrer à une investigation psychologique, mais
d'acquérir la science des valeurs que l'homme porte en lui.
Cette science importe
essentiellement — bien avant de connaître la nature ou les dieux.
Comment conduire sa
vie pour être heureux ; voilà la question qui hante tous les hommes.
L'opinion, confortée
en cela par les sophistes, identifie le bonheur à la jouissance, au pouvoir, à la fortune, à
la beauté.
Sans doute tout cela n'est-il pas négligeable, mais ce sont là des biens
équivoques qui peuvent nous être utiles, ou nous nuire selon les circonstances, l'usage
qui en est fait.
Pour qu'ils deviennent utiles, il faut que nous sachions nous en servir et
si l'homme agit toujours en vue de son bien propre, il peut se tromper sur sa définition.
Si nul n'est méchant volontairement, c'est d'abord parce que nul ne veut consciemment
se nuire à lui-même et donc ce n'est que par accident que la conduite qu'il adopte peut
éventuellement s'avérer mauvaise.
Par accident, non volontairement, il faut entendre
par là par ignorance : si je ne connais pas la hiérarchie des biens, je serai
nécessairement malheureux.
Par exemple, celui qui consacre son existence à acquérir la
richesse, en viendra naturellement à nuire à autrui, donc il s'exposera à la rigueur de la loi ; de plus c'est là un bien
qui dépend en large partie du hasard et qui peut échapper à tout instant.
Il est donc inconcevable que sachant tout
cela on puisse vouloir agir de la sorte.
C'est la science qui détermine l'action, elle ne peut être vaincue par les
passions, seulement par l'ignorance.
Le primat donné à la science explique les railleries dont Socrate accable aussi bien les institutions, en particulier le
tirage au sort des magistrats, que l'inspiration qui permettrait à certains de bien agir par une sorte d'illumination.
Faisant confiance au savoir et pensant que tous les hommes — fut-ce l'esclave — portent en eux le germe de ce
savoir, c'est une vision délibérément optimiste que Socrate offre de l'humanité.
Lorsque, à partir du xvie siècle, les sciences modernes de la nature se sont constituées et développées avec toutes
leurs conséquences techniques, l'homme s'apparaît alors à lui-même comme l'être qui a l'initiative de cette
connaissance et de cette action, qui la suppose et la supporte.
L'homme se découvre alors comme sujet en face
des objets qu'il connaît et sur lesquels il agit.
Sujet et objet sont inévitablement corrélatifs.
Il ne peut y avoir
d'objectivité que relative à une subjectivité qui lui est donc irréductible.
Point capital, qui est souvent oublié par des
esprits scientifiques seulement attentifs à l'objectivité de leurs études.
En spécialisant les mots, nous pourrions dire
que l'homme existe par opposition aux choses qui sont dans le monde et sur lesquelles portent sa connaissance et
son action.
Nous en conclurons que la question : « Qu'est-ce que l'homme ? » est une question métaphysique, à laquelle
aucune « physique » ne répondra, aucune science (au sens moderne du mot) ne pouvant rendre compte d'ellemême et de ses présupposés.
Le terme de métaphysique n'est pas synonyme de religieux, de surnaturel ; il
n'implique pas forcément l'existence d'un autre monde séparé qui doublerait le monde de l'expérience dans lequel
nous vivons, mais il connote que, pour l'homme, être au monde ne se réduit pas à être un objet parmi d'autres dans.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Texte 1 : « Homme est tu capable d’être juste ? »
- « L’homme est un bipède sans plumes » DIOGÈNEDE SINOPE
- « L’homme n’est jamais moins seul que lorsqu’il est seul » CICÉRON
- « La loi de l’homme est la loi du langage » JACQUES LACAN
- Le bois dont l'homme est fait est si courbe qu'on ne peut rien y tailler de droit. Kant