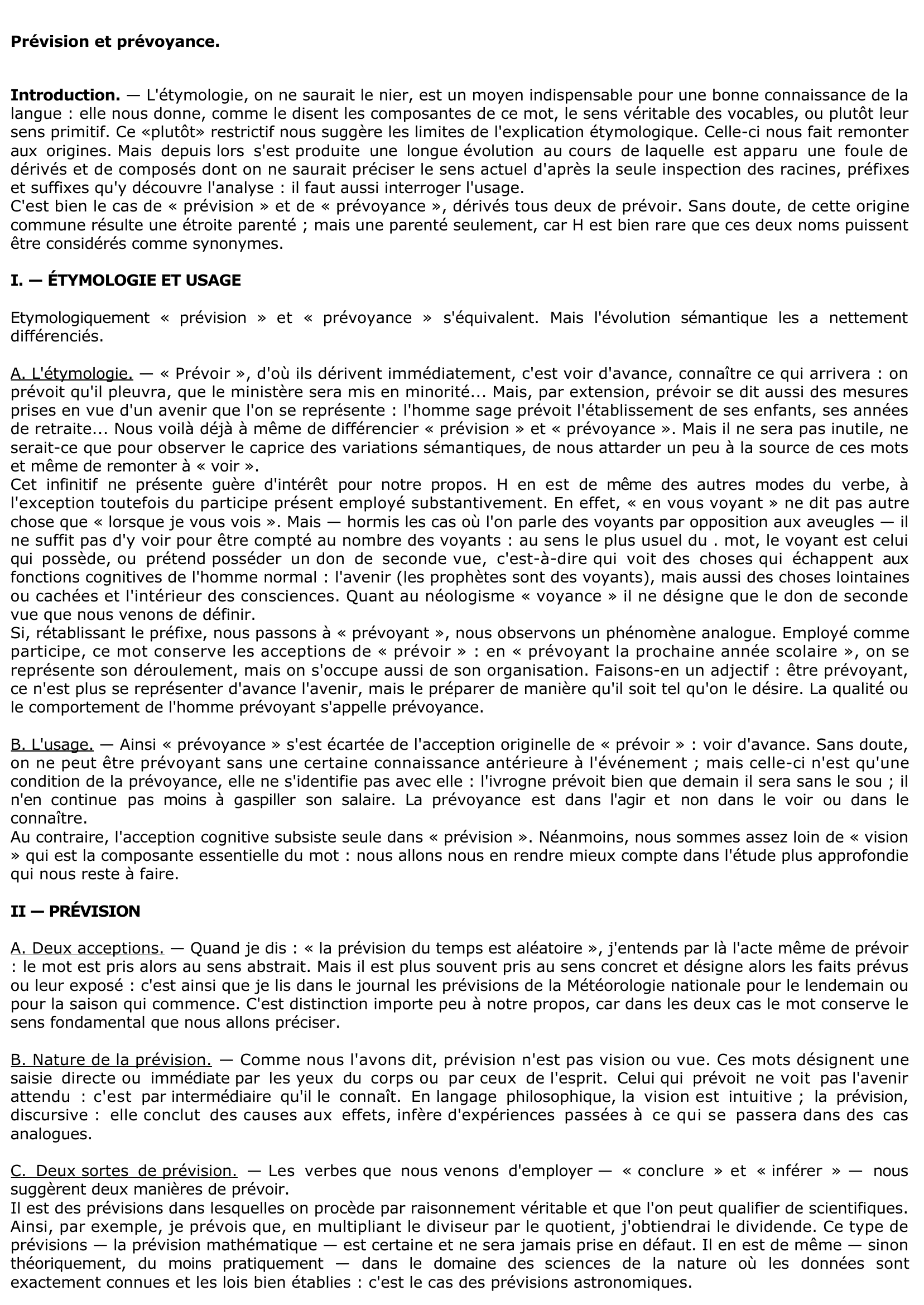Prévision et prévoyance ?
Extrait du document
«
Prévision et prévoyance.
Introduction.
— L'étymologie, on ne saurait le nier, est un moyen indispensable pour une bonne connaissance de la
langue : elle nous donne, comme le disent les composantes de ce mot, le sens véritable des vocables, ou plutôt leur
sens primitif.
Ce «plutôt» restrictif nous suggère les limites de l'explication étymologique.
Celle-ci nous fait remonter
aux origines.
Mais depuis lors s'est produite une longue évolution au cours de laquelle est apparu une foule de
dérivés et de composés dont on ne saurait préciser le sens actuel d'après la seule inspection des racines, préfixes
et suffixes qu'y découvre l'analyse : il faut aussi interroger l'usage.
C'est bien le cas de « prévision » et de « prévoyance », dérivés tous deux de prévoir.
Sans doute, de cette origine
commune résulte une étroite parenté ; mais une parenté seulement, car H est bien rare que ces deux noms puissent
être considérés comme synonymes.
I.
— ÉTYMOLOGIE ET USAGE
Etymologiquement « prévision » et « prévoyance » s'équivalent.
Mais l'évolution sémantique les a nettement
différenciés.
A.
L'étymologie.
— « Prévoir », d'où ils dérivent immédiatement, c'est voir d'avance, connaître ce qui arrivera : on
prévoit qu'il pleuvra, que le ministère sera mis en minorité...
Mais, par extension, prévoir se dit aussi des mesures
prises en vue d'un avenir que l'on se représente : l'homme sage prévoit l'établissement de ses enfants, ses années
de retraite...
Nous voilà déjà à même de différencier « prévision » et « prévoyance ».
Mais il ne sera pas inutile, ne
serait-ce que pour observer le caprice des variations sémantiques, de nous attarder un peu à la source de ces mots
et même de remonter à « voir ».
Cet infinitif ne présente guère d'intérêt pour notre propos.
H en est de même des autres modes du verbe, à
l'exception toutefois du participe présent employé substantivement.
En effet, « en vous voyant » ne dit pas autre
chose que « lorsque je vous vois ».
Mais — hormis les cas où l'on parle des voyants par opposition aux aveugles — il
ne suffit pas d'y voir pour être compté au nombre des voyants : au sens le plus usuel du .
mot, le voyant est celui
qui possède, ou prétend posséder un don de seconde vue, c'est-à-dire qui voit des choses qui échappent aux
fonctions cognitives de l'homme normal : l'avenir (les prophètes sont des voyants), mais aussi des choses lointaines
ou cachées et l'intérieur des consciences.
Quant au néologisme « voyance » il ne désigne que le don de seconde
vue que nous venons de définir.
Si, rétablissant le préfixe, nous passons à « prévoyant », nous observons un phénomène analogue.
Employé comme
participe, ce mot conserve les acceptions de « prévoir » : en « prévoyant la prochaine année scolaire », on se
représente son déroulement, mais on s'occupe aussi de son organisation.
Faisons-en un adjectif : être prévoyant,
ce n'est plus se représenter d'avance l'avenir, mais le préparer de manière qu'il soit tel qu'on le désire.
La qualité ou
le comportement de l'homme prévoyant s'appelle prévoyance.
B.
L'usage.
— Ainsi « prévoyance » s'est écartée de l'acception originelle de « prévoir » : voir d'avance.
Sans doute,
on ne peut être prévoyant sans une certaine connaissance antérieure à l'événement ; mais celle-ci n'est qu'une
condition de la prévoyance, elle ne s'identifie pas avec elle : l'ivrogne prévoit bien que demain il sera sans le sou ; il
n'en continue pas moins à gaspiller son salaire.
La prévoyance est dans l'agir et non dans le voir ou dans le
connaître.
Au contraire, l'acception cognitive subsiste seule dans « prévision ».
Néanmoins, nous sommes assez loin de « vision
» qui est la composante essentielle du mot : nous allons nous en rendre mieux compte dans l'étude plus approfondie
qui nous reste à faire.
II — PRÉVISION
A.
Deux acceptions.
— Quand je dis : « la prévision du temps est aléatoire », j'entends par là l'acte même de prévoir
: le mot est pris alors au sens abstrait.
Mais il est plus souvent pris au sens concret et désigne alors les faits prévus
ou leur exposé : c'est ainsi que je lis dans le journal les prévisions de la Météorologie nationale pour le lendemain ou
pour la saison qui commence.
C'est distinction importe peu à notre propos, car dans les deux cas le mot conserve le
sens fondamental que nous allons préciser.
B.
Nature de la prévision.
— Comme nous l'avons dit, prévision n'est pas vision ou vue.
Ces mots désignent une
saisie directe ou immédiate par les yeux du corps ou par ceux de l'esprit.
Celui qui prévoit ne voit pas l'avenir
attendu : c'est par intermédiaire qu'il le connaît.
En langage philosophique, la vision est intuitive ; la prévision,
discursive : elle conclut des causes aux effets, infère d'expériences passées à ce qui se passera dans des cas
analogues.
C.
Deux sortes de prévision.
— Les verbes que nous venons d'employer — « conclure » et « inférer » — nous
suggèrent deux manières de prévoir.
Il est des prévisions dans lesquelles on procède par raisonnement véritable et que l'on peut qualifier de scientifiques.
Ainsi, par exemple, je prévois que, en multipliant le diviseur par le quotient, j'obtiendrai le dividende.
Ce type de
prévisions — la prévision mathématique — est certaine et ne sera jamais prise en défaut.
Il en est de même — sinon
théoriquement, du moins pratiquement — dans le domaine des sciences de la nature où les données sont
exactement connues et les lois bien établies : c'est le cas des prévisions astronomiques..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓