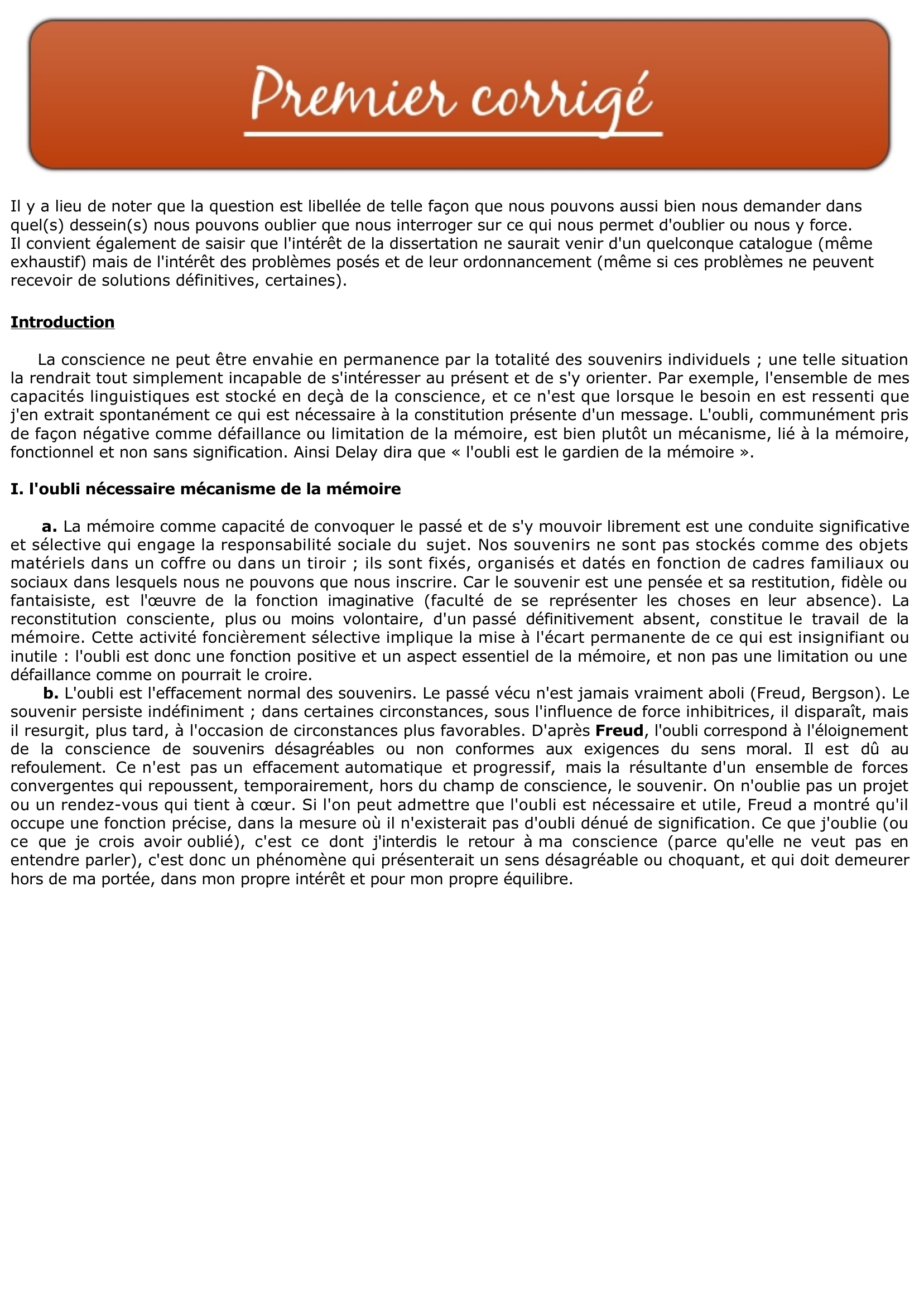Pourquoi oublions nous ?
Extrait du document
«
Il y a lieu de noter que la question est libellée de telle façon que nous pouvons aussi bien nous demander dans
quel(s) dessein(s) nous pouvons oublier que nous interroger sur ce qui nous permet d'oublier ou nous y force.
Il convient également de saisir que l'intérêt de la dissertation ne saurait venir d'un quelconque catalogue (même
exhaustif) mais de l'intérêt des problèmes posés et de leur ordonnancement (même si ces problèmes ne peuvent
recevoir de solutions définitives, certaines).
Introduction
La conscience ne peut être envahie en permanence par la totalité des souvenirs individuels ; une telle situation
la rendrait tout simplement incapable de s'intéresser au présent et de s'y orienter.
Par exemple, l'ensemble de mes
capacités linguistiques est stocké en deçà de la conscience, et ce n'est que lorsque le besoin en est ressenti que
j'en extrait spontanément ce qui est nécessaire à la constitution présente d'un message.
L'oubli, communément pris
de façon négative comme défaillance ou limitation de la mémoire, est bien plutôt un mécanisme, lié à la mémoire,
fonctionnel et non sans signification.
Ainsi Delay dira que « l'oubli est le gardien de la mémoire ».
I.
l'oubli nécessaire mécanisme de la mémoire
a.
La mémoire comme capacité de convoquer le passé et de s'y mouvoir librement est une conduite significative
et sélective qui engage la responsabilité sociale du sujet.
Nos souvenirs ne sont pas stockés comme des objets
matériels dans un coffre ou dans un tiroir ; ils sont fixés, organisés et datés en fonction de cadres familiaux ou
sociaux dans lesquels nous ne pouvons que nous inscrire.
Car le souvenir est une pensée et sa restitution, fidèle ou
fantaisiste, est l'œuvre de la fonction imaginative (faculté de se représenter les choses en leur absence).
La
reconstitution consciente, plus ou moins volontaire, d'un passé définitivement absent, constitue le travail de la
mémoire.
Cette activité foncièrement sélective implique la mise à l'écart permanente de ce qui est insignifiant ou
inutile : l'oubli est donc une fonction positive et un aspect essentiel de la mémoire, et non pas une limitation ou une
défaillance comme on pourrait le croire.
b.
L'oubli est l'effacement normal des souvenirs.
Le passé vécu n'est jamais vraiment aboli (Freud, Bergson).
Le
souvenir persiste indéfiniment ; dans certaines circonstances, sous l'influence de force inhibitrices, il disparaît, mais
il resurgit, plus tard, à l'occasion de circonstances plus favorables.
D'après Freud, l'oubli correspond à l'éloignement
de la conscience de souvenirs désagréables ou non conformes aux exigences du sens moral.
Il est dû au
refoulement.
Ce n'est pas un effacement automatique et progressif, mais la résultante d'un ensemble de forces
convergentes qui repoussent, temporairement, hors du champ de conscience, le souvenir.
On n'oublie pas un projet
ou un rendez-vous qui tient à cœur.
Si l'on peut admettre que l'oubli est nécessaire et utile, Freud a montré qu'il
occupe une fonction précise, dans la mesure où il n'existerait pas d'oubli dénué de signification.
Ce que j'oublie (ou
ce que je crois avoir oublié), c'est ce dont j'interdis le retour à ma conscience (parce qu'elle ne veut pas en
entendre parler), c'est donc un phénomène qui présenterait un sens désagréable ou choquant, et qui doit demeurer
hors de ma portée, dans mon propre intérêt et pour mon propre équilibre..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓