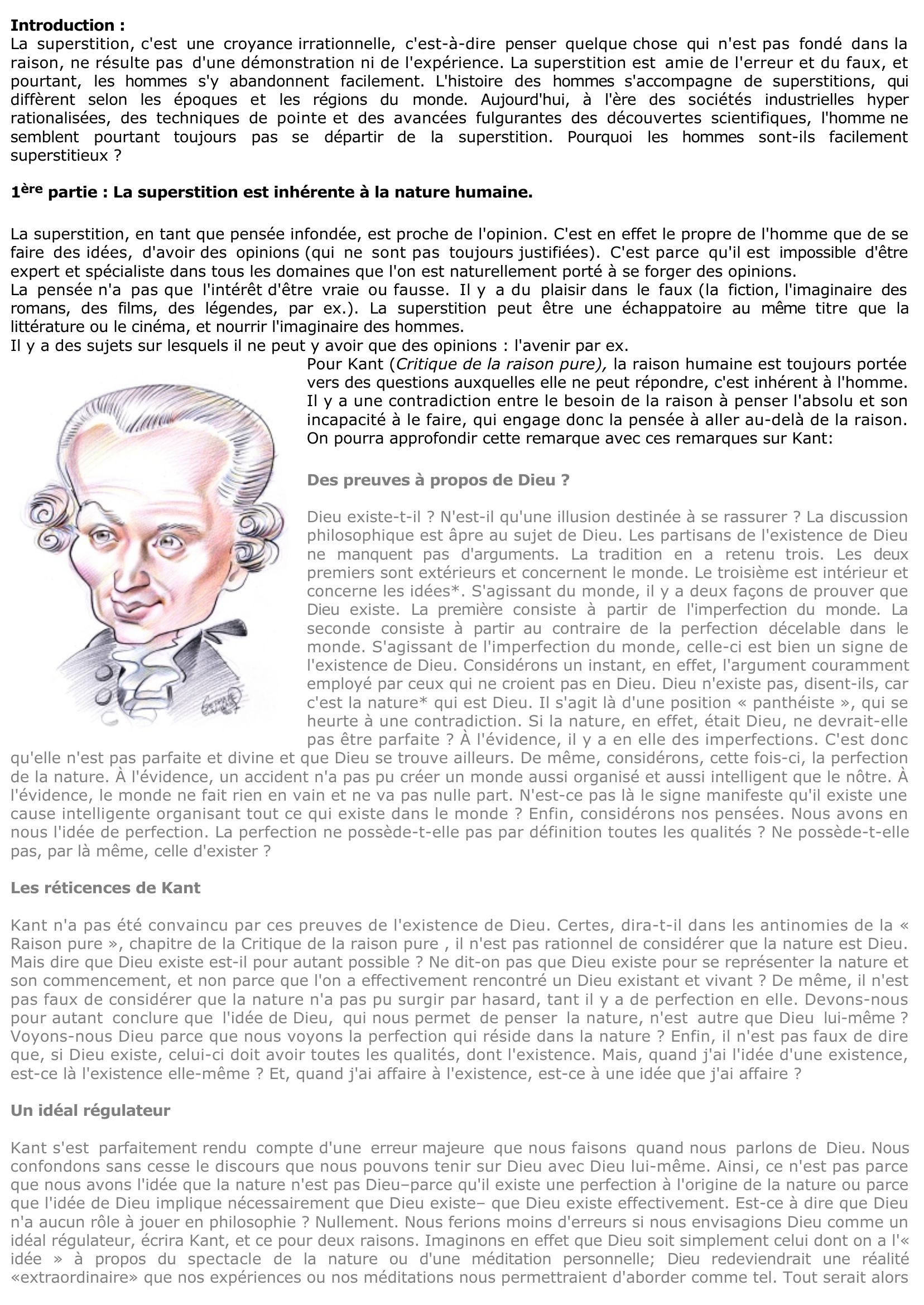pourquoi les hommes sont-ils facilement superstitieux?
Extrait du document
«
Introduction :
La superstition, c'est une croyance irrationnelle, c'est-à-dire penser quelque chose qui n'est pas fondé dans la
raison, ne résulte pas d'une démonstration ni de l'expérience.
La superstition est amie de l'erreur et du faux, et
pourtant, les hommes s'y abandonnent facilement.
L'histoire des hommes s'accompagne de superstitions, qui
diffèrent selon les époques et les régions du monde.
Aujourd'hui, à l'ère des sociétés industrielles hyper
rationalisées, des techniques de pointe et des avancées fulgurantes des découvertes scientifiques, l'homme ne
semblent pourtant toujours pas se départir de la superstition.
Pourquoi les hommes sont-ils facilement
superstitieux ?
1ère partie : La superstition est inhérente à la nature humaine.
La superstition, en tant que pensée infondée, est proche de l'opinion.
C'est en effet le propre de l'homme que de se
faire des idées, d'avoir des opinions (qui ne sont pas toujours justifiées).
C'est parce qu'il est impossible d'être
expert et spécialiste dans tous les domaines que l'on est naturellement porté à se forger des opinions.
La pensée n'a pas que l'intérêt d'être vraie ou fausse.
Il y a du plaisir dans le faux (la fiction, l'imaginaire des
romans, des films, des légendes, par ex.).
La superstition peut être une échappatoire au même titre que la
littérature ou le cinéma, et nourrir l'imaginaire des hommes.
Il y a des sujets sur lesquels il ne peut y avoir que des opinions : l'avenir par ex.
Pour Kant (Critique de la raison pure), la raison humaine est toujours portée
vers des questions auxquelles elle ne peut répondre, c'est inhérent à l'homme.
Il y a une contradiction entre le besoin de la raison à penser l'absolu et son
incapacité à le faire, qui engage donc la pensée à aller au-delà de la raison.
On pourra approfondir cette remarque avec ces remarques sur Kant:
Des preuves à propos de Dieu ?
Dieu existe-t-il ? N'est-il qu'une illusion destinée à se rassurer ? La discussion
philosophique est âpre au sujet de Dieu.
Les partisans de l'existence de Dieu
ne manquent pas d'arguments.
La tradition en a retenu trois.
Les deux
premiers sont extérieurs et concernent le monde.
Le troisième est intérieur et
concerne les idées*.
S'agissant du monde, il y a deux façons de prouver que
Dieu existe.
La première consiste à partir de l'imperfection du monde.
La
seconde consiste à partir au contraire de la perfection décelable dans le
monde.
S'agissant de l'imperfection du monde, celle-ci est bien un signe de
l'existence de Dieu.
Considérons un instant, en effet, l'argument couramment
employé par ceux qui ne croient pas en Dieu.
Dieu n'existe pas, disent-ils, car
c'est la nature* qui est Dieu.
Il s'agit là d'une position « panthéiste », qui se
heurte à une contradiction.
Si la nature, en effet, était Dieu, ne devrait-elle
pas être parfaite ? À l'évidence, il y a en elle des imperfections.
C'est donc
qu'elle n'est pas parfaite et divine et que Dieu se trouve ailleurs.
De même, considérons, cette fois-ci, la perfection
de la nature.
À l'évidence, un accident n'a pas pu créer un monde aussi organisé et aussi intelligent que le nôtre.
À
l'évidence, le monde ne fait rien en vain et ne va pas nulle part.
N'est-ce pas là le signe manifeste qu'il existe une
cause intelligente organisant tout ce qui existe dans le monde ? Enfin, considérons nos pensées.
Nous avons en
nous l'idée de perfection.
La perfection ne possède-t-elle pas par définition toutes les qualités ? Ne possède-t-elle
pas, par là même, celle d'exister ?
Les réticences de Kant
Kant n'a pas été convaincu par ces preuves de l'existence de Dieu.
Certes, dira-t-il dans les antinomies de la «
Raison pure », chapitre de la Critique de la raison pure , il n'est pas rationnel de considérer que la nature est Dieu.
Mais dire que Dieu existe est-il pour autant possible ? Ne dit-on pas que Dieu existe pour se représenter la nature et
son commencement, et non parce que l'on a effectivement rencontré un Dieu existant et vivant ? De même, il n'est
pas faux de considérer que la nature n'a pas pu surgir par hasard, tant il y a de perfection en elle.
Devons-nous
pour autant conclure que l'idée de Dieu, qui nous permet de penser la nature, n'est autre que Dieu lui-même ?
Voyons-nous Dieu parce que nous voyons la perfection qui réside dans la nature ? Enfin, il n'est pas faux de dire
que, si Dieu existe, celui-ci doit avoir toutes les qualités, dont l'existence.
Mais, quand j'ai l'idée d'une existence,
est-ce là l'existence elle-même ? Et, quand j'ai affaire à l'existence, est-ce à une idée que j'ai affaire ?
Un idéal régulateur
Kant s'est parfaitement rendu compte d'une erreur majeure que nous faisons quand nous parlons de Dieu.
Nous
confondons sans cesse le discours que nous pouvons tenir sur Dieu avec Dieu lui-même.
Ainsi, ce n'est pas parce
que nous avons l'idée que la nature n'est pas Dieu–parce qu'il existe une perfection à l'origine de la nature ou parce
que l'idée de Dieu implique nécessairement que Dieu existe– que Dieu existe effectivement.
Est-ce à dire que Dieu
n'a aucun rôle à jouer en philosophie ? Nullement.
Nous ferions moins d'erreurs si nous envisagions Dieu comme un
idéal régulateur, écrira Kant, et ce pour deux raisons.
Imaginons en effet que Dieu soit simplement celui dont on a l'«
idée » à propos du spectacle de la nature ou d'une méditation personnelle; Dieu redeviendrait une réalité
«extraordinaire» que nos expériences ou nos méditations nous permettraient d'aborder comme tel.
Tout serait alors.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- L'espoir fait-il vivre les hommes ?
- EC2 : Caractérisez la mobilité sociale des hommes par rapport à leur père.
- Tant que les hommes massacreront les bêtes, ils s'entre-tueront (Pythagore)
- étude linéaire exhortation aux hommes olympe de gouge
- Etude linéaire exhortation aux hommes olympe de gouge