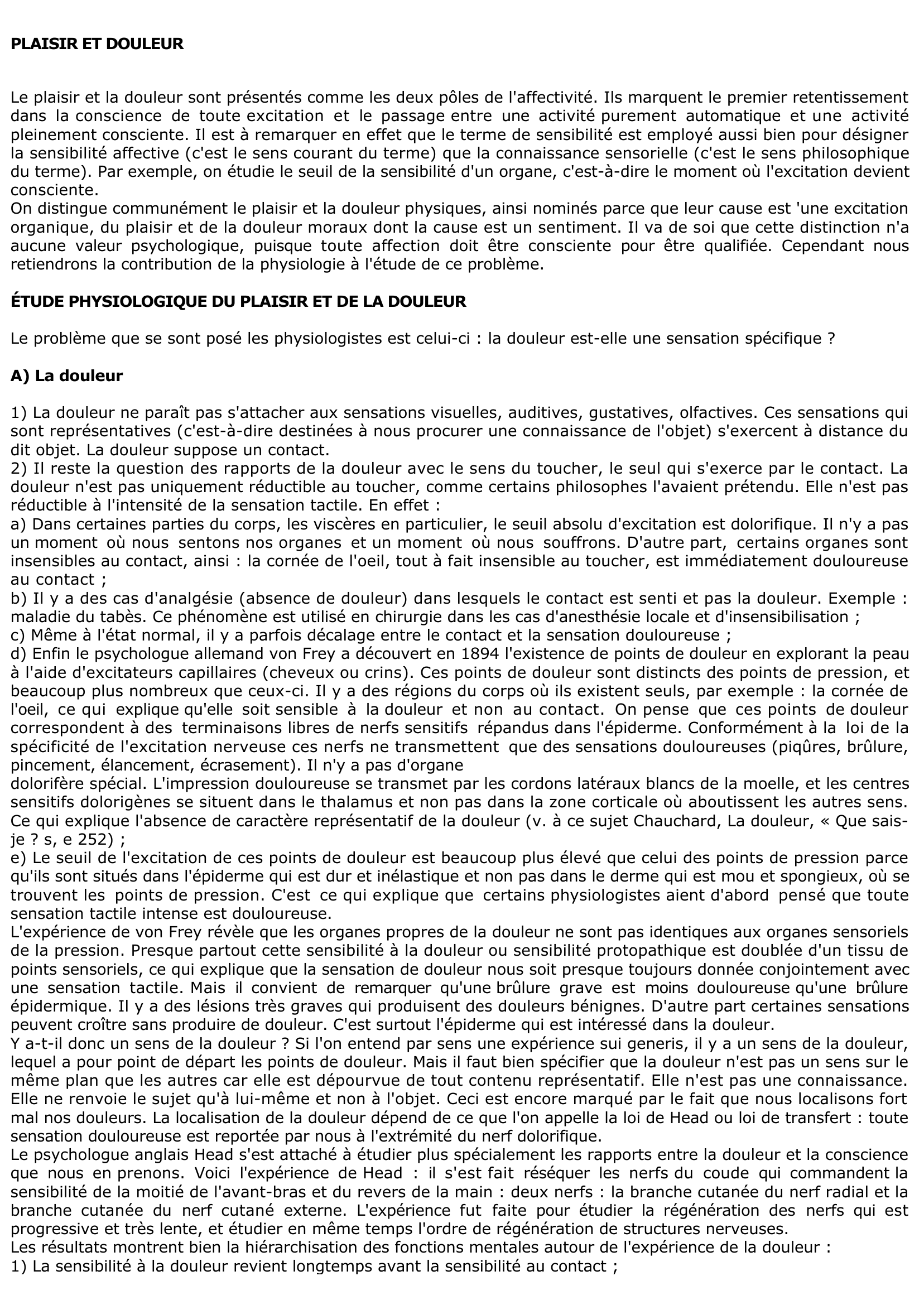Plaisir et douleur
Extrait du document
«
PLAISIR ET DOULEUR
Le plaisir et la douleur sont présentés comme les deux pôles de l'affectivité.
Ils marquent le premier retentissement
dans la conscience de toute excitation et le passage entre une activité purement automatique et une activité
pleinement consciente.
Il est à remarquer en effet que le terme de sensibilité est employé aussi bien pour désigner
la sensibilité affective (c'est le sens courant du terme) que la connaissance sensorielle (c'est le sens philosophique
du terme).
Par exemple, on étudie le seuil de la sensibilité d'un organe, c'est-à-dire le moment où l'excitation devient
consciente.
On distingue communément le plaisir et la douleur physiques, ainsi nominés parce que leur cause est 'une excitation
organique, du plaisir et de la douleur moraux dont la cause est un sentiment.
Il va de soi que cette distinction n'a
aucune valeur psychologique, puisque toute affection doit être consciente pour être qualifiée.
Cependant nous
retiendrons la contribution de la physiologie à l'étude de ce problème.
ÉTUDE PHYSIOLOGIQUE DU PLAISIR ET DE LA DOULEUR
Le problème que se sont posé les physiologistes est celui-ci : la douleur est-elle une sensation spécifique ?
A) La douleur
1) La douleur ne paraît pas s'attacher aux sensations visuelles, auditives, gustatives, olfactives.
Ces sensations qui
sont représentatives (c'est-à-dire destinées à nous procurer une connaissance de l'objet) s'exercent à distance du
dit objet.
La douleur suppose un contact.
2) Il reste la question des rapports de la douleur avec le sens du toucher, le seul qui s'exerce par le contact.
La
douleur n'est pas uniquement réductible au toucher, comme certains philosophes l'avaient prétendu.
Elle n'est pas
réductible à l'intensité de la sensation tactile.
En effet :
a) Dans certaines parties du corps, les viscères en particulier, le seuil absolu d'excitation est dolorifique.
Il n'y a pas
un moment où nous sentons nos organes et un moment où nous souffrons.
D'autre part, certains organes sont
insensibles au contact, ainsi : la cornée de l'oeil, tout à fait insensible au toucher, est immédiatement douloureuse
au contact ;
b) Il y a des cas d'analgésie (absence de douleur) dans lesquels le contact est senti et pas la douleur.
Exemple :
maladie du tabès.
Ce phénomène est utilisé en chirurgie dans les cas d'anesthésie locale et d'insensibilisation ;
c) Même à l'état normal, il y a parfois décalage entre le contact et la sensation douloureuse ;
d) Enfin le psychologue allemand von Frey a découvert en 1894 l'existence de points de douleur en explorant la peau
à l'aide d'excitateurs capillaires (cheveux ou crins).
Ces points de douleur sont distincts des points de pression, et
beaucoup plus nombreux que ceux-ci.
Il y a des régions du corps où ils existent seuls, par exemple : la cornée de
l'oeil, ce qui explique qu'elle soit sensible à la douleur et non au contact.
On pense que ces points de douleur
correspondent à des terminaisons libres de nerfs sensitifs répandus dans l'épiderme.
Conformément à la loi de la
spécificité de l'excitation nerveuse ces nerfs ne transmettent que des sensations douloureuses (piqûres, brûlure,
pincement, élancement, écrasement).
Il n'y a pas d'organe
dolorifère spécial.
L'impression douloureuse se transmet par les cordons latéraux blancs de la moelle, et les centres
sensitifs dolorigènes se situent dans le thalamus et non pas dans la zone corticale où aboutissent les autres sens.
Ce qui explique l'absence de caractère représentatif de la douleur (v.
à ce sujet Chauchard, La douleur, « Que saisje ? s, e 252) ;
e) Le seuil de l'excitation de ces points de douleur est beaucoup plus élevé que celui des points de pression parce
qu'ils sont situés dans l'épiderme qui est dur et inélastique et non pas dans le derme qui est mou et spongieux, où se
trouvent les points de pression.
C'est ce qui explique que certains physiologistes aient d'abord pensé que toute
sensation tactile intense est douloureuse.
L'expérience de von Frey révèle que les organes propres de la douleur ne sont pas identiques aux organes sensoriels
de la pression.
Presque partout cette sensibilité à la douleur ou sensibilité protopathique est doublée d'un tissu de
points sensoriels, ce qui explique que la sensation de douleur nous soit presque toujours donnée conjointement avec
une sensation tactile.
Mais il convient de remarquer qu'une brûlure grave est moins douloureuse qu'une brûlure
épidermique.
Il y a des lésions très graves qui produisent des douleurs bénignes.
D'autre part certaines sensations
peuvent croître sans produire de douleur.
C'est surtout l'épiderme qui est intéressé dans la douleur.
Y a-t-il donc un sens de la douleur ? Si l'on entend par sens une expérience sui generis, il y a un sens de la douleur,
lequel a pour point de départ les points de douleur.
Mais il faut bien spécifier que la douleur n'est pas un sens sur le
même plan que les autres car elle est dépourvue de tout contenu représentatif.
Elle n'est pas une connaissance.
Elle ne renvoie le sujet qu'à lui-même et non à l'objet.
Ceci est encore marqué par le fait que nous localisons fort
mal nos douleurs.
La localisation de la douleur dépend de ce que l'on appelle la loi de Head ou loi de transfert : toute
sensation douloureuse est reportée par nous à l'extrémité du nerf dolorifique.
Le psychologue anglais Head s'est attaché à étudier plus spécialement les rapports entre la douleur et la conscience
que nous en prenons.
Voici l'expérience de Head : il s'est fait réséquer les nerfs du coude qui commandent la
sensibilité de la moitié de l'avant-bras et du revers de la main : deux nerfs : la branche cutanée du nerf radial et la
branche cutanée du nerf cutané externe.
L'expérience fut faite pour étudier la régénération des nerfs qui est
progressive et très lente, et étudier en même temps l'ordre de régénération de structures nerveuses.
Les résultats montrent bien la hiérarchisation des fonctions mentales autour de l'expérience de la douleur :
1) La sensibilité à la douleur revient longtemps avant la sensibilité au contact ;.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- « Mais l'âme ne raisonne jamais mieux que quand rien ne la trouble, ni l'ouïe, ni la vue, ni la douleur, ni quelque plaisir, mais qu'au contraire elle s'isole le plus complètement en elle-même en écartant le corps, et qu'elle rompt, autant qu'elle peut,
- Le travail: douleur ou plaisir ?
- Rôle du plaisir et de la douleur dans la vie humaine ?
- Commentaire linéaire sur « Alchimie de la douleur »
- essai sur la douleur et l'ennui