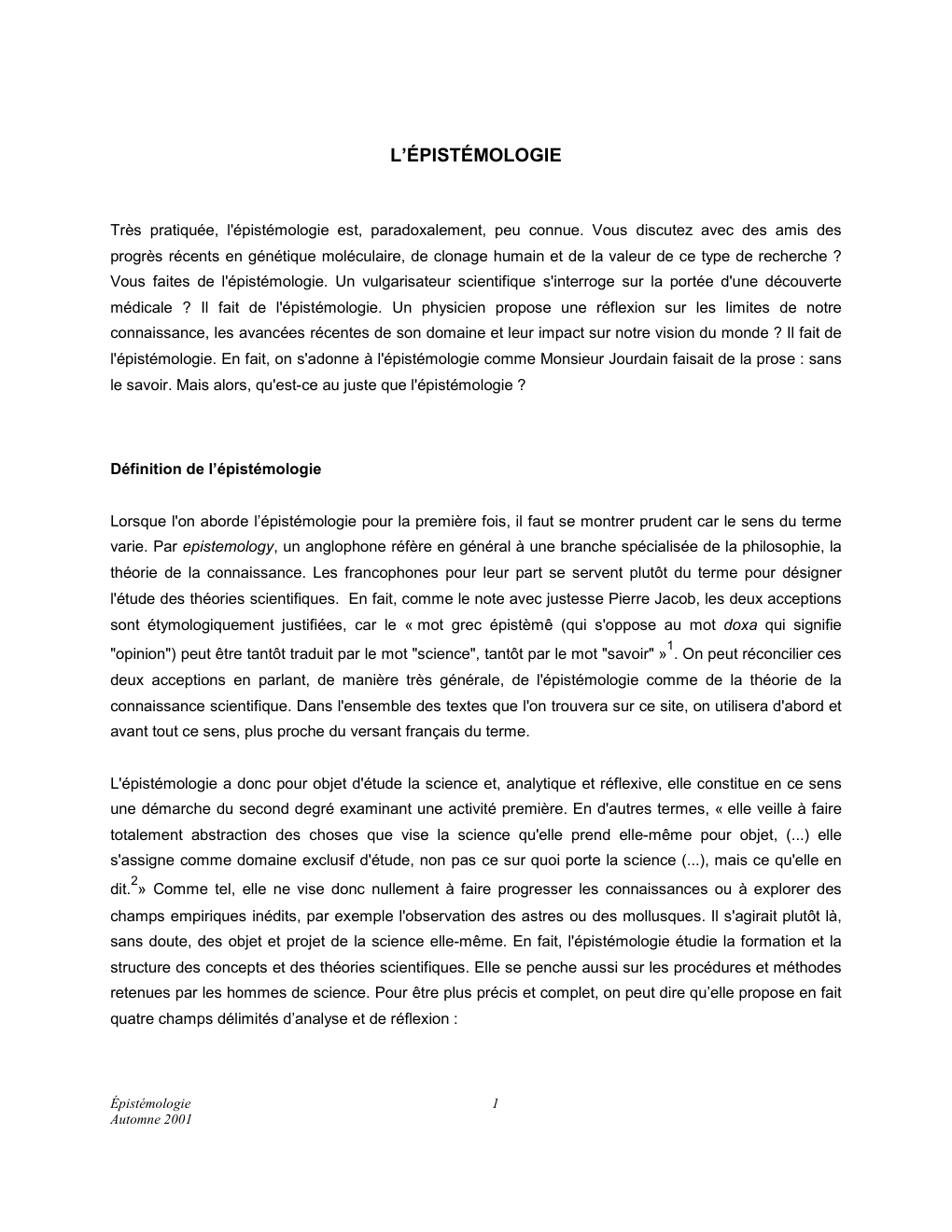L'épistémologie de Jean-Claude Simard
Publié le 10/11/2025
Extrait du document
«
L’ÉPISTÉMOLOGIE
Très pratiquée, l'épistémologie est, paradoxalement, peu connue.
Vous discutez avec des amis des
progrès récents en génétique moléculaire, de clonage humain et de la valeur de ce type de recherche ?
Vous faites de l'épistémologie.
Un vulgarisateur scientifique s'interroge sur la portée d'une découverte
médicale ? Il fait de l'épistémologie.
Un physicien propose une réflexion sur les limites de notre
connaissance, les avancées récentes de son domaine et leur impact sur notre vision du monde ? Il fait de
l'épistémologie.
En fait, on s'adonne à l'épistémologie comme Monsieur Jourdain faisait de la prose : sans
le savoir.
Mais alors, qu'est-ce au juste que l'épistémologie ?
Définition de l’épistémologie
Lorsque l'on aborde l’épistémologie pour la première fois, il faut se montrer prudent car le sens du terme
varie.
Par epistemology, un anglophone réfère en général à une branche spécialisée de la philosophie, la
théorie de la connaissance.
Les francophones pour leur part se servent plutôt du terme pour désigner
l'étude des théories scientifiques.
En fait, comme le note avec justesse Pierre Jacob, les deux acceptions
sont étymologiquement justifiées, car le « mot grec épistèmê (qui s'oppose au mot doxa qui signifie
1
"opinion") peut être tantôt traduit par le mot "science", tantôt par le mot "savoir" » .
On peut réconcilier ces
deux acceptions en parlant, de manière très générale, de l'épistémologie comme de la théorie de la
connaissance scientifique.
Dans l'ensemble des textes que l'on trouvera sur ce site, on utilisera d'abord et
avant tout ce sens, plus proche du versant français du terme.
L'épistémologie a donc pour objet d'étude la science et, analytique et réflexive, elle constitue en ce sens
une démarche du second degré examinant une activité première.
En d'autres termes, « elle veille à faire
totalement abstraction des choses que vise la science qu'elle prend elle-même pour objet, (...) elle
s'assigne comme domaine exclusif d'étude, non pas ce sur quoi porte la science (...), mais ce qu'elle en
2
dit.
» Comme tel, elle ne vise donc nullement à faire progresser les connaissances ou à explorer des
champs empiriques inédits, par exemple l'observation des astres ou des mollusques.
Il s'agirait plutôt là,
sans doute, des objet et projet de la science elle-même.
En fait, l'épistémologie étudie la formation et la
structure des concepts et des théories scientifiques.
Elle se penche aussi sur les procédures et méthodes
retenues par les hommes de science.
Pour être plus précis et complet, on peut dire qu’elle propose en fait
quatre champs délimités d’analyse et de réflexion :
Épistémologie
Automne 2001
1
1) la nature et la structure des concepts et des théories scientifiques, ce qu'on appelle parfois la
syntaxe des théories;
2) l'objet, la portée et la signification des concepts et des théories scientifiques, ce que, de manière
analogue, on appelle cette fois la sémantique des théories;
3) la méthode scientifique;
4) les limites et la valeur de l'entreprise scientifique.
Virieux a bien exprimé la chose en écrivant que l'épistémologie vise essentiellement « l'étude critique des
principes, des hypothèses et des résultats des diverses sciences ».
Elle veut « déterminer leur origine
3
logique, leur valeur et leur portée objective.
» En interrogeant la science elle-même, elle la scrute en fait
dans l'articulation de ses principes et de ses fondements.
En somme, on peut en conséquence dire que,
de manière générale, « l'épistémologie ou la philosophie de la science est une branche de la philosophie
4
qui étudie la recherche scientifique et son produit, la connaissance scientifique .»
Branches de l’épistémologie et exemples de problèmes traités
Étant donné les quatre champs d’analyse et de réflexion que nous avons identifiés, il s'ensuit que
l'épistémologie couvre grosso modo quatre types de questionnements différents.
De manière
schématique, on peut, pour la commodité de la chose, les regrouper ainsi :
1)
la logique de la science ou l'identification et l'analyse des problèmes logiques soulevés par la
science et la structure des théories scientifiques (problèmes de validité);
2)
la sémantique de la science ou l'analyse et l'évaluation des concepts de représentation, de
référence et d'interprétation appliqués aux outils théoriques de la recherche scientifique (problèmes
de signification et de vérité);
3)
la méthodologie de la science, c'est-à-dire l'étude de la méthode scientifique en général et la
question de l'existence éventuelle de méthodes spécifiques à certaines sciences (problèmes de
méthode);
4)
la théorie de la connaissance scientifique, c'est-à-dire le statut de ce type de connaissance et la
question de la démarcation entre science et non-science (problèmes des limites et de la valeur de
l'entreprise scientifique).
Épistémologie
Automne 2001
2
Évidemment, il est rare que l'un de ces divers niveaux d'analyse ne mette pas plus ou moins directement
en cause les autres, de sorte que, dans l'étude d'une question donnée, ils s'interpénètrent très souvent.
À
titre indicatif, voici quelques exemples de problèmes traités par chacune de ces quatre branches de
l'épistémologie.
1)
Problèmes de logique et de validité de la science ainsi que de la structure des théories
scientifiques : comment formaliser une théorie ? Quel est le statut des objets mathématiques :
s'agit-il de fictions utiles ou plutôt d'objets « réels » ? Quel est le statut logique d'une théorie comme
la théorie de l'évolution : a-t-elle la même valeur qu'une théorie physique comme, par exemple, la
relativité restreinte ? Quel type de logique convient aux résultats étonnants de la mécanique
quantique ? Est-ce encore la logique dite classique ? Quel est le rapport entre une théorie et une
loi ? et une loi est-elle toujours de nature mathématique ? Existe-t-il de véritables lois en sciences
humaines ?
2)
Problèmes de signification et de vérité : quel est le champ d'application de tel concept ou de telle
théorie ? (Quel est par exemple l'objet exact de l'évolution : les individus, les populations ou les
espèces ? et à quoi se réfère-t-on au juste en biologie lorsqu'on parle d'une espèce ?) Quelle
relation exacte peut-on établir entre l'observation et la théorie, par exemple la seconde dérive-t-elle
directement de la première ? En science, existe-t-il des concepts empiriques et des concepts
théoriques ? Comment interpréter les statistiques ? Quel est l'objet exact de la mécanique
quantique ?
3)
Problèmes de méthode : y a-t-il une ou des méthodes scientifiques ? Et d'ailleurs, y a-t-il au départ
une méthode scientifique standard ou seulement diverses procédures empiriques ? Une même
méthode peut-elle comporter différentes techniques ? Les sciences sociales et humaines ont-elles
une méthode rigoureuse et, si oui, est-ce la même que celle des sciences dites exactes ? Peut-on
confirmer une théorie scientifique ou ne confirme-t-on que des hypothèses isolées ? Une telle
confirmation a-t-elle des degrés ? Si oui, peut-on mesurer le degré de confirmation d'une hypothèse
ou d'un système d'hypothèses ? Quelle est la valeur de l'induction en science ?
4)
Problèmes des limites et de la valeur de l'entreprise scientifique : qu'est-ce qui est scientifique et
qu'est-ce qui ne l'est pas ? Existe-t-il de fausses sciences ? Comment détecter et reconnaître une
fraude scientifique ? Le savant peut-il vraiment être neutre et objectif ou est-ce un idéal inaccessible
? Notre connaissance progresse-t-elle sans cesse ou existe-t-il des limites inscrites dans la nature
ou encore dans nos instruments d'observation et de mesure ? Quand au juste est-on légitimé
d'utiliser le concept de probabilité : seulement quand on ne dispose pas d'informations suffisantes ?
Épistémologie
Automne 2001
3
Science, métascience et épistémologies interne ou externe
On le voit, les questions soulevées par la réflexion épistémologique sont nombreuses et difficiles.
Mais
dès le départ, une question préalable s’impose : en quoi la science nécessite-t-elle donc une discipline qui
vienne s'y superposer pour l'étudier et l'analyser en détail ? Pourquoi une activité qui elle-même analyse —
c'est le cas de la science — nécessiterait-elle une vérification ? Après tout, la science elle-même prétend
être une entreprise d'élucidation dont les résultats sont vérifiables et objectifs.
En d'autres termes,
5
l'existence de l'épistémologie comme discipline est-elle justifiée ? Et si oui, est-ce une métascience ?
Certes, pour prétendre à un tel statut, elle devrait s'imposer un souci de rigueur et d'objectivité au moins
comparable à celui que l'on reconnaît à son objet.
L'épistémologie peut-elle adopter le degré d'efficience
de la science sans s'y incorporer, et tout en ne considérant pas les objets mêmes étudiés par son objet ?
Reconnaissons d'abord que ce qui fait le propre de l'une et de l'autre n'est pas aisément dissociable.
Si
l'on peut opérer théoriquement une distinction entre une science et son objet, il est nettement plus ardu de
les dissocier dans la pratique.
Par ailleurs, l'intrication épistémologie-science est telle qu'on ne peut guère
s'occuper de la première sans empiéter sur le terrain de la seconde.
Pour circonvenir ces problèmes, les
logiciens ont reconnu une hiérarchie des langages et distingué soigneusement le langage objectif de la
science et le métalangage de l'épistémologie.
On entend ici par métalangage un langage qui porte sur un
autre langage.
Dans cette optique, on considère donc la science elle-même comme une entreprise
attachée à décrire et à analyser un champ empirique déterminé et qui,....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Jean-Claude Grumbach, scénariste et dramaturge contemporain, confie à un journaliste qu'il observe le monde « avec un oeil sur le sordide, un oeil sur le sublime ». En vous appuyant sur les oeuvres que vous connaissez, sans vous limiter nécessairement au
- « Au commencement était le Verbe » JEAN
- «Il n’y a plus d’ailleurs» CLAUDE LÉVI-STRAUSS
- Jean-Jacques ROUSSEAU (1712-1778) Profession de foi du vicaire savoyard (dans Émile)
- Cours épistémologie