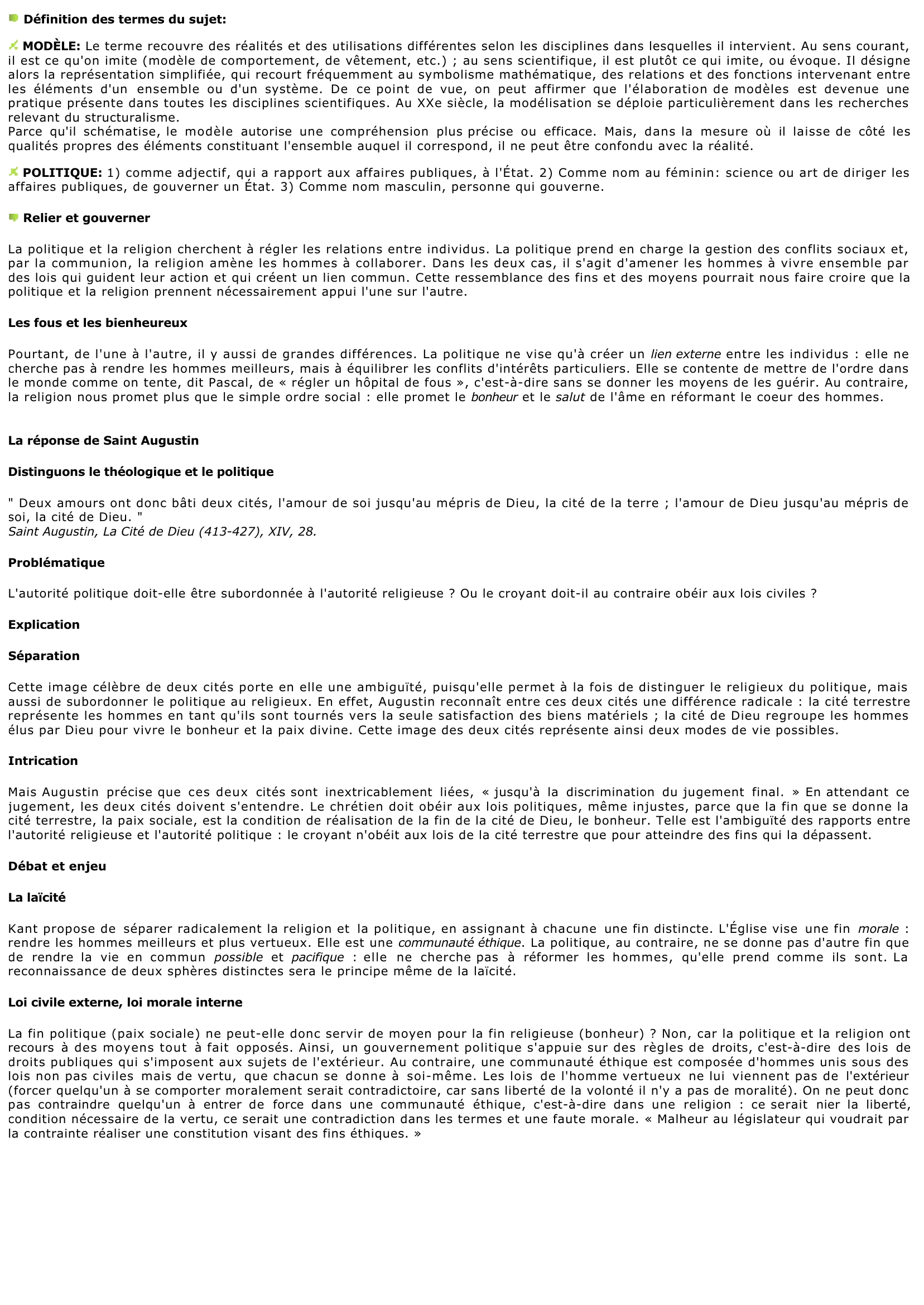L’autorité religieuse est-elle le modèle de l’autorité politique ?
Extrait du document
«
Définition des termes du sujet:
MODÈLE: Le terme recouvre des réalités et des utilisations différentes selon les disciplines dans lesquelles il intervient.
Au sens courant,
il est ce qu'on imite (modèle de comportement, de vêtement, etc.) ; au sens scientifique, il est plutôt ce qui imite, ou évoque.
Il désigne
alors la représentation simplifiée, qui recourt fréquemment au symbolisme mathématique, des relations et des fonctions intervenant entre
les éléments d'un ensemble ou d'un système.
De ce point de vue, on peut affirmer que l'élaboration de modèles est devenue une
pratique présente dans toutes les disciplines scientifiques.
Au XXe siècle, la modélisation se déploie particulièrement dans les recherches
relevant du structuralisme.
Parce qu'il schématise, le modèle autorise une compréhension plus précise ou efficace.
Mais, dans la mesure où il laisse de côté les
qualités propres des éléments constituant l'ensemble auquel il correspond, il ne peut être confondu avec la réalité.
POLITIQUE: 1) comme adjectif, qui a rapport aux affaires publiques, à l'État.
2) Comme nom au féminin: science ou art de diriger les
affaires publiques, de gouverner un État.
3) Comme nom masculin, personne qui gouverne.
Relier et gouverner
La politique et la religion cherchent à régler les relations entre individus.
La politique prend en charge la gestion des conflits sociaux et,
par la communion, la religion amène les hommes à collaborer.
Dans les deux cas, il s'agit d'amener les hommes à vivre ensemble par
des lois qui guident leur action et qui créent un lien commun.
Cette ressemblance des fins et des moyens pourrait nous faire croire que la
politique et la religion prennent nécessairement appui l'une sur l'autre.
Les fous et les bienheureux
Pourtant, de l'une à l'autre, il y aussi de grandes différences.
La politique ne vise qu'à créer un lien externe entre les individus : elle ne
cherche pas à rendre les hommes meilleurs, mais à équilibrer les conflits d'intérêts particuliers.
Elle se contente de mettre de l'ordre dans
le monde comme on tente, dit Pascal, de « régler un hôpital de fous », c'est-à-dire sans se donner les moyens de les guérir.
Au contraire,
la religion nous promet plus que le simple ordre social : elle promet le bonheur et le salut de l'âme en réformant le coeur des hommes.
La réponse de Saint Augustin
Distinguons le théologique et le politique
" Deux amours ont donc bâti deux cités, l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu, la cité de la terre ; l'amour de Dieu jusqu'au mépris de
soi, la cité de Dieu.
"
Saint Augustin, La Cité de Dieu (413-427), XIV, 28.
Problématique
L'autorité politique doit-elle être subordonnée à l'autorité religieuse ? Ou le croyant doit-il au contraire obéir aux lois civiles ?
Explication
Séparation
Cette image célèbre de deux cités porte en elle une ambiguïté, puisqu'elle permet à la fois de distinguer le religieux du politique, mais
aussi de subordonner le politique au religieux.
En effet, Augustin reconnaît entre ces deux cités une différence radicale : la cité terrestre
représente les hommes en tant qu'ils sont tournés vers la seule satisfaction des biens matériels ; la cité de Dieu regroupe les hommes
élus par Dieu pour vivre le bonheur et la paix divine.
Cette image des deux cités représente ainsi deux modes de vie possibles.
Intrication
Mais Augustin précise que ces deux cités sont inextricablement liées, « jusqu'à la discrimination du jugement final.
» En attendant ce
jugement, les deux cités doivent s'entendre.
Le chrétien doit obéir aux lois politiques, même injustes, parce que la fin que se donne la
cité terrestre, la paix sociale, est la condition de réalisation de la fin de la cité de Dieu, le bonheur.
Telle est l'ambiguïté des rapports entre
l'autorité religieuse et l'autorité politique : le croyant n'obéit aux lois de la cité terrestre que pour atteindre des fins qui la dépassent.
Débat et enjeu
La laïcité
Kant propose de séparer radicalement la religion et la politique, en assignant à chacune une fin distincte.
L'Église vise une fin morale :
rendre les hommes meilleurs et plus vertueux.
Elle est une communauté éthique.
La politique, au contraire, ne se donne pas d'autre fin que
de rendre la vie en commun possible et pacifique : elle ne cherche pas à réformer les hommes, qu'elle prend comme ils sont.
La
reconnaissance de deux sphères distinctes sera le principe même de la laïcité.
Loi civile externe, loi morale interne
La fin politique (paix sociale) ne peut-elle donc servir de moyen pour la fin religieuse (bonheur) ? Non, car la politique et la religion ont
recours à des moyens tout à fait opposés.
Ainsi, un gouvernement politique s'appuie sur des règles de droits, c'est-à-dire des lois de
droits publiques qui s'imposent aux sujets de l'extérieur.
Au contraire, une communauté éthique est composée d'hommes unis sous des
lois non pas civiles mais de vertu, que chacun se donne à soi-même.
Les lois de l'homme vertueux ne lui viennent pas de l'extérieur
(forcer quelqu'un à se comporter moralement serait contradictoire, car sans liberté de la volonté il n'y a pas de moralité).
On ne peut donc
pas contraindre quelqu'un à entrer de force dans une communauté éthique, c'est-à-dire dans une religion : ce serait nier la liberté,
condition nécessaire de la vertu, ce serait une contradiction dans les termes et une faute morale.
« Malheur au législateur qui voudrait par
la contrainte réaliser une constitution visant des fins éthiques.
».
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- La compétence technique peut-elle fonder l'autorité politique ?
- L'autorité politique peut-elle limiter la liberté de pensée?
- Les compétences techniques peuvent-elles fonder l'autorité politique ?
- Le pouvoir politique peut-il se défaire d'une Autorité de référence ?
- La politique n'est-elle qu'un art du calcul ?