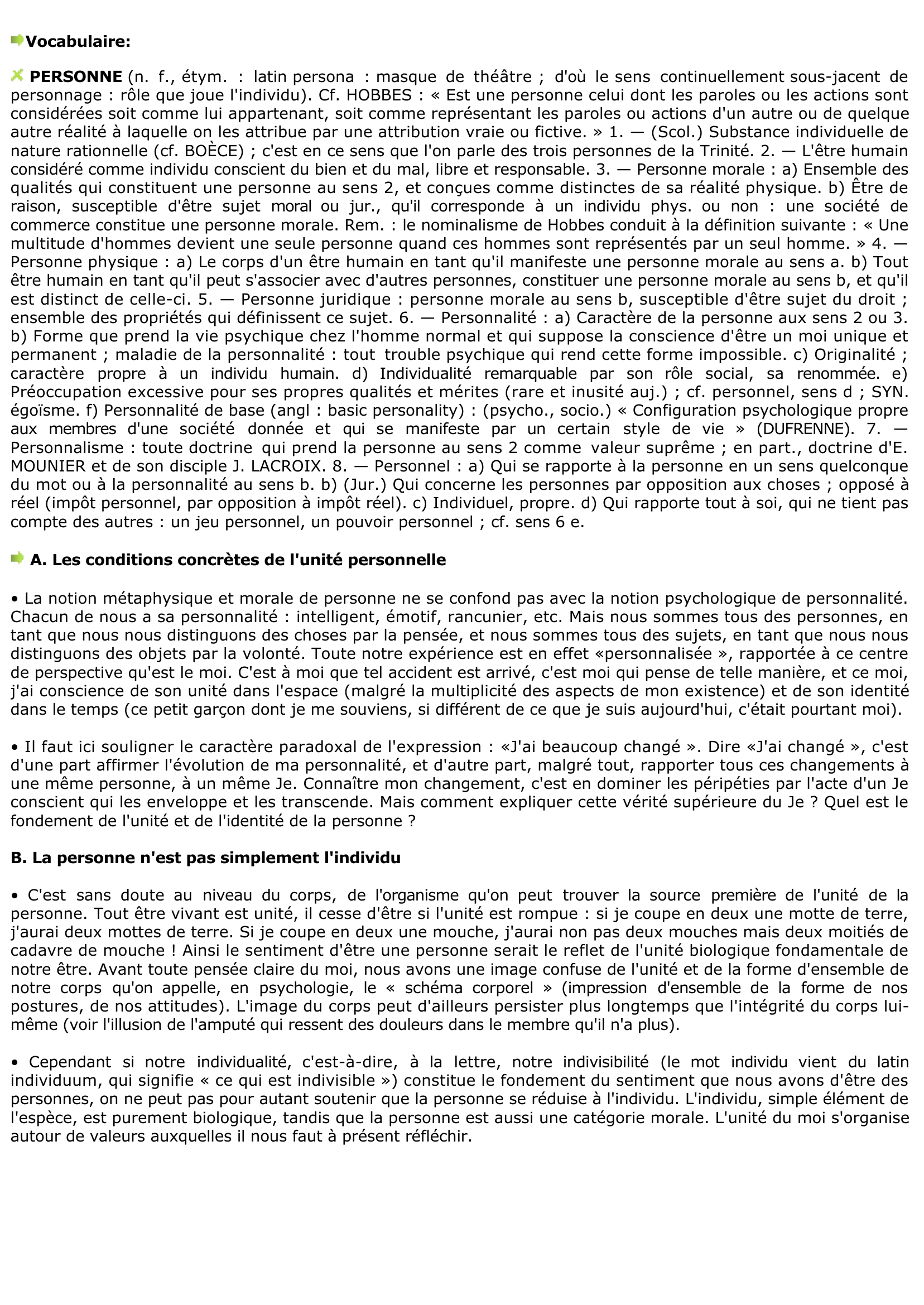La notion de personne
Extrait du document
«
Vocabulaire:
PERSONNE (n.
f., étym.
: latin persona : masque de théâtre ; d'où le sens continuellement sous-jacent de
personnage : rôle que joue l'individu).
Cf.
HOBBES : « Est une personne celui dont les paroles ou les actions sont
considérées soit comme lui appartenant, soit comme représentant les paroles ou actions d'un autre ou de quelque
autre réalité à laquelle on les attribue par une attribution vraie ou fictive.
» 1.
— (Scol.) Substance individuelle de
nature rationnelle (cf.
BOÈCE) ; c'est en ce sens que l'on parle des trois personnes de la Trinité.
2.
— L'être humain
considéré comme individu conscient du bien et du mal, libre et responsable.
3.
— Personne morale : a) Ensemble des
qualités qui constituent une personne au sens 2, et conçues comme distinctes de sa réalité physique.
b) Être de
raison, susceptible d'être sujet moral ou jur., qu'il corresponde à un individu phys.
ou non : une société de
commerce constitue une personne morale.
Rem.
: le nominalisme de Hobbes conduit à la définition suivante : « Une
multitude d'hommes devient une seule personne quand ces hommes sont représentés par un seul homme.
» 4.
—
Personne physique : a) Le corps d'un être humain en tant qu'il manifeste une personne morale au sens a.
b) Tout
être humain en tant qu'il peut s'associer avec d'autres personnes, constituer une personne morale au sens b, et qu'il
est distinct de celle-ci.
5.
— Personne juridique : personne morale au sens b, susceptible d'être sujet du droit ;
ensemble des propriétés qui définissent ce sujet.
6.
— Personnalité : a) Caractère de la personne aux sens 2 ou 3.
b) Forme que prend la vie psychique chez l'homme normal et qui suppose la conscience d'être un moi unique et
permanent ; maladie de la personnalité : tout trouble psychique qui rend cette forme impossible.
c) Originalité ;
caractère propre à un individu humain.
d) Individualité remarquable par son rôle social, sa renommée.
e)
Préoccupation excessive pour ses propres qualités et mérites (rare et inusité auj.) ; cf.
personnel, sens d ; SYN.
égoïsme.
f) Personnalité de base (angl : basic personality) : (psycho., socio.) « Configuration psychologique propre
aux membres d'une société donnée et qui se manifeste par un certain style de vie » (DUFRENNE).
7.
—
Personnalisme : toute doctrine qui prend la personne au sens 2 comme valeur suprême ; en part., doctrine d'E.
MOUNIER et de son disciple J.
LACROIX.
8.
— Personnel : a) Qui se rapporte à la personne en un sens quelconque
du mot ou à la personnalité au sens b.
b) (Jur.) Qui concerne les personnes par opposition aux choses ; opposé à
réel (impôt personnel, par opposition à impôt réel).
c) Individuel, propre.
d) Qui rapporte tout à soi, qui ne tient pas
compte des autres : un jeu personnel, un pouvoir personnel ; cf.
sens 6 e.
A.
Les conditions concrètes de l'unité personnelle
• La notion métaphysique et morale de personne ne se confond pas avec la notion psychologique de personnalité.
Chacun de nous a sa personnalité : intelligent, émotif, rancunier, etc.
Mais nous sommes tous des personnes, en
tant que nous nous distinguons des choses par la pensée, et nous sommes tous des sujets, en tant que nous nous
distinguons des objets par la volonté.
Toute notre expérience est en effet «personnalisée », rapportée à ce centre
de perspective qu'est le moi.
C'est à moi que tel accident est arrivé, c'est moi qui pense de telle manière, et ce moi,
j'ai conscience de son unité dans l'espace (malgré la multiplicité des aspects de mon existence) et de son identité
dans le temps (ce petit garçon dont je me souviens, si différent de ce que je suis aujourd'hui, c'était pourtant moi).
• Il faut ici souligner le caractère paradoxal de l'expression : «J'ai beaucoup changé ».
Dire «J'ai changé », c'est
d'une part affirmer l'évolution de ma personnalité, et d'autre part, malgré tout, rapporter tous ces changements à
une même personne, à un même Je.
Connaître mon changement, c'est en dominer les péripéties par l'acte d'un Je
conscient qui les enveloppe et les transcende.
Mais comment expliquer cette vérité supérieure du Je ? Quel est le
fondement de l'unité et de l'identité de la personne ?
B.
La personne n'est pas simplement l'individu
• C'est sans doute au niveau du corps, de l'organisme qu'on peut trouver la source première de l'unité de la
personne.
Tout être vivant est unité, il cesse d'être si l'unité est rompue : si je coupe en deux une motte de terre,
j'aurai deux mottes de terre.
Si je coupe en deux une mouche, j'aurai non pas deux mouches mais deux moitiés de
cadavre de mouche ! Ainsi le sentiment d'être une personne serait le reflet de l'unité biologique fondamentale de
notre être.
Avant toute pensée claire du moi, nous avons une image confuse de l'unité et de la forme d'ensemble de
notre corps qu'on appelle, en psychologie, le « schéma corporel » (impression d'ensemble de la forme de nos
postures, de nos attitudes).
L'image du corps peut d'ailleurs persister plus longtemps que l'intégrité du corps luimême (voir l'illusion de l'amputé qui ressent des douleurs dans le membre qu'il n'a plus).
• Cependant si notre individualité, c'est-à-dire, à la lettre, notre indivisibilité (le mot individu vient du latin
individuum, qui signifie « ce qui est indivisible ») constitue le fondement du sentiment que nous avons d'être des
personnes, on ne peut pas pour autant soutenir que la personne se réduise à l'individu.
L'individu, simple élément de
l'espèce, est purement biologique, tandis que la personne est aussi une catégorie morale.
L'unité du moi s'organise
autour de valeurs auxquelles il nous faut à présent réfléchir..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Notion de la technique (résumé)
- NOTION DE DROIT (2)
- Notion : L'art (fiche)
- La notion d'Inconscient collectif
- La notion de défense en psychanalyse