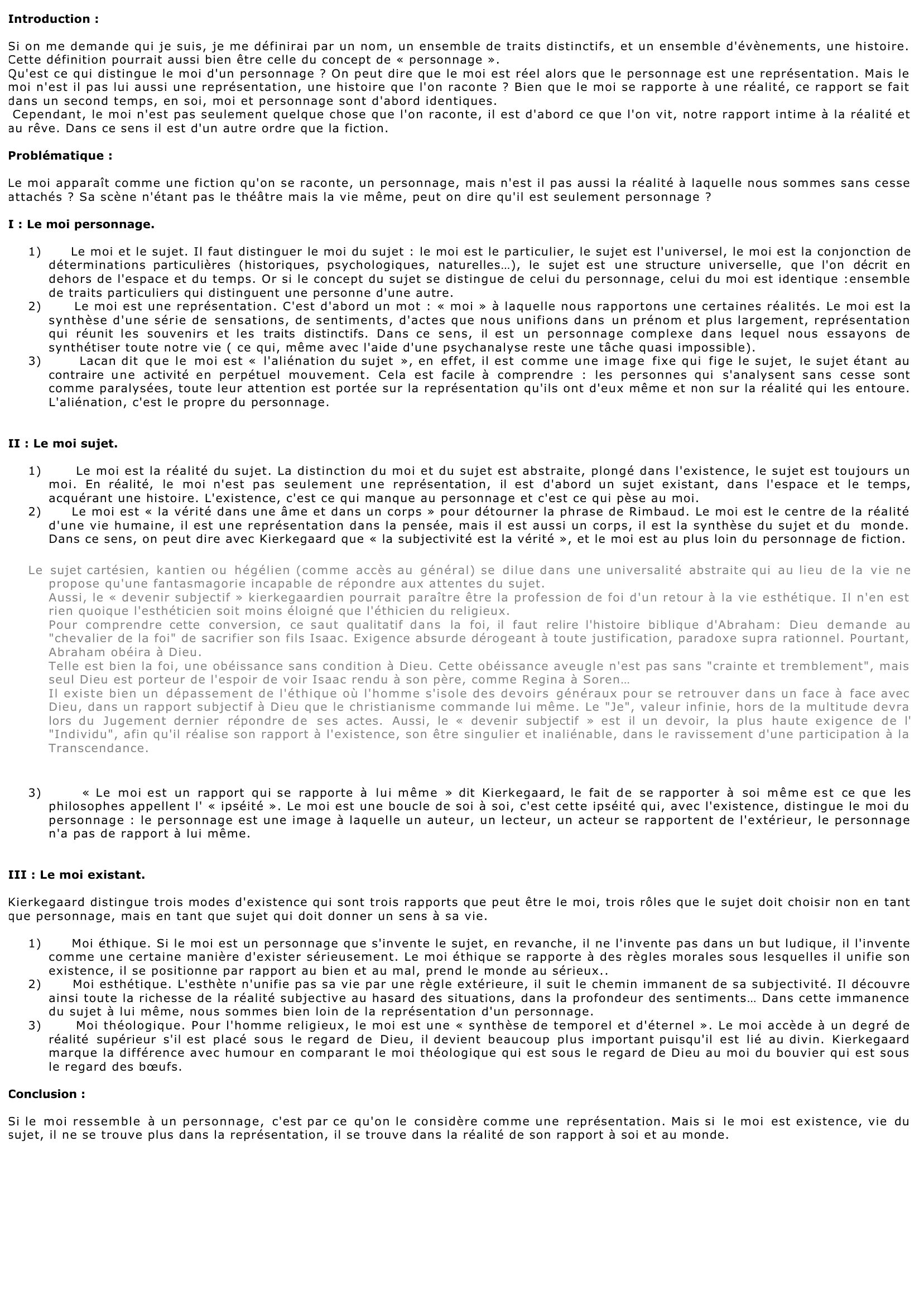ce que j'appelle moi" est il autre chose qu'un personnage ?"
Extrait du document
«
Introduction :
Si on me demande qui je suis, je me définirai par un nom, un ensemble de traits distinctifs, et un ensemble d'évènements, une histoire.
Cette définition pourrait aussi bien être celle du concept de « personnage ».
Qu'est ce qui distingue le moi d'un personnage ? On peut dire que le moi est réel alors que le personnage est une représentation.
Mais le
moi n'est il pas lui aussi une représentation, une histoire que l'on raconte ? Bien que le moi se rapporte à une réalité, ce rapport se fait
dans un second temps, en soi, moi et personnage sont d'abord identiques.
Cependant, le moi n'est pas seulement quelque chose que l'on raconte, il est d'abord ce que l'on vit, notre rapport intime à la réalité et
au rêve.
Dans ce sens il est d'un autre ordre que la fiction.
Problématique :
Le moi apparaît comme une fiction qu'on se raconte, un personnage, mais n'est il pas aussi la réalité à laquelle nous sommes sans cesse
attachés ? Sa scène n'étant pas le théâtre mais la vie même, peut on dire qu'il est seulement personnage ?
I : Le moi personnage.
1)
Le moi et le sujet.
Il faut distinguer le moi du sujet : le moi est le particulier, le sujet est l'universel, le moi est la conjonction de
déterminations particulières (historiques, psychologiques, naturelles…), le sujet est une structure universelle, que l'on décrit en
dehors de l'espace et du temps.
Or si le concept du sujet se distingue de celui du personnage, celui du moi est identique :ensemble
de traits particuliers qui distinguent une personne d'une autre.
2)
Le moi est une représentation.
C'est d'abord un mot : « moi » à laquelle nous rapportons une certaines réalités.
Le moi est la
synthèse d'une série de sensations, de sentiments, d'actes que nous unifions dans un prénom et plus largement, représentation
qui réunit les souvenirs et les traits distinctifs.
Dans ce sens, il est un personnage complexe dans lequel nous essayons de
synthétiser toute notre vie ( ce qui, même avec l'aide d'une psychanalyse reste une tâche quasi impossible).
3)
Lacan dit q u e l e moi est « l'aliénation du sujet », en effet, il est c o m m e u n e i m a g e fixe qui fige le sujet, le sujet étant au
contraire u n e activité en perpétuel mouvement.
Cela est facile à comprendre : les personnes qui s'analysent sans cesse sont
comme paralysées, toute leur attention est portée sur la représentation qu'ils ont d'eux même et non sur la réalité qui les entoure.
L'aliénation, c'est le propre du personnage.
II : Le moi sujet.
1)
Le moi est la réalité du sujet.
La distinction du moi et du sujet est abstraite, plongé dans l'existence, le sujet est toujours un
moi.
En réalité, le moi n'est pas seulement u n e représentation, il est d'abord un sujet existant, dans l'espace et le temps,
acquérant une histoire.
L'existence, c'est ce qui manque au personnage et c'est ce qui pèse au moi.
2)
Le moi est « la vérité dans une âme et dans un corps » pour détourner la phrase de Rimbaud.
Le moi est le centre de la réalité
d'une vie humaine, il est une représentation dans la pensée, mais il est aussi un corps, il est la synthèse du sujet et du monde.
Dans ce sens, on peut dire avec Kierkegaard que « la subjectivité est la vérité », et le moi est au plus loin du personnage de fiction.
Le sujet cartésien, kantien ou hégélien (comme accès au général) se dilue dans une universalité abstraite qui au lieu de la vie ne
propose qu'une fantasmagorie incapable de répondre aux attentes du sujet.
Aussi, le « devenir subjectif » kierkegaardien pourrait paraître être la profession de foi d'un retour à la vie esthétique.
Il n'en est
rien quoique l'esthéticien soit moins éloigné que l'éthicien du religieux.
Pour comprendre cette conversion, ce saut qualitatif dans la foi, il faut relire l'histoire biblique d'Abraham: Dieu demande au
"chevalier de la foi" de sacrifier son fils Isaac.
Exigence absurde dérogeant à toute justification, paradoxe supra rationnel.
Pourtant,
Abraham obéira à Dieu.
Telle est bien la foi, une obéissance sans condition à Dieu.
Cette obéissance aveugle n'est pas sans "crainte et tremblement", mais
seul Dieu est porteur de l'espoir de voir Isaac rendu à son père, comme Regina à Soren…
Il existe bien un dépassement de l'éthique où l'homme s'isole des devoirs généraux pour se retrouver dans un face à face avec
Dieu, dans un rapport subjectif à Dieu que le christianisme commande lui même.
Le "Je", valeur infinie, hors de la multitude devra
lors du Jugement dernier répondre d e s e s actes.
Aussi, le « devenir subjectif » est il un devoir, la plus haute exigence d e l'
"Individu", afin qu'il réalise son rapport à l'existence, son être singulier et inaliénable, dans le ravissement d'une participation à la
Transcendance.
3)
« Le moi est un rapport qui se rapporte à l u i m ê m e » dit Kierkegaard, le fait d e se rapporter à soi m ê m e e s t ce q u e les
philosophes appellent l' « ipséité ».
Le moi est une boucle de soi à soi, c'est cette ipséité qui, avec l'existence, distingue le moi du
personnage : le personnage est une image à laquelle un auteur, un lecteur, un acteur se rapportent de l'extérieur, le personnage
n'a pas de rapport à lui même.
III : Le moi existant.
Kierkegaard distingue trois modes d'existence qui sont trois rapports que peut être le moi, trois rôles que le sujet doit choisir non en tant
que personnage, mais en tant que sujet qui doit donner un sens à sa vie.
1)
Moi éthique.
Si le moi est un personnage que s'invente le sujet, en revanche, il ne l'invente pas dans un but ludique, il l'invente
comme une certaine manière d'exister sérieusement.
Le moi éthique se rapporte à des règles morales sous lesquelles il unifie son
existence, il se positionne par rapport au bien et au mal, prend le monde au sérieux..
2)
Moi esthétique.
L'esthète n'unifie pas sa vie par une règle extérieure, il suit le chemin immanent de sa subjectivité.
Il découvre
ainsi toute la richesse de la réalité subjective au hasard des situations, dans la profondeur des sentiments… Dans cette immanence
du sujet à lui même, nous sommes bien loin de la représentation d'un personnage.
3)
Moi théologique.
Pour l'homme religieux, le moi est une « synthèse de temporel et d'éternel ».
Le moi accède à un degré de
réalité supérieur s'il est placé sous le regard d e Dieu, il devient beaucoup plus important puisqu'il est lié au divin.
Kierkegaard
marque la différence avec humour en comparant le moi théologique qui est sous le regard de Dieu au moi du bouvier qui est sous
le regard des bœufs.
Conclusion :
Si le moi ressemble à un personnage, c'est par ce qu'on le considère comme une représentation.
Mais si le moi est existence, vie du
sujet, il ne se trouve plus dans la représentation, il se trouve dans la réalité de son rapport à soi et au monde..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- « L’opinion est quelque chose d’intermédiaire entre la connaissance et l’ignorance... » PLATON
- Toutes les propositions de logique disent la même chose. A savoir rien. Wittgenstein
- Avons-nous quelque chose à apprendre de nos erreurs ?
- La poésie peut-elle quelque chose contre la laideur du monde ?
- chose vue un jour de printemps