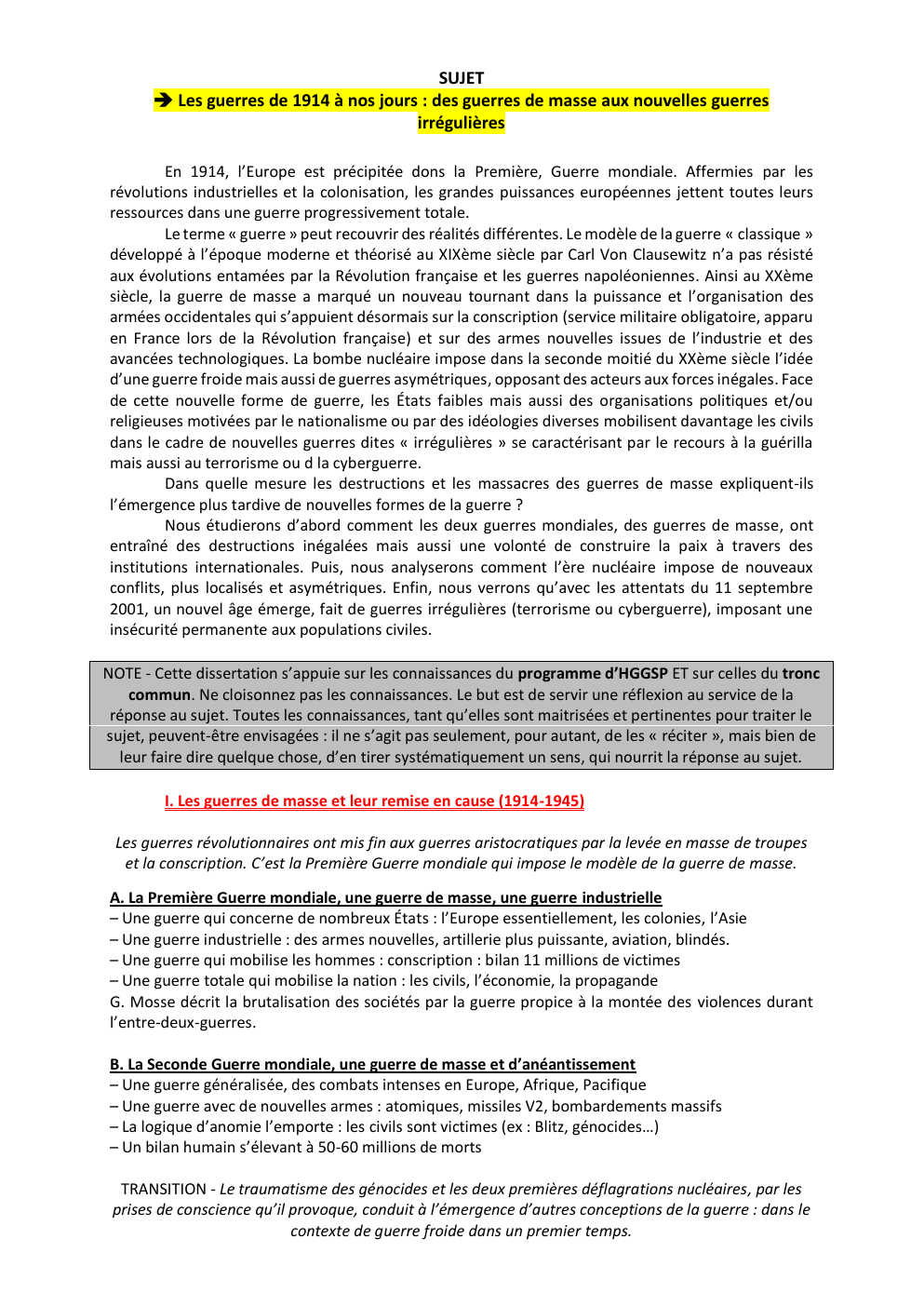➔ Les guerres de 1914 à nos jours : des guerres de masse aux nouvelles guerres irrégulières
Publié le 01/10/2025
Extrait du document
«
SUJET
➔ Les guerres de 1914 à nos jours : des guerres de masse aux nouvelles guerres
irrégulières
En 1914, l’Europe est précipitée dons la Première, Guerre mondiale.
Affermies par les
révolutions industrielles et la colonisation, les grandes puissances européennes jettent toutes leurs
ressources dans une guerre progressivement totale.
Le terme « guerre » peut recouvrir des réalités différentes.
Le modèle de la guerre « classique »
développé à l’époque moderne et théorisé au XIXème siècle par Carl Von Clausewitz n’a pas résisté
aux évolutions entamées par la Révolution française et les guerres napoléoniennes.
Ainsi au XXème
siècle, la guerre de masse a marqué un nouveau tournant dans la puissance et l’organisation des
armées occidentales qui s’appuient désormais sur la conscription (service militaire obligatoire, apparu
en France lors de la Révolution française) et sur des armes nouvelles issues de l’industrie et des
avancées technologiques.
La bombe nucléaire impose dans la seconde moitié du XXème siècle l’idée
d’une guerre froide mais aussi de guerres asymétriques, opposant des acteurs aux forces inégales.
Face
de cette nouvelle forme de guerre, les États faibles mais aussi des organisations politiques et/ou
religieuses motivées par le nationalisme ou par des idéologies diverses mobilisent davantage les civils
dans le cadre de nouvelles guerres dites « irrégulières » se caractérisant par le recours à la guérilla
mais aussi au terrorisme ou d la cyberguerre.
Dans quelle mesure les destructions et les massacres des guerres de masse expliquent-ils
l’émergence plus tardive de nouvelles formes de la guerre ?
Nous étudierons d’abord comment les deux guerres mondiales, des guerres de masse, ont
entraîné des destructions inégalées mais aussi une volonté de construire la paix à travers des
institutions internationales.
Puis, nous analyserons comment l’ère nucléaire impose de nouveaux
conflits, plus localisés et asymétriques.
Enfin, nous verrons qu’avec les attentats du 11 septembre
2001, un nouvel âge émerge, fait de guerres irrégulières (terrorisme ou cyberguerre), imposant une
insécurité permanente aux populations civiles.
NOTE - Cette dissertation s’appuie sur les connaissances du programme d’HGGSP ET sur celles du tronc
commun.
Ne cloisonnez pas les connaissances.
Le but est de servir une réflexion au service de la
réponse au sujet.
Toutes les connaissances, tant qu’elles sont maitrisées et pertinentes pour traiter le
sujet, peuvent-être envisagées : il ne s’agit pas seulement, pour autant, de les « réciter », mais bien de
leur faire dire quelque chose, d’en tirer systématiquement un sens, qui nourrit la réponse au sujet.
I.
Les guerres de masse et leur remise en cause (1914-1945)
Les guerres révolutionnaires ont mis fin aux guerres aristocratiques par la levée en masse de troupes
et la conscription.
C’est la Première Guerre mondiale qui impose le modèle de la guerre de masse.
A.
La Première Guerre mondiale, une guerre de masse, une guerre industrielle
– Une guerre qui concerne de nombreux États : l’Europe essentiellement, les colonies, l’Asie
– Une guerre industrielle : des armes nouvelles, artillerie plus puissante, aviation, blindés.
– Une guerre qui mobilise les hommes : conscription : bilan 11 millions de victimes
– Une guerre totale qui mobilise la nation : les civils, l’économie, la propagande
G.
Mosse décrit la brutalisation des sociétés par la guerre propice à la montée des violences durant
l’entre-deux-guerres.
B.
La Seconde Guerre mondiale, une guerre de masse et d’anéantissement
– Une guerre généralisée, des combats intenses en Europe, Afrique, Pacifique
– Une guerre avec de nouvelles armes : atomiques, missiles V2, bombardements massifs
– La logique d’anomie l’emporte : les civils sont victimes (ex : Blitz, génocides…)
– Un bilan humain s’élevant à 50-60 millions de morts
TRANSITION - Le traumatisme des génocides et les deux premières déflagrations nucléaires, par les
prises de conscience qu’il provoque, conduit à l’émergence d’autres conceptions de la guerre : dans le
contexte de guerre froide dans un premier temps.
II.
Les stratégies nouvelles des puissances : d’Hiroshima aux guerres asymétriques (1945-2001)
A.
Les facteurs de transformation : la menace d’une déflagration nucléaire
– La peur de la fin du monde/la dissuasion nucléaire
– Une lente diffusion de l’arme nucléaire au sein des États, malgré le traité de non-prolifération
– L’existence de petites puissances nucléaires : Israël, Pakistan
B.
Les guerres asymétriques des grandes puissances contre des États émergents
– Les guerres coloniales : guerre d’Indochine, guerre d’Algérie
– La guerre du Vietnam
– La guerre d’Afghanistan par l’URSS (dès 1979)
– La guerre première du Golfe (coalition internationale)
TRANSITION - Gérard Chaliand dans Le Nouvel Art de la guerre (2008) montre que les guerres
asymétriques ont jeté les bases des guerres irrégulières fondées sur la mobilité et la guérilla.
III.
L’émergence des nouvelles guerres irrégulières
A.
Les attentats du 11 septembre 2001 : une rupture dans le modèle clausewitzien de la guerre
(analyse du mode opératoire et réflexion sur le concept de « guerre réelle », ici mis à mal : importance
de l’idéologie, acteur transnational, etc.).
B.
La prolifération des actes terroristes dans des modes opératoires variés : attentats dans les grandes
capitales occidentales (Paris, Londres, Bruxelles, Madrid) mais également dans les pays musulmans.
Al
Qaïda et DAESH.
C.
Des nouvelles formes de combat technologiques et des guérillas traditionnelles : cyberattaques,
drones et technologies.
Recours à des sociétés privées de la part des occidentaux (Blackwater).
Des
formes de guérillas se maintiennent aussi, notamment en Afrique : Libye, Darfour, etc.
__________________________________________
EXEMPLES D’AUTRES SUJETS :
➔ Le rôle de l’ONU dans le maintien de la paix internationale depuis 1945
➔ Faire la guerre du XVIIIème siècle à la fin de la guerre froide
Période de temps long : difficile de comparer ce qui n'est pas comparable.
Un plan chronologicothématique (parties thématiques, sous-parties chronologiques OU BIEN l’inverse) semble ici possible,
chaque partie portant sur un type de transformation.
Plan possible [EN Y INJECTANT LA PENSÉE DE CLAUSEWITZ COMME FIL ROUGE ARGUMENTATIF] :
I/ De la guerre limitée entre États à la guerre de masse : la mutation des formes de guerre (XVIIIe –
XIXe siècles)
Objectif : montrer l’évolution des moyens et des cibles (du champ de bataille au civil), avec
progressive « montée aux extrêmes »
A - Guerre de Sept Ans : conflit interétatique classique, mais déjà globalisé (guerre « réelle » de
Clausewitz)
B - Révolution française et Empire : mobilisation nationale, guerre idéologique (levée en masse,
guerre totale, guerre napoléonienne).
II.
Une politisation croissante de la guerre : idéologies, régimes et stratégies de domination (1914–
1945)
Objectif : mettre en lumière l’extension des finalités de la guerre au-delà des objectifs strictement
militaires, au service de projets de société.
A – La première Guerre mondiale, une « guerre absolue » ? Industrialisation de la guerre,
mobilisation totale des sociétés
B - La guerre comme affrontement de modèles politiques : démocratie vs totalitarisme (Seconde
Guerre mondiale).
La guerre au service d’ambitions impériales, raciales, expansionnistes (nazisme,
Japon).
III.
Faire la guerre dans un monde bipolaire : dissuasion, conflits périphériques et nouvelles
asymétries (1947–1991)
Objectif : insister sur l’adaptation des modalités de guerre aux équilibres stratégiques nouveaux, avec
montée des conflits indirects ou non conventionnels.
A - La guerre comme outil d’influence dans la guerre froide : guerre par procuration (Vietnam,
Afghanistan), alliances militaires (OTAN, pacte de Varsovie).
B – Montée des guerres asymétrique et des acteurs non étatiques (guérillas, terrorisme, OLP,
Hamas…).
Plan possible alternatif (plan thématico-chronologique) :
I/ (constat) Des guerres de plus en plus meurtrières et mondialisées.
II/ (causes) Des guerres menées au nom d'intérêts qui ne sont pas seulement militaires.
III/ (typologie liée au finalités) Des guerres qui rappellent que la volonté de faire la paix est un des
objectifs d'un conflit (étude de la paix comme moteur des transformations des conflits : une paix
entre États vue comme finalité, puis une paix en écrasant l’ennemi, et enfin le désir d’une paix
universelle).
➔ La guerre et la paix à l’épreuve de la pensée de Clausewitz
Ce tableau donne des idées.
Reste à leur donner « corps » par des exemples précis tirés de tout le
thème, du tronc commun, de votre culture générale, etc.
PARTIE I/
La guerre « classique » : la
continuité de la politique
par d’autres moyens, et une
paix vue comme l’objectif
de toute guerre.
PARTIE II/
Guerre « absolue » selon
Clausewitz : la « montée
aux extrêmes », et de
nouvelles manières de faire
la paix.
PARTIE III/
La guerre
contemporaine met-elle en
échec la vision
clausewitzienne de la paix
et de la guerre (qui sont,
selon-lui, le fait des États) ?
SOUS PARTIE A :
Faire la guerre
Avant Clausewitz : conflits d'abord interétatiques
- Géographie : le champ de bataille.
Priorité à la guerre frontale
ou de siège.
- Combats entre armées professionnelles, de mercenaires ou
de conscription, mais peu nombreuses.
- Victimes d'abord militaires.
Le modèle de Clausewitz (guerres mondiales)
- Combats sur des fronts de plus en plus Larges grâce à l'essor
technique.
Au XXe siècle, naissance des armées de masse.
- Propagande pour diviser l'ennemi et coaliser les sujets et
citoyens : passions des peuples.
- Morts militaires mais aussi civils car ce....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- LA LITTERATURE DE L'ENTRE DEUX GUERRES
- Nouvelles de Maupassant: La moustache et le Lit.
- Pour qu’elle raison la démocratie birmane n’est-elle qu’une utopie de nos jours ?
- «L'histoire de toute société jusqu'à nos jours, c'est l'histoire de la lutte des classes» - Marx
- Le projet de devenir « maitre et possesseur de la nature » à-t-il encore un sens de nos jours ?