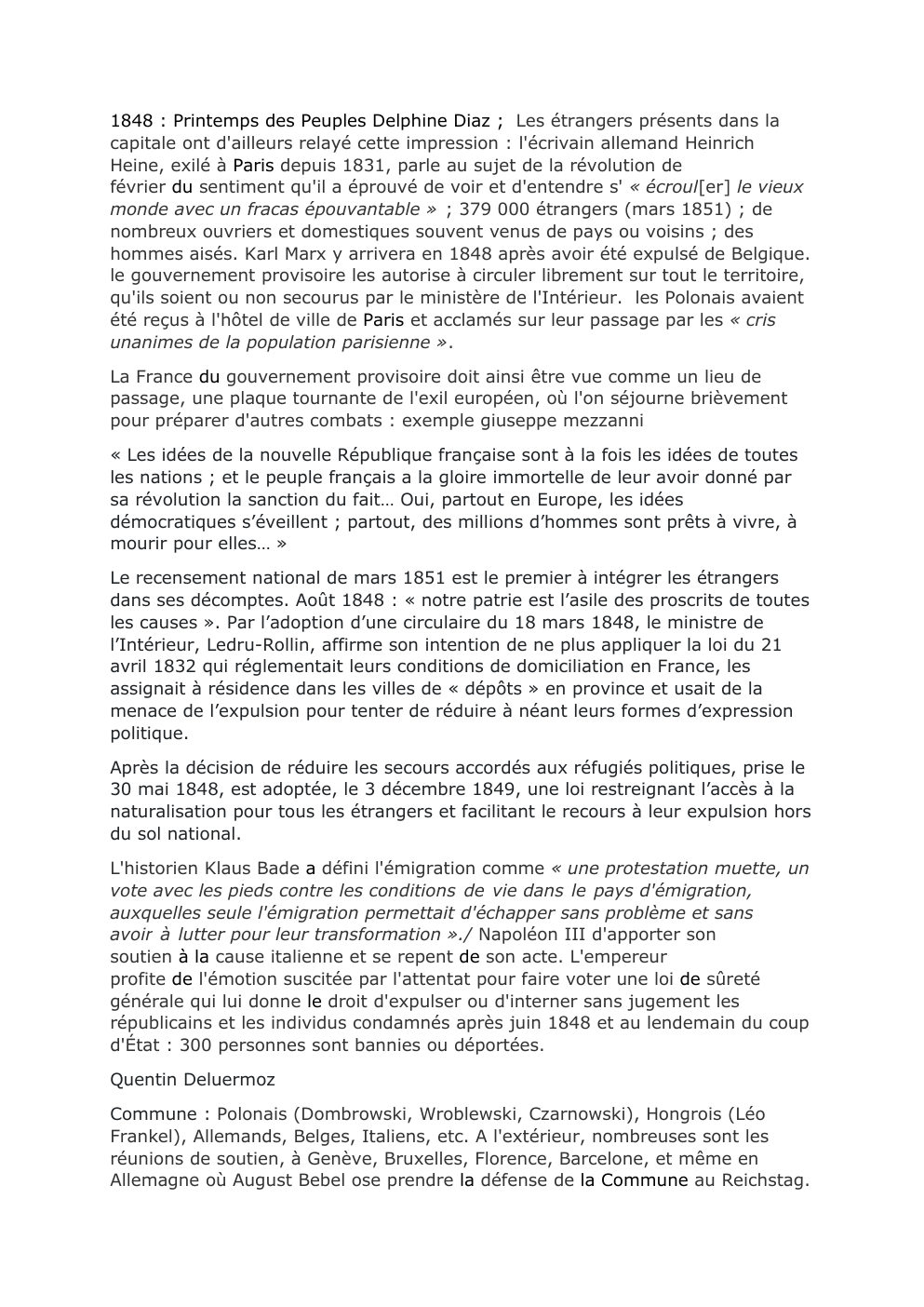Le rapport des étrangers avec la République entre 1848 et 1986
Publié le 09/03/2025
Extrait du document
«
1848 : Printemps des Peuples Delphine Diaz ; Les étrangers présents dans la
capitale ont d'ailleurs relayé cette impression : l'écrivain allemand Heinrich
Heine, exilé à Paris depuis 1831, parle au sujet de la révolution de
février du sentiment qu'il a éprouvé de voir et d'entendre s' « écroul[er] le vieux
monde avec un fracas épouvantable » ; 379 000 étrangers (mars 1851) ; de
nombreux ouvriers et domestiques souvent venus de pays ou voisins ; des
hommes aisés.
Karl Marx y arrivera en 1848 après avoir été expulsé de Belgique.
le gouvernement provisoire les autorise à circuler librement sur tout le territoire,
qu'ils soient ou non secourus par le ministère de l'Intérieur.
les Polonais avaient
été reçus à l'hôtel de ville de Paris et acclamés sur leur passage par les « cris
unanimes de la population parisienne ».
La France du gouvernement provisoire doit ainsi être vue comme un lieu de
passage, une plaque tournante de l'exil européen, où l'on séjourne brièvement
pour préparer d'autres combats : exemple giuseppe mezzanni
« Les idées de la nouvelle République française sont à la fois les idées de toutes
les nations ; et le peuple français a la gloire immortelle de leur avoir donné par
sa révolution la sanction du fait… Oui, partout en Europe, les idées
démocratiques s’éveillent ; partout, des millions d’hommes sont prêts à vivre, à
mourir pour elles… »
Le recensement national de mars 1851 est le premier à intégrer les étrangers
dans ses décomptes.
Août 1848 : « notre patrie est l’asile des proscrits de toutes
les causes ».
Par l’adoption d’une circulaire du 18 mars 1848, le ministre de
l’Intérieur, Ledru-Rollin, affirme son intention de ne plus appliquer la loi du 21
avril 1832 qui réglementait leurs conditions de domiciliation en France, les
assignait à résidence dans les villes de « dépôts » en province et usait de la
menace de l’expulsion pour tenter de réduire à néant leurs formes d’expression
politique.
Après la décision de réduire les secours accordés aux réfugiés politiques, prise le
30 mai 1848, est adoptée, le 3 décembre 1849, une loi restreignant l’accès à la
naturalisation pour tous les étrangers et facilitant le recours à leur expulsion hors
du sol national.
L'historien Klaus Bade a défini l'émigration comme « une protestation muette, un
vote avec les pieds contre les conditions de vie dans le pays d'émigration,
auxquelles seule l'émigration permettait d'échapper sans problème et sans
avoir à lutter pour leur transformation »./ Napoléon III d'apporter son
soutien à la cause italienne et se repent de son acte.
L'empereur
profite de l'émotion suscitée par l'attentat pour faire voter une loi de sûreté
générale qui lui donne le droit d'expulser ou d'interner sans jugement les
républicains et les individus condamnés après juin 1848 et au lendemain du coup
d'État : 300 personnes sont bannies ou déportées.
Quentin Deluermoz
Commune : Polonais (Dombrowski, Wroblewski, Czarnowski), Hongrois (Léo
Frankel), Allemands, Belges, Italiens, etc.
A l'extérieur, nombreuses sont les
réunions de soutien, à Genève, Bruxelles, Florence, Barcelone, et même en
Allemagne où August Bebel ose prendre la défense de la Commune au Reichstag.
« Événement médiatique mondial ».
cette violence qui s'est déployée de part et
d'autre, du côté des fusilleurs d'otages comme du côté de la répression : cette
violence est-elle proprement française ?
Bruno Cabanes
Première Guerre mondiale : Au mois d'août 1914, plusieurs centaines de milliers
de personnes, venues de Belgique et de France du Nord, déferlent vers le sud et
l'ouest de la France, apportant avec elles les rumeurs d'exactions commises par
l'ennemi.
« Tous ont la figure crispée, les yeux fous.
C'est la peur en marche »,
note une infirmière parisienne qui assiste à l'exode dans la petite ville de Péronne
(Somme) le 26 août 1914.
De fait, les « Boches du Nord » (c'est ainsi qu'ils sont
fréquemment désignés à partir de 1915) apparaissent comme l'exact
opposé des soldats partis se battre dans les tranchées : lâches parce que
supposés avoir favorisé l'invasion du territoire national par leur fuite1 dangereux
parce que pouvant compter des espions allemands1 profiteurs, parce qu'ils
bénéficient d'allocations depuis l'automne 1914 sans aucune obligation en
retour1 impurs, parce que certains d'entre eux - les « rapatriés » - ont vécu sous
occupation allemande et servi l'ennemi par leur travail avant d'être autorisés à
partir en France.
La France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne
imposent des restrictions à l'arrivée des étrangers ou à leur installation dans
certaines régions stratégiques dès l'été 1914.
La Première Guerre mondiale a
accéléré ce que Gérard Noiriel a appelé la « révolution de l'identification » (cf.
Pour en savoir plus, p.
67): avec l'essor des nations, l'individu est de plus en plus
soumis à un strict contrôle de son identité (au moyen de photographies) et de
ses déplacement.
Les expulsions atteignent un pic en France en 1934-1935, pour
diminuer de manière significative sous le gouvernement du Front populaire.
A la
fin avril 1939, ce sont plus de 450 000 réfugiés espagnols qui ont franchi la
frontière française.
La plupart sont installés dans des camps ouverts à la hâte
dans le sud de la France, notamment à Gurs, Rivesaltes, Noé, Argelès, SaintCyprien-Plage, Agde et Septfonds.
Certains rejoindront les Forces françaises
libres pendant la Seconde Guerre mondiale et participeront à la Libération de
Paris, d'autres seront déportés vers les camps de concentration.
Les soldats noirs de la République, Pap Ndiaye : C’est le livre de Charles Mangin,
en 1910, La Force noire , qui révolutionna cette vision des choses.
Ce lieutenantcolonel issu de la grande bourgeoisie de l’Est, obsédé par le danger allemand,
militait pour l’utilisation des tirailleurs en Europe, dans la perspective d’une
guerre de plus en plus probable contre l’Allemagne.
Son argument était que les
tirailleurs étaient des soldats valeureux, dotés de particularités physiques (une
plus grande résistance à la douleur, notamment), qui pouvaient utilement venir
renforcer des troupes françaises affaiblies par la dénatalité : « Dans les batailles
futures, ces primitifs pour lesquels la vie compte si peu et dont le jeune sang
bouillonne avec tant d’ardeur et comme avide de se répandre atteindront
certainement à l’ancienne "furie française" et la réveilleraient s’il en était besoin.
Diagne sillonna l’AOF et l’AEF (l’Afrique équatoriale française) pour convaincre
les Africains de s’engager, en promettant la citoyenneté française : « En versant
le même sang, vous gagnerez les mêmes droits.
»
Dans l’ensemble, en effet, il semble bien que la camaraderie l’emportait.
Des
amitiés se nouèrent, prolongées par des visites dans les familles lors des
permissions.
La maîtrise de la langue française était aussi un facteur important,
permettant ou non des rapprochements.
En dépit d’expériences parfois
humiliantes, les soldats africains connurent donc dans l’ensemble en métropole
une situation meilleure que dans les colonies : ils étaient plus respectés, et les
actes violents de racisme n’étaient pas tolérés comme ils l’étaient communément
outre-mer.
Ils firent généralement état de bonnes relations avec les femmes (pas
seulement les marraines de guerre), souvent les plus respectueuses à leur égard.
Cependant, les autorités françaises préféraient limiter les relations des soldats
noirs avec la population blanche.
C’est pourquoi leurs lieux d’entraînement
étaient situés à distance de la population civile et les permissions ne leur furent
accordées qu’en 1918, au moment où les autorités s’inquiétaient de leur moral.
Comme l’ont reconnu plusieurs responsables militaires et politiques français de
l’époque, dont Clemenceau, la mise en première ligne des troupes coloniales à la
fin de la guerre avait pour objectif d’ « épargner le sang français ».
A l’issue des combats, la grande majorité des prisonniers noirs fut regroupé par
les Allemands dans des Frontstalags situés en zone nord.
Contrairement aux
autres prisonniers on ne les transféra pas dans les Stalags allemands, par crainte
des maladies tropicales et de la « contamination » raciale.
Annette Wievorka
Resistance : Le groupe Manouchian et l’Affiche Rouge.
L'étranger, c'est le
Juif : « Et le crime est juif, et le crime est étranger.
Et le crime est au service du
judaïsme, de la haine juive, du sadisme juif comme la guerre est au service du
judaïsme, du capitalisme, du Juif bolchevique », explique la brochure.
La création
de la Main-d'oeuvre étrangère (MOE) en 1926, devenue MOI au début des
années 1930, est une réponse du jeune Parti communiste français (PCF), section
française de l'Internationale communiste, à l'arrivée massive sur le territoire de
travailleurs immigrés, principalement italiens et polonais.
L'objectif est
d'organiser des groupes classés par langue (italien, polonais, hongrois, espagnol,
roumain, arménien, etc.).
Ils sont mus par des impulsions tout à la fois
semblables - la lutte contre l'occupant nazi et ses collaborateurs - et distinctes.
Les jeunes Juifs appartiennent à la « génération de la rafle ».
Ayant entre 18 et
20 ans, ils sont désespérés, choqués au plus profond d'eux-mêmes par ce qu'ils
ont vu et subi.
Ils veulent se battre, lutter
Éluard : « dans leur sang le sang de leurs semblables »
« Si j'ai le droit de dire en français aujourd'hui/ Ma peine et mon espoir, ma colère et ma joie/ Si
rien....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- RAPPORT DE STAGE BTS AGRICULTURE
- rapport de stage BTS ASSISTANAT DE DIRECTION 2023-
- EC2 : Caractérisez la mobilité sociale des hommes par rapport à leur père.
- Exemple de rapport du stage
- Rapport entre Droit et politique