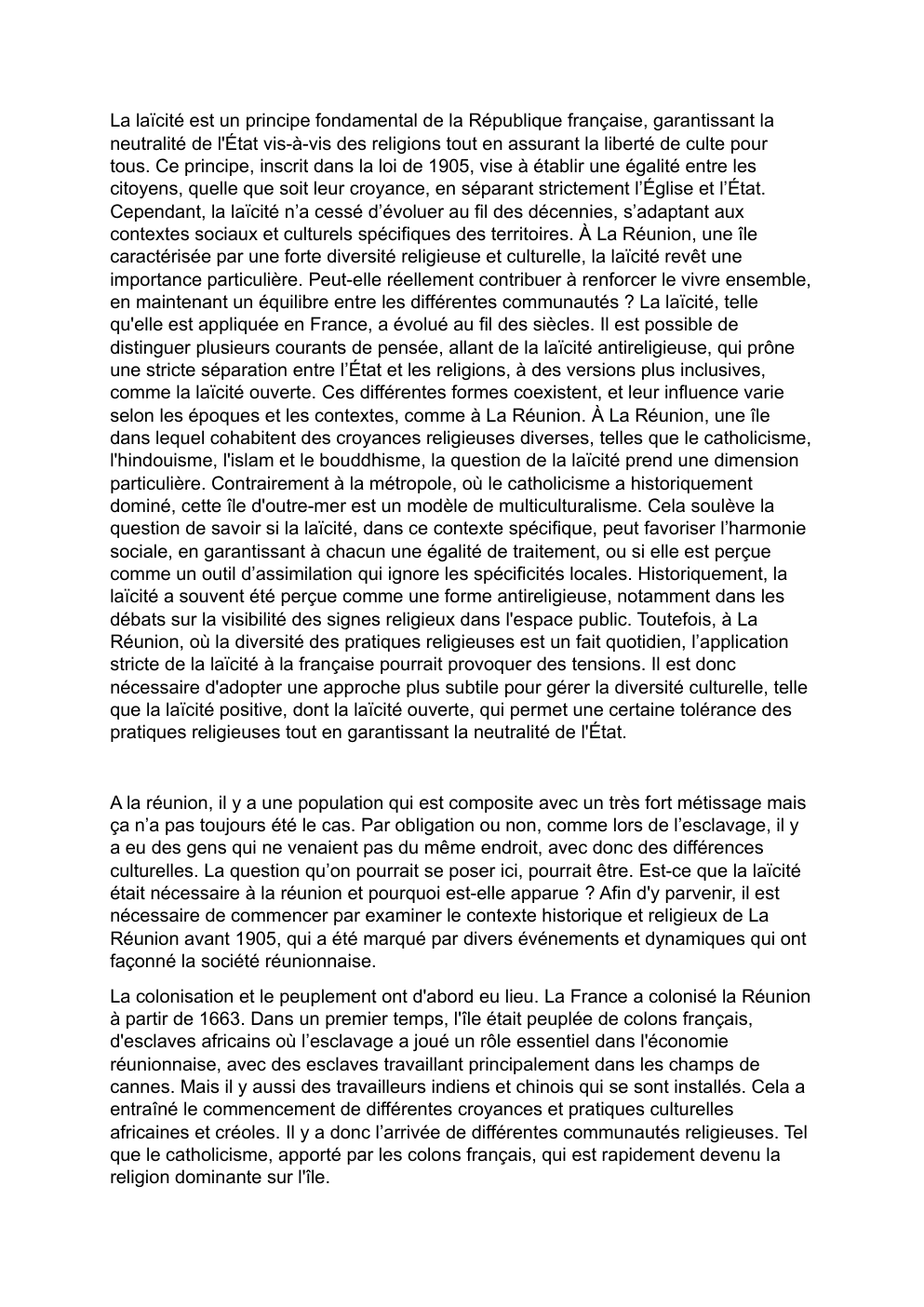Laicité à la réunion
Publié le 28/04/2025
Extrait du document
«
La laïcité est un principe fondamental de la République française, garantissant la
neutralité de l'État vis-à-vis des religions tout en assurant la liberté de culte pour
tous.
Ce principe, inscrit dans la loi de 1905, vise à établir une égalité entre les
citoyens, quelle que soit leur croyance, en séparant strictement l’Église et l’État.
Cependant, la laïcité n’a cessé d’évoluer au fil des décennies, s’adaptant aux
contextes sociaux et culturels spécifiques des territoires.
À La Réunion, une île
caractérisée par une forte diversité religieuse et culturelle, la laïcité revêt une
importance particulière.
Peut-elle réellement contribuer à renforcer le vivre ensemble,
en maintenant un équilibre entre les différentes communautés ? La laïcité, telle
qu'elle est appliquée en France, a évolué au fil des siècles.
Il est possible de
distinguer plusieurs courants de pensée, allant de la laïcité antireligieuse, qui prône
une stricte séparation entre l’État et les religions, à des versions plus inclusives,
comme la laïcité ouverte.
Ces différentes formes coexistent, et leur influence varie
selon les époques et les contextes, comme à La Réunion.
À La Réunion, une île
dans lequel cohabitent des croyances religieuses diverses, telles que le catholicisme,
l'hindouisme, l'islam et le bouddhisme, la question de la laïcité prend une dimension
particulière.
Contrairement à la métropole, où le catholicisme a historiquement
dominé, cette île d'outre-mer est un modèle de multiculturalisme.
Cela soulève la
question de savoir si la laïcité, dans ce contexte spécifique, peut favoriser l’harmonie
sociale, en garantissant à chacun une égalité de traitement, ou si elle est perçue
comme un outil d’assimilation qui ignore les spécificités locales.
Historiquement, la
laïcité a souvent été perçue comme une forme antireligieuse, notamment dans les
débats sur la visibilité des signes religieux dans l'espace public.
Toutefois, à La
Réunion, où la diversité des pratiques religieuses est un fait quotidien, l’application
stricte de la laïcité à la française pourrait provoquer des tensions.
Il est donc
nécessaire d'adopter une approche plus subtile pour gérer la diversité culturelle, telle
que la laïcité positive, dont la laïcité ouverte, qui permet une certaine tolérance des
pratiques religieuses tout en garantissant la neutralité de l'État.
A la réunion, il y a une population qui est composite avec un très fort métissage mais
ça n’a pas toujours été le cas.
Par obligation ou non, comme lors de l’esclavage, il y
a eu des gens qui ne venaient pas du même endroit, avec donc des différences
culturelles.
La question qu’on pourrait se poser ici, pourrait être.
Est-ce que la laïcité
était nécessaire à la réunion et pourquoi est-elle apparue ? Afin d'y parvenir, il est
nécessaire de commencer par examiner le contexte historique et religieux de La
Réunion avant 1905, qui a été marqué par divers événements et dynamiques qui ont
façonné la société réunionnaise.
La colonisation et le peuplement ont d'abord eu lieu.
La France a colonisé la Réunion
à partir de 1663.
Dans un premier temps, l'île était peuplée de colons français,
d'esclaves africains où l’esclavage a joué un rôle essentiel dans l'économie
réunionnaise, avec des esclaves travaillant principalement dans les champs de
cannes.
Mais il y aussi des travailleurs indiens et chinois qui se sont installés.
Cela a
entraîné le commencement de différentes croyances et pratiques culturelles
africaines et créoles.
Il y a donc l’arrivée de différentes communautés religieuses.
Tel
que le catholicisme, apporté par les colons français, qui est rapidement devenu la
religion dominante sur l'île.
Au XIXe siècle, l'hindouisme et l'islam ont commencé à s'implanter à La Réunion
grâce à l'arrivée de travailleurs indiens principalement des Tamouls et musulmans
principalement des Comoriens.
Ces communautés ont apporté leurs croyances,
pratiques et festivals.
Et pour finir le Protestantisme.
Bien qu’elle soit moins
fréquente, on a également observé la présence de communautés protestantes,
notamment parmi certains colons et des descendants d'esclaves.
Cela a entrainé
une diversité culturelle.
Il y a eu a eu des mélanges de tradition, la Réunion est donc
devenue un lieu de rencontre et de mélange de diverses cultures et traditions
religieuses.
Les pratiques religieuses souvent influencées par les croyances
africaines, indiennes et chrétiennes, donnant lieu à une affinité religieuse.
Les
différentes communautés célébraient leurs fêtes religieuses de manière distincte,
mais il y avait également des moments de convergence où ces célébrations étaient
partagées, montrant donc la coexistence pacifique des religions.
Toutefois, il y a eu
des conséquences sociales et politiques.
Les différences religieuses et culturelles ont
amené à des inégalités sociales, notamment entre les colons et les travailleurs, ainsi
qu'entre les diverses communautés religieuses.
Les dynamiques religieuses ont
également été affecté par des événements tels que la révolte des esclaves en 1811.
Nous pouvons aussi noter qu’il y avait des conséquences de la métropole.
Les
colonies ont commencé à être influencées par les débats sur la laïcité en métropole,
même avant la loi de 1905.
Les idées de séparation entre Église et État
commençaient à se développer mais la situation sur le terrain à La Réunion était bien
plus complexe en raison de la diversité religieuse.
Le vivre ensemble était par
conséquent présent, il y avait du respect entre les différentes croyances bien qu’il
n’existait pas de cadre officiel qui garantissait une séparation entre l'État et les
religions.
Alors dans ce cas, pourquoi instauré la laïcité ?
Et bien la mise en place de la laïcité en France en 1905 visait principalement à
mettre fin à l'influence dominante de l'Église catholique dans les affaires de l'État,
notamment dans les écoles et les institutions publiques.
Elle visait une évolution de
la société française avec pour objectif de garantir une égalité de traitement entre tous
les citoyens, peu importe leurs convictions ou leurs croyances, et ainsi de préserver
la liberté de conscience.
Dans le contexte réunionnais, il n'y avait pas
nécessairement un besoin urgent de la laïcité pour réguler les rapports entre l'État et
les religions, puisque les relations religieuses semblaient plus stables que celle en
métropole.
Et qu’il n’y avait pas forcément une aussi grande influence de la religion
catholique qu’en hexagone.
La Réunion, aurait probablement continué à fonctionner avec une certaine tolérance
et respect entre les communautés, même sans l'application stricte de la laïcité.
Cependant cela signifiait qu'il y avait un risque potentiel de favoritisme ou de conflits
si une religion avait tenté de dominer les autres ou si une religion avait tenté de
renforcer son influence au détriment des autres créant ainsi des tensions entre les
différentes religions présente sur l’ile.
Cependant il ne faut pas oublié que la Réunion est aussi un département et une
région d'outre-mer française, elle est donc aussi concernée par les décisions prisent
en France.
La laïcité a été appliquée en France mais aussi dans les territoires
d'outre-mer, y compris La Réunion.
Par conséquent on a été un peu forcé de mettre
en place la laïcité sur notre île.
On aurait pu aussi se poser la question est-ce que les
lois mise en place à cause de la laïcité veulent éradiquer les religions.
Emmanuel
Valls l’ancien Premier ministre de France a dit : « La laïcité, ce n’est pas la négation
des religions, c’est la liberté de croire ou de ne pas croire, dans le respect de
chacun.
».
Emmanuel Valls a beaucoup parlé de la laïcité en tant que pilier
républicain.
Cela montre comment le principe de laïcité à La Réunion ne vise pas à
éradiquer les croyances mais à garantir un espace neutre pour toutes les religions.
Et que la laïcité a avant tout un but d’égalité comme le dit Gaston Monnerville
l’ancien président du Sénat et homme politique, : « La République ne connaît que
des citoyens, pas des communautés.
».
Ici il nous montre bien que la laïcité prône
une égalité de traitement pour tous les citoyens, indépendamment de leurs
croyances, une vision qui peut s’appliquer au contexte réunionnais, tout en tenant
compte de ses spécificités multiculturelles.
Malgré la mise en œuvre de la laïcité par le gouvernement français, elle a eu des
répercussions positives sur la Réunion en 1905.
La laïcité dans un premier temps a permis à ce que l’état soit officiellement neutre et
donc d'inscrire officiellement l'égalité des citoyens devant l'État, quelle que soit leur
religion, et d'éviter des conflits potentiels liés à la domination d'une religion sur les
autres ou encore les tensions, en offrant un cadre où chaque croyance est
respectée.
Par conséquent elle a permis de renforcer le vivre-ensemble, en donnant
un cadre juridique mais aussi de réduire l’influence religieuses sur les affaires
publiques, garantissant que les décisions politiques et administratives soient prises
de manière indépendante des pressions religieuses.
Elle a aussi permis de protéger le droit des individus à croire ou à ne pas croire, ce
qui est essentiel dans une société où cohabitent différentes religions.
Ainsi, cela a
favorisée une liberté de conscience plus grande pour ceux qui ne voulaient pas être
contraints par des normes religieuses dominantes, notamment en ce qui concerne
des aspects comme le mariage civil ou les cérémonies officielles.
Elle a également permis une éducation laïque.
L'éducation à La Réunion a pu se
débarrasser de l'influence religieuse, garantissant un enseignement....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓