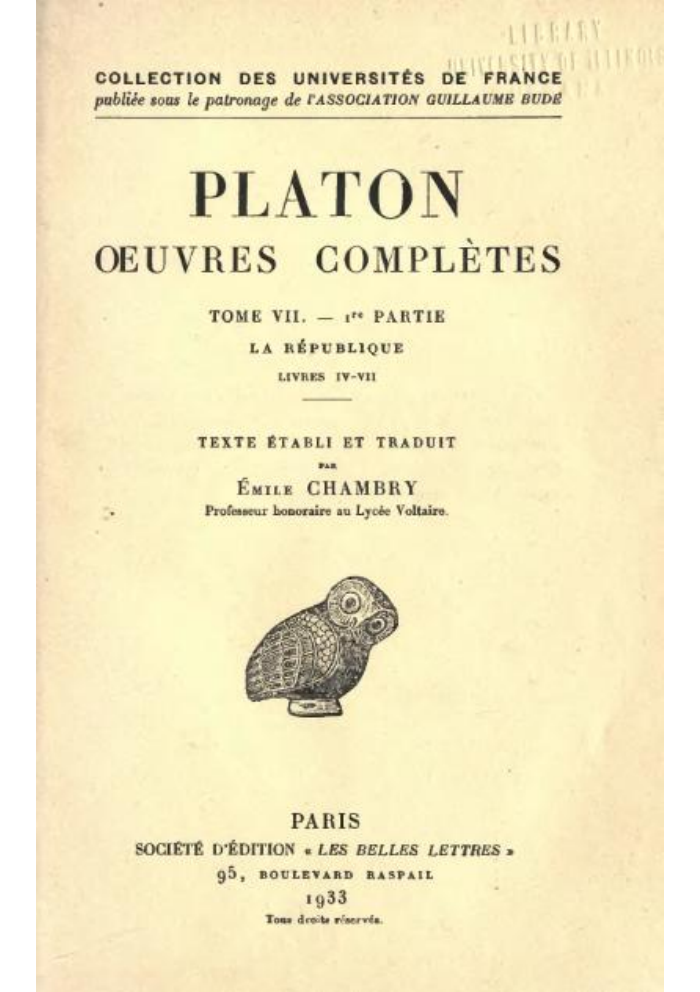la république de platon
Publié le 04/01/2025
Extrait du document
«
La République, livres IV-VII
Platon
Les Belles Lettres, Paris, 1933
Exporté de Wikisource le 14 octobre 2024
1
LIVRE IV
I Ici Adimante, prenant la parole à son
tour : « Que répondras-tu, Socrate, dit-il,
Objection :
si l’on t’objecte que tu ne rends pas tes
ces gardiens
guerriers fort heureux, et cela par leur
ne seront pas
faute, puisqu’ils sont en réalité les
heureux.
Réponse.
maîtres de l’État et qu’ils ne jouissent
d’aucun avantage de la société, comme
les gouverneurs des autres États qui ont des terres, se bâtissent de belles
et spacieuses maisons qu’ils meublent à l’avenant, offrent aux dieux
des sacrifices en leur nom, exercent l’hospitalité et possèdent ces biens
dont tu parlais tout à l’heure, l’or et l’argent, et en général tous les
biens en usage chez les favoris de la fortune [1].
Vraiment, dira-t-on, ils
sont dans la cité comme des auxiliaires salariés, n’ayant rien à faire que
de monter la garde.
Oui, dis-je, et de plus ils ne gagnent que leur nourriture, sans y
ajouter aucune solde, comme les autres mercenaires, en sorte qu’ils ne
pourront même pas faire un voyage à l’étranger pour leur agrément
personnel, ni payer des courtisanes, ni dépenser à leur fantaisie pour
d’autres plaisirs, comme le font les gens qui passent pour des heureux.
Voilà, sans compter bien d’autres, des points que tu as laissés de côté
dans ton accusation.
Eh bien ! ajoute-les-y.
Et maintenant tu veux savoir ce que j’ai à répliquer ?
Oui.
Nous n’avons, dis-je, qu’à suivre notre route, et nous trouverons ce
qu’il faut répondre.
Nous dirons en effet qu’il n’y aurait rien d’étonnant
2
à ce que cette condition même de nos guerriers fût très heureuse, mais
qu’au reste notre but, en fondant un État, n’est pas de rendre une classe
unique de citoyens particulièrement heureuse, mais d’assurer le plus
grand bonheur possible à l’État tout entier, parce que nous avons cru
que c’est dans un État de ce genre que la justice se découvrirait le
mieux, de même que l’injustice dans l’État le plus vicieux, et que cette
découverte nous mettrait à même de trancher la question qui nous
occupe depuis longtemps.
Or à présent, c’est l’État heureux, du moins
nous le croyons, que nous voulons former, sans faire acception de
personne ; car nous voulons le bonheur, non de quelques-uns, mais de
tous ; aussitôt après nous examinerons l’État contraire.
Si nous étions
occupés à peindre une statue et que quelqu’un s’approchât et nous
blâmât de ne pas appliquer les plus belles couleurs aux plus belles
parties du corps, et cela parce que nous aurions peint les yeux, qui en
sont le plus bel ornement, non en vermillon, mais en noir, nous serions,
je crois, dans le vrai en lui répondant : « Ô surprenant critique, ne
t’imagine pas que nous devions peindre des yeux si beaux qu’ils ne
soient plus des yeux, non plus d’ailleurs que toute autre partie ;
considère plutôt si, donnant à chaque partie la couleur qui lui convient,
nous rendons l’ensemble parfait.
C’est la même chose ici ; ne nous fais
donc pas attacher à la condition des gardiens une félicité qui fera d’eux
tout autre chose que des gardiens.
Nous pourrions tout aussi bien
revêtir les laboureurs de robes traînantes, les couvrir d’or et leur
permettre de ne travailler la terre que pour leur plaisir ; coucher aussi
nos potiers sur des lits, les faire boire à la ronde et banqueter devant
leur feu, leur roue à côté d’eux, avec la liberté de travailler quand il leur
plairait.
Nous pourrions donner à tous les autres un bonheur du même
genre, afin que la cité tout entière soit heureuse.
Mais garde-toi de nous
y engager ; car, si nous t’écoutions, le laboureur ne serait plus
laboureur, ni le potier, potier, et personne ne restant dans sa condition,
il n’y aurait plus d’État.
Au reste ce désordre aurait des conséquences
moins graves chez les artisans que chez les guerriers ; car que des
cordonniers deviennent mauvais, qu’ils se gâtent et se donnent pour
cordonniers, alors qu’ils ne le sont pas, il n’y a là rien de grave pour
3
l’État ; mais que les gardiens des lois et de l’État ne le soient que de
nom, tu vois bien qu’ils entraînent l’État tout entier à une ruine
irrémédiable, et que d’autre part c’est d’eux seuls que dépendent et sa
bonne organisation et son bonheur.
» Nous formons, nous, des gardiens
véritables, absolument incapables de faire du mal à l’État ; si au
contraire notre contradicteur fait d’eux des sortes de laboureurs et
d’heureux convives en fête, au lieu de citoyens en fonction, c’est qu’il a
en vue autre chose qu’un État.
Ainsi voyons si, en instituant les
gardiens, nous voulons leur donner la plus grande part possible de
bonheur, ou s’il faut, ayant égard à la cité tout entière, viser au bonheur
général et engager soit par la force, soit par la persuasion, nos
auxiliaires et nos gardiens, ainsi que tous les autres citoyens, à remplir
le mieux possible les fonctions qui leur sont propres, et quand l’État
tout entier fleurira sous une sage administration, laisser chaque classe
prendre la part de bonheur que la nature lui assigne.
II
Voilà, dit-il, ce que j’appelle bien parler.
Et maintenant, repris-je, voici une autre
remarque apparentée à la précédente.
Il faut empêcher
Voyons si tu la trouveras juste.
le développement
de la richesse
et de la pauvreté.
De quoi s’agit-il ?
D’examiner si les deux choses que
voici ne gâtent pas les artisans au point
de les rendre mauvais.
Quelles sont-elles ?
La richesse, répondis-je, et la pauvreté [2].
Comment ?
Voici : si un potier devient riche, crois-tu qu’il voudra encore
s’appliquer à son métier ?
Non, dit-il.
4
Ne deviendra-t-il pas de jour en jour plus paresseux et plus
négligent [3] ?
Beaucoup plus.
Et par conséquent plus mauvais potier ?
Oui aussi, beaucoup plus, dit-il.
D’autre part si la pauvreté lui ôte le moyen de se procurer des outils
ou tout autre objet nécessaire à son métier, il fabriquera des articles de
moindre qualité, et, s’il montre à travailler à ses fils ou à d’autres, il
n’en fera que des ouvriers inférieurs.
Il n’en peut être autrement.
Ainsi la pauvreté et la richesse rabaissent également la valeur des
ouvrages et celle des artisans eux-mêmes.
Il y a apparence.
Nous avons trouvé, semble-t-il, une nouvelle tâche pour nos
gardiens, c’est d’empêcher par tous les moyens que ces deux maux ne
se glissent à leur insu dans la cité.
Quels maux ?
La richesse, répondis-je, et la pauvreté ; car l’une engendre la
mollesse, l’oisiveté et le goût des nouveautés, et l’autre, avec ce même
goût des nouveautés, la bassesse et l’envie de mal faire.
C’est très juste, dit-il.
Cependant il y a un
point qui mérite réflexion, Socrate :
La guerre.
comment notre État, s’il n’a pas amassé
d’argent, pourra-t-il faire la guerre, surtout s’il est forcé de la soutenir
contre un État puissant et riche ?
Il est vrai, répondis-je, qu’il aura de la peine à tenir tête à un seul
État ; mais à deux États comme ceux dont tu parles, il en aura moins.
Que dis-tu là ? s’écria-t-il.
5
Tout d’abord, dis-je, s’il faut en venir aux mains, n’est-ce pas des
hommes riches que nos gens, athlètes voués à la guerre, auront à
combattre ?
J’en conviens, dit-il.
Mais quoi ! Adimante, repris-je ; un seul boxeur parfaitement
entraîné à la lutte n’est-il pas pour toi de taille à tenir tête à deux
adversaires ignorants de la boxe, et de plus riches et chargés de
graisse ?
Non sans doute, répondit-il, du moins à tous les deux à la fois.
Pas même, repris-je, s’il pouvait se dérober par la fuite pour se
retourner ensuite et frapper chaque fois celui qui le suivrait de plus
près, et s’il renouvelait cette manœuvre plusieurs fois sous la chaleur
suffocante du soleil ? Un tel homme ne pourrait-il pas dompter même
plus de deux adversaires comme ceux-là ?
Assurément, dit-il, ce ne serait pas merveille.
Et crois-tu que les riches ne soient pas plus habiles et plus exercés à
la lutte qu’à la guerre ?
Je n’en doute pas, dit-il.
Il est donc vraisemblable que nos athlètes tiendront facilement tête à
des adversaires deux ou trois fois plus nombreux qu’eux.
Je te l’accorde, dit-il ; car il me semble que tu as raison.
Et si, envoyant une ambassade dans un des deux États, ils disaient,
ce qui d’ailleurs serait la vérité : « Nous ne faisons aucun usage de l’or
ni de l’argent : cela nous est défendu ; à vous, non ; mettez-vous donc
de notre côté, et les biens de l’adversaire sont à vous, » crois-tu que
ceux qui s’entendraient faire de telles offres choisiraient de faire la
guerre à des chiens durs et maigres plutôt que de se joindre aux chiens
contre des moutons gras et tendres ?
Je ne le crois pas ;....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Commentaire de texte Platon de la République (livre III)
- « Ce que je sais, c’est que je ne sais rien » PLATON
- « Apprendre, c’est se ressouvenir de ce que l’on a oublié » PLATON
- « L’opinion est quelque chose d’intermédiaire entre la connaissance et l’ignorance... » PLATON
- La victoire sur soi-même est la première et la plus glorieuse de toutes les victoires (Platon)