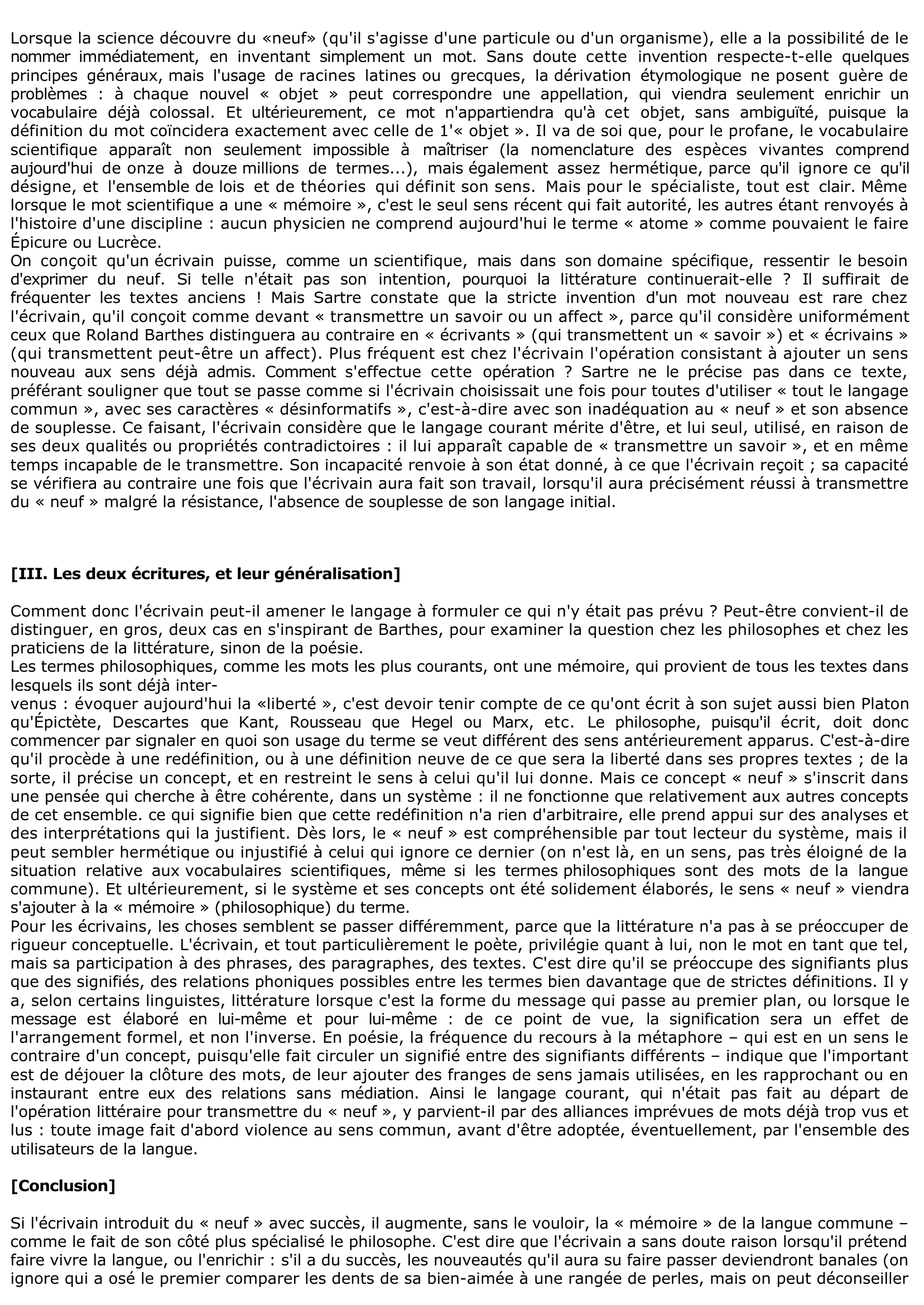Jean-Paul SARTRE et le langage
Publié le 03/04/2005
Extrait du document

- Sartre se livre ici à une comparaison entre trois types de langages : le langage commun, le langage scientifique (abordé brièvement) et le langage de l'écrivain, mais c'est pour caractériser en quoi consiste la pratique littéraire. L'examen des deux premiers cas doit être mis au service du troisième.

«
Lorsque la science découvre du «neuf» (qu'il s'agisse d'une particule ou d'un organisme), elle a la possibilité de lenommer immédiatement, en inventant simplement un mot.
Sans doute cette invention respecte-t-elle quelquesprincipes généraux, mais l'usage de racines latines ou grecques, la dérivation étymologique ne posent guère deproblèmes : à chaque nouvel « objet » peut correspondre une appellation, qui viendra seulement enrichir unvocabulaire déjà colossal.
Et ultérieurement, ce mot n'appartiendra qu'à cet objet, sans ambiguïté, puisque ladéfinition du mot coïncidera exactement avec celle de 1'« objet ».
Il va de soi que, pour le profane, le vocabulairescientifique apparaît non seulement impossible à maîtriser (la nomenclature des espèces vivantes comprendaujourd'hui de onze à douze millions de termes...), mais également assez hermétique, parce qu'il ignore ce qu'ildésigne, et l'ensemble de lois et de théories qui définit son sens.
Mais pour le spécialiste, tout est clair.
Mêmelorsque le mot scientifique a une « mémoire », c'est le seul sens récent qui fait autorité, les autres étant renvoyés àl'histoire d'une discipline : aucun physicien ne comprend aujourd'hui le terme « atome » comme pouvaient le faireÉpicure ou Lucrèce.On conçoit qu'un écrivain puisse, comme un scientifique, mais dans son domaine spécifique, ressentir le besoind'exprimer du neuf.
Si telle n'était pas son intention, pourquoi la littérature continuerait-elle ? Il suffirait defréquenter les textes anciens ! Mais Sartre constate que la stricte invention d'un mot nouveau est rare chezl'écrivain, qu'il conçoit comme devant « transmettre un savoir ou un affect », parce qu'il considère uniformémentceux que Roland Barthes distinguera au contraire en « écrivants » (qui transmettent un « savoir ») et « écrivains »(qui transmettent peut-être un affect).
Plus fréquent est chez l'écrivain l'opération consistant à ajouter un sensnouveau aux sens déjà admis.
Comment s'effectue cette opération ? Sartre ne le précise pas dans ce texte,préférant souligner que tout se passe comme si l'écrivain choisissait une fois pour toutes d'utiliser « tout le langagecommun », avec ses caractères « désinformatifs », c'est-à-dire avec son inadéquation au « neuf » et son absencede souplesse.
Ce faisant, l'écrivain considère que le langage courant mérite d'être, et lui seul, utilisé, en raison deses deux qualités ou propriétés contradictoires : il lui apparaît capable de « transmettre un savoir », et en mêmetemps incapable de le transmettre.
Son incapacité renvoie à son état donné, à ce que l'écrivain reçoit ; sa capacitése vérifiera au contraire une fois que l'écrivain aura fait son travail, lorsqu'il aura précisément réussi à transmettredu « neuf » malgré la résistance, l'absence de souplesse de son langage initial.
[III.
Les deux écritures, et leur généralisation]
Comment donc l'écrivain peut-il amener le langage à formuler ce qui n'y était pas prévu ? Peut-être convient-il dedistinguer, en gros, deux cas en s'inspirant de Barthes, pour examiner la question chez les philosophes et chez lespraticiens de la littérature, sinon de la poésie.Les termes philosophiques, comme les mots les plus courants, ont une mémoire, qui provient de tous les textes danslesquels ils sont déjà inter-venus : évoquer aujourd'hui la «liberté », c'est devoir tenir compte de ce qu'ont écrit à son sujet aussi bien Platonqu'Épictète, Descartes que Kant, Rousseau que Hegel ou Marx, etc.
Le philosophe, puisqu'il écrit, doit donccommencer par signaler en quoi son usage du terme se veut différent des sens antérieurement apparus.
C'est-à-direqu'il procède à une redéfinition, ou à une définition neuve de ce que sera la liberté dans ses propres textes ; de lasorte, il précise un concept, et en restreint le sens à celui qu'il lui donne.
Mais ce concept « neuf » s'inscrit dansune pensée qui cherche à être cohérente, dans un système : il ne fonctionne que relativement aux autres conceptsde cet ensemble.
ce qui signifie bien que cette redéfinition n'a rien d'arbitraire, elle prend appui sur des analyses etdes interprétations qui la justifient.
Dès lors, le « neuf » est compréhensible par tout lecteur du système, mais ilpeut sembler hermétique ou injustifié à celui qui ignore ce dernier (on n'est là, en un sens, pas très éloigné de lasituation relative aux vocabulaires scientifiques, même si les termes philosophiques sont des mots de la languecommune).
Et ultérieurement, si le système et ses concepts ont été solidement élaborés, le sens « neuf » viendras'ajouter à la « mémoire » (philosophique) du terme.Pour les écrivains, les choses semblent se passer différemment, parce que la littérature n'a pas à se préoccuper derigueur conceptuelle.
L'écrivain, et tout particulièrement le poète, privilégie quant à lui, non le mot en tant que tel,mais sa participation à des phrases, des paragraphes, des textes.
C'est dire qu'il se préoccupe des signifiants plusque des signifiés, des relations phoniques possibles entre les termes bien davantage que de strictes définitions.
Il ya, selon certains linguistes, littérature lorsque c'est la forme du message qui passe au premier plan, ou lorsque lemessage est élaboré en lui-même et pour lui-même : de ce point de vue, la signification sera un effet del'arrangement formel, et non l'inverse.
En poésie, la fréquence du recours à la métaphore – qui est en un sens lecontraire d'un concept, puisqu'elle fait circuler un signifié entre des signifiants différents – indique que l'importantest de déjouer la clôture des mots, de leur ajouter des franges de sens jamais utilisées, en les rapprochant ou eninstaurant entre eux des relations sans médiation.
Ainsi le langage courant, qui n'était pas fait au départ del'opération littéraire pour transmettre du « neuf », y parvient-il par des alliances imprévues de mots déjà trop vus etlus : toute image fait d'abord violence au sens commun, avant d'être adoptée, éventuellement, par l'ensemble desutilisateurs de la langue.
[Conclusion]
Si l'écrivain introduit du « neuf » avec succès, il augmente, sans le vouloir, la « mémoire » de la langue commune –comme le fait de son côté plus spécialisé le philosophe.
C'est dire que l'écrivain a sans doute raison lorsqu'il prétendfaire vivre la langue, ou l'enrichir : s'il a du succès, les nouveautés qu'il aura su faire passer deviendront banales (onignore qui a osé le premier comparer les dents de sa bien-aimée à une rangée de perles, mais on peut déconseiller.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Jean-Paul SARTRE: Poésie et langage
- Dans Qu’est-ce que la littérature , Jean-Paul SARTRE écrit que la poésie ne se sert pas des mots de la même manière que la prose : « Et même, elle ne s’en sert pas du tout ; je dirais plutôt qu’elle les sert… Le poète s’est retiré d’un seul coup du langage instrument ; il a choisi une fois pour toutes l’attitude poétique qui considère les mots comme des choses et non comme des signes. » Vous commenterez ce jugement de SARTRE et analyserez, en vous appuyant sur des exemples précis, ce
- Le désir s'exprime par la caresse comme la pensée par le langage. Sartre, Jean-Paul. Commentez cette citation.
- « Tout existant naît sans raison, se prolonge par faiblesse et meurt par rencontre » JEAN-PAUL SARTRE
- explication de texte :Jean Paul Sartre L'être et le néant: Lpassé que j'ai à être