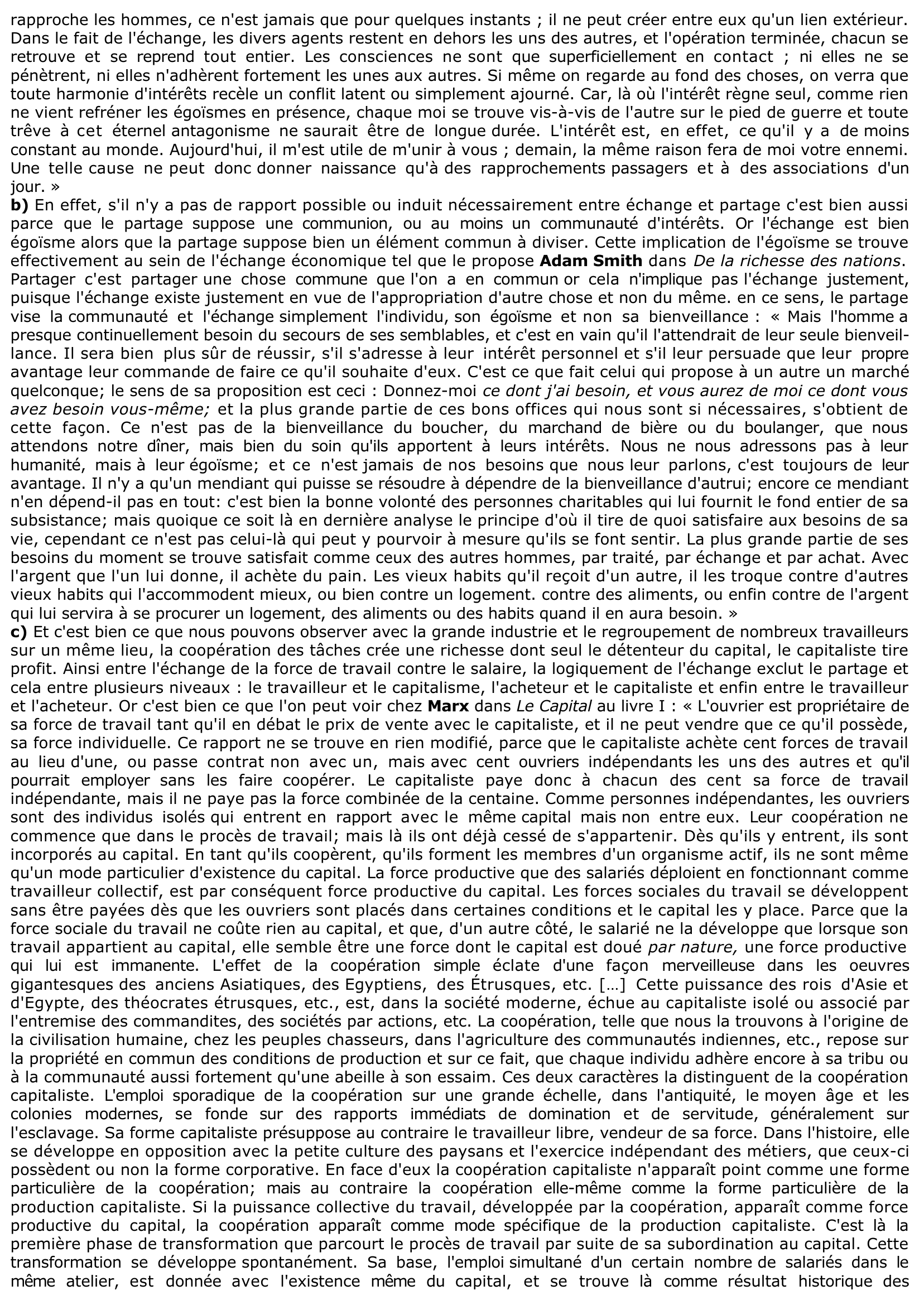Echanger, est-ce partager ?
Publié le 27/02/2008
Extrait du document
«
rapproche les hommes, ce n'est jamais que pour quelques instants ; il ne peut créer entre eux qu'un lien extérieur.Dans le fait de l'échange, les divers agents restent en dehors les uns des autres, et l'opération terminée, chacun seretrouve et se reprend tout entier.
Les consciences ne sont que superficiellement en contact ; ni elles ne sepénètrent, ni elles n'adhèrent fortement les unes aux autres.
Si même on regarde au fond des choses, on verra quetoute harmonie d'intérêts recèle un conflit latent ou simplement ajourné.
Car, là où l'intérêt règne seul, comme rienne vient refréner les égoïsmes en présence, chaque moi se trouve vis-à-vis de l'autre sur le pied de guerre et toutetrêve à cet éternel antagonisme ne saurait être de longue durée.
L'intérêt est, en effet, ce qu'il y a de moinsconstant au monde.
Aujourd'hui, il m'est utile de m'unir à vous ; demain, la même raison fera de moi votre ennemi.Une telle cause ne peut donc donner naissance qu'à des rapprochements passagers et à des associations d'unjour.
»b) En effet, s'il n'y a pas de rapport possible ou induit nécessairement entre échange et partage c'est bien aussiparce que le partage suppose une communion, ou au moins un communauté d'intérêts.
Or l'échange est bienégoïsme alors que la partage suppose bien un élément commun à diviser.
Cette implication de l'égoïsme se trouveeffectivement au sein de l'échange économique tel que le propose Adam Smith dans De la richesse des nations . Partager c'est partager une chose commune que l'on a en commun or cela n'implique pas l'échange justement,puisque l'échange existe justement en vue de l'appropriation d'autre chose et non du même.
en ce sens, le partagevise la communauté et l'échange simplement l'individu, son égoïsme et non sa bienveillance : « Mais l'homme a presque continuellement besoin du secours de ses semblables, et c'est en vain qu'il l'attendrait de leur seule bienveil-lance.
Il sera bien plus sûr de réussir, s'il s'adresse à leur intérêt personnel et s'il leur persuade que leur propreavantage leur commande de faire ce qu'il souhaite d'eux.
C'est ce que fait celui qui propose à un autre un marchéquelconque; le sens de sa proposition est ceci : Donnez-moi ce dont j'ai besoin, et vous aurez de moi ce dont vous avez besoin vous-même; et la plus grande partie de ces bons offices qui nous sont si nécessaires, s'obtient de cette façon.
Ce n'est pas de la bienveillance du boucher, du marchand de bière ou du boulanger, que nousattendons notre dîner, mais bien du soin qu'ils apportent à leurs intérêts.
Nous ne nous adressons pas à leurhumanité, mais à leur égoïsme; et ce n'est jamais de nos besoins que nous leur parlons, c'est toujours de leuravantage.
Il n'y a qu'un mendiant qui puisse se résoudre à dépendre de la bienveillance d'autrui; encore ce mendiantn'en dépend-il pas en tout: c'est bien la bonne volonté des personnes charitables qui lui fournit le fond entier de sasubsistance; mais quoique ce soit là en dernière analyse le principe d'où il tire de quoi satisfaire aux besoins de savie, cependant ce n'est pas celui-là qui peut y pourvoir à mesure qu'ils se font sentir.
La plus grande partie de sesbesoins du moment se trouve satisfait comme ceux des autres hommes, par traité, par échange et par achat.
Avecl'argent que l'un lui donne, il achète du pain.
Les vieux habits qu'il reçoit d'un autre, il les troque contre d'autresvieux habits qui l'accommodent mieux, ou bien contre un logement.
contre des aliments, ou enfin contre de l'argentqui lui servira à se procurer un logement, des aliments ou des habits quand il en aura besoin.
»c) Et c'est bien ce que nous pouvons observer avec la grande industrie et le regroupement de nombreux travailleurssur un même lieu, la coopération des tâches crée une richesse dont seul le détenteur du capital, le capitaliste tireprofit.
Ainsi entre l'échange de la force de travail contre le salaire, la logiquement de l'échange exclut le partage etcela entre plusieurs niveaux : le travailleur et le capitalisme, l'acheteur et le capitaliste et enfin entre le travailleuret l'acheteur.
Or c'est bien ce que l'on peut voir chez Marx dans Le Capital au livre I : « L'ouvrier est propriétaire de sa force de travail tant qu'il en débat le prix de vente avec le capitaliste, et il ne peut vendre que ce qu'il possède,sa force individuelle.
Ce rapport ne se trouve en rien modifié, parce que le capitaliste achète cent forces de travailau lieu d'une, ou passe contrat non avec un, mais avec cent ouvriers indépendants les uns des autres et qu'il pourrait employer sans les faire coopérer.
Le capitaliste paye donc à chacun des cent sa force de travailindépendante, mais il ne paye pas la force combinée de la centaine.
Comme personnes indépendantes, les ouvrierssont des individus isolés qui entrent en rapport avec le même capital mais non entre eux.
Leur coopération necommence que dans le procès de travail; mais là ils ont déjà cessé de s'appartenir.
Dès qu'ils y entrent, ils sontincorporés au capital.
En tant qu'ils coopèrent, qu'ils forment les membres d'un organisme actif, ils ne sont mêmequ'un mode particulier d'existence du capital.
La force productive que des salariés déploient en fonctionnant commetravailleur collectif, est par conséquent force productive du capital.
Les forces sociales du travail se développentsans être payées dès que les ouvriers sont placés dans certaines conditions et le capital les y place.
Parce que laforce sociale du travail ne coûte rien au capital, et que, d'un autre côté, le salarié ne la développe que lorsque sontravail appartient au capital, elle semble être une force dont le capital est doué par nature, une force productive qui lui est immanente.
L'effet de la coopération simple éclate d'une façon merveilleuse dans les oeuvresgigantesques des anciens Asiatiques, des Egyptiens, des Étrusques, etc.
[…] Cette puissance des rois d'Asie etd'Egypte, des théocrates étrusques, etc., est, dans la société moderne, échue au capitaliste isolé ou associé parl'entremise des commandites, des sociétés par actions, etc.
La coopération, telle que nous la trouvons à l'origine dela civilisation humaine, chez les peuples chasseurs, dans l'agriculture des communautés indiennes, etc., repose surla propriété en commun des conditions de production et sur ce fait, que chaque individu adhère encore à sa tribu ouà la communauté aussi fortement qu'une abeille à son essaim.
Ces deux caractères la distinguent de la coopérationcapitaliste.
L'emploi sporadique de la coopération sur une grande échelle, dans l'antiquité, le moyen âge et lescolonies modernes, se fonde sur des rapports immédiats de domination et de servitude, généralement surl'esclavage.
Sa forme capitaliste présuppose au contraire le travailleur libre, vendeur de sa force.
Dans l'histoire, ellese développe en opposition avec la petite culture des paysans et l'exercice indépendant des métiers, que ceux-cipossèdent ou non la forme corporative.
En face d'eux la coopération capitaliste n'apparaît point comme une formeparticulière de la coopération; mais au contraire la coopération elle-même comme la forme particulière de laproduction capitaliste.
Si la puissance collective du travail, développée par la coopération, apparaît comme forceproductive du capital, la coopération apparaît comme mode spécifique de la production capitaliste.
C'est là lapremière phase de transformation que parcourt le procès de travail par suite de sa subordination au capital.
Cettetransformation se développe spontanément.
Sa base, l'emploi simultané d'un certain nombre de salariés dans lemême atelier, est donnée avec l'existence même du capital, et se trouve là comme résultat historique des.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- le lecteur a-t-il besoin de s’identifier aux personnages principaux et de partager ses sentiments pour apprécier un roman ?
- Les pirates se partagent le trésor : 1 256 pièces d'or à partager entre 5 pirates.
- Partager la même opinion sur un sujet, est-ce le signe certain que l'on est dans le vrai ? S'il est nécessaire de s'entendre pour établir la vérité, cette entente aboutit-elle infailliblement à la vérité ?
- Echanger est-ce pacifier ?
- --Vas-y, sers-toi, proposa Harry, ravi de pouvoir partager quelque chose avec quelqu'un pour la première fois de sa vie.