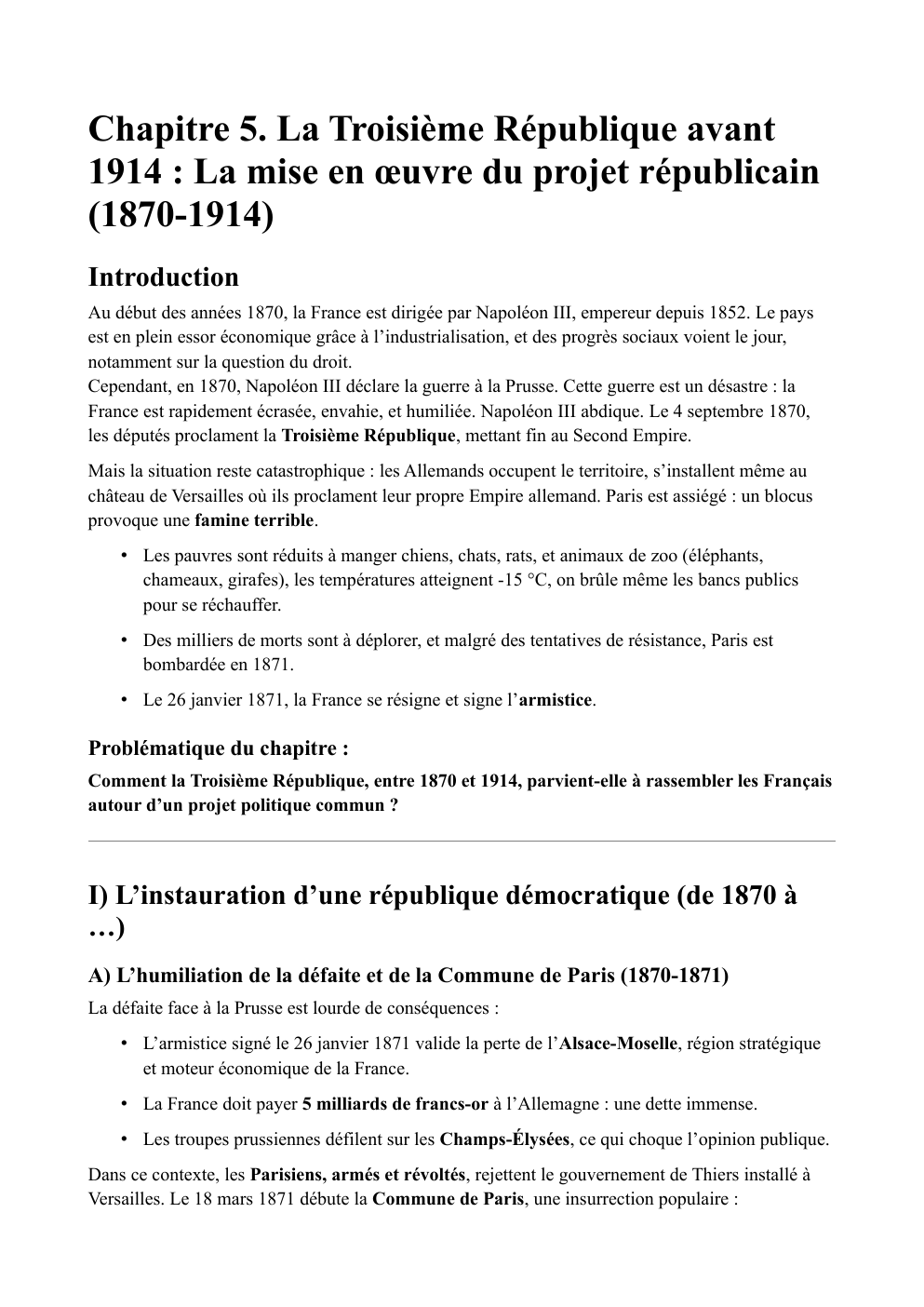Chapitre 5. La Troisième République avant 1914 : La mise en œuvre du projet républicain (1870-1914)
Publié le 31/05/2025
Extrait du document
«
Chapitre 5.
La Troisième République avant
1914 : La mise en œuvre du projet républicain
(1870-1914)
Introduction
Au début des années 1870, la France est dirigée par Napoléon III, empereur depuis 1852.
Le pays
est en plein essor économique grâce à l’industrialisation, et des progrès sociaux voient le jour,
notamment sur la question du droit.
Cependant, en 1870, Napoléon III déclare la guerre à la Prusse.
Cette guerre est un désastre : la
France est rapidement écrasée, envahie, et humiliée.
Napoléon III abdique.
Le 4 septembre 1870,
les députés proclament la Troisième République, mettant fin au Second Empire.
Mais la situation reste catastrophique : les Allemands occupent le territoire, s’installent même au
château de Versailles où ils proclament leur propre Empire allemand.
Paris est assiégé : un blocus
provoque une famine terrible.
• Les pauvres sont réduits à manger chiens, chats, rats, et animaux de zoo (éléphants,
chameaux, girafes), les températures atteignent -15 °C, on brûle même les bancs publics
pour se réchauffer.
• Des milliers de morts sont à déplorer, et malgré des tentatives de résistance, Paris est
bombardée en 1871.
• Le 26 janvier 1871, la France se résigne et signe l’armistice.
Problématique du chapitre :
Comment la Troisième République, entre 1870 et 1914, parvient-elle à rassembler les Français
autour d’un projet politique commun ?
I) L’instauration d’une république démocratique (de 1870 à
…)
A) L’humiliation de la défaite et de la Commune de Paris (1870-1871)
La défaite face à la Prusse est lourde de conséquences :
• L’armistice signé le 26 janvier 1871 valide la perte de l’Alsace-Moselle, région stratégique
et moteur économique de la France.
• La France doit payer 5 milliards de francs-or à l’Allemagne : une dette immense.
• Les troupes prussiennes défilent sur les Champs-Élysées, ce qui choque l’opinion publique.
Dans ce contexte, les Parisiens, armés et révoltés, rejettent le gouvernement de Thiers installé à
Versailles.
Le 18 mars 1871 débute la Commune de Paris, une insurrection populaire :
• Des barricades sont dressées.
L’armée française, envoyée par le gouvernement, entre en
guerre contre les Communards.
• Les Communards brandissent le drapeau rouge et défendent des idées socialistes et
révolutionnaires.
• C’est une guerre civile.
Le gouvernement écrase la Commune au cours de la « Semaine
sanglante ».
• La répression est féroce : fusillades, emprisonnements, déportations (notamment en
Nouvelle-Calédonie).
Cette période marque un traumatisme pour la République naissante, encore très fragile.
II) La Troisième République surmonte les oppositions
nombreuses (1890-1914)
A) Les crises de la IIIe République : un exemple avec l’affaire Dreyfus
Quels sont les faits à l’origine du scandale ?
• Septembre 1894 : L’armée découvre qu’un espion transmet des secrets militaires à
l’Allemagne.
• Octobre 1894 : Le capitaine Alfred Dreyfus, officier juif, est arrêté car son écriture
ressemble à celle du bordereau de l’espion.
• Décembre 1894 : Il est condamné sans preuves solides, sur la base d’un dossier secret,
non communiqué à la défense.
• Janvier 1895 : Dreyfus est dégradé publiquement et envoyé au bagne en Guyane.
L’affaire semble close, sauf pour sa famille et le colonel Picquart, qui découvre que le
véritable espion serait le commandant Esterhazy.
Quand éclate le scandale et en quoi consiste-t-il ?
• Le scandale éclate en janvier 1898, avec l’article « J’accuse ! » publié par Émile Zola dans
le journal L’Aurore.
• Zola y accuse l’armée et l’État de couvrir une injustice.
Il réclame la révision du procès.
• Il est condamné pour diffamation, mais relance le débat national.
Quels sont les arguments des anti-dreyfusards ?
• L’armée refuse de reconnaître son erreur.
• Dreyfus est considéré coupable parce qu’il est juif, seul juif de l’état-major.
• Soutiens des milieux nationalistes, de la droite, et d’une grande partie de l’Église
catholique.
Quels sont les arguments des dreyfusards ?
• Ils dénoncent une atteinte au droit fondamental à la défense, à la justice et à la liberté.
• Ils se réfèrent à la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, notamment l’article
7 : « Nul homme ne peut être arrêté ou détenu que dans les cas prévus par la loi ».
Quels sont les effets de cette affaire ?
• L’affaire divise profondément la France : dans les familles, les débats deviennent violents
(ex.
scène du dîner p.
177).
• Elle révèle un antisémitisme fort dans la société.
• En 1899, Dreyfus est gracié, puis réhabilité officiellement en 1906.
• C’est aussi une victoire des républicains de gauche sur les forces conservatrices :
réaffirmation des valeurs de justice, liberté, égalité, au cœur du projet républicain.
B) Comment la IIIe République construit-elle un empire colonial ?
1) Des Français qui participent comme les Européens à la course aux colonies
Depuis le XVe siècle, les Européens colonisent le monde.
La France commence avec la conquête de
l’Algérie en 1830, puis :
• Sénégal, Côte d’Ivoire, Gabon, Madagascar, Nouvelle-Calédonie (1853), Cochinchine,
Cambodge…
Pourquoi coloniser ?
• Économique : chercher des matières premières, main d’œuvre, débouchés pour les
produits de l’industrie française.
• Matériel et technologique : les Européens disposent d’armes modernes, moyens de
transport, télégraphes, etc.
• Démographique : la population européenne explose avec la transition démographique.
• Idéologique : sentiment de supériorité raciale, volonté de « civiliser » les peuples (langue,
religion, mode de vie européens).
• Géopolitique : compétition entre puissances européennes (ex.
crise de Fachoda).
2) Comment dominer un empire colonial ?
Exploitation économique des colonies :
• On importe principalement des matières premières agricoles : riz, cacao, thé, café, hévéa,
oranges, phosphates…
• On exporte des produits transformés en métropole, vendus plus chers : les colonies sont
un marché captif.
Installation d’une minorité de Français dans les colonies :
• Ils exploitent les richesses (commerce, agriculture), occupent des postes d’administrateurs,
enseignants.
• Construction d’infrastructures selon le modèle métropolitain : routes, écoles, hôpitaux,
chemins de fer.
• Diffusion de la culture française (langue,....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Correction d'une question problématisée : Comment la crise de 1929 se transforme-t-elle en dépression aux États-Unis et y entraîne-t-elle la mise en œuvre de solutions inédites ?
- Chapitre 11. Axe 1. Comment définir et mesurer la mobilité sociale ?
- Synthèse – Fiche d’identité de l’œuvre – Les Cahiers de Douai – Arthur Rimbaud
- Les Impatientes, Djaili Amadou Amal Œuvre présenté
- chapitre génétique