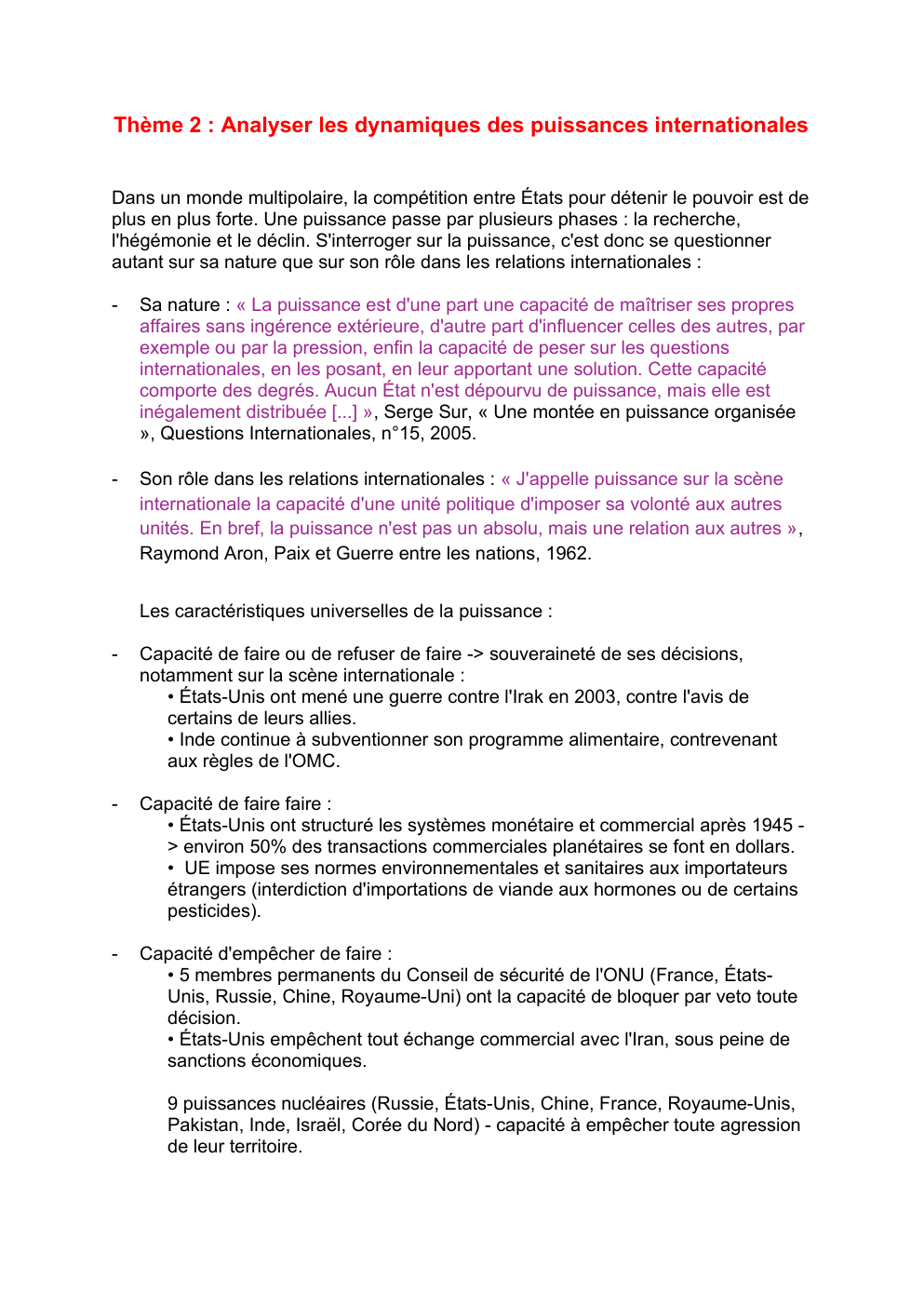fiche hggsp, "les puissances"
Publié le 14/05/2025
Extrait du document
«
Thème 2 : Analyser les dynamiques des puissances internationales
Dans un monde multipolaire, la compétition entre États pour détenir le pouvoir est de
plus en plus forte.
Une puissance passe par plusieurs phases : la recherche,
l'hégémonie et le déclin.
S'interroger sur la puissance, c'est donc se questionner
autant sur sa nature que sur son rôle dans les relations internationales :
-
Sa nature : « La puissance est d'une part une capacité de maîtriser ses propres
affaires sans ingérence extérieure, d'autre part d'influencer celles des autres, par
exemple ou par la pression, enfin la capacité de peser sur les questions
internationales, en les posant, en leur apportant une solution.
Cette capacité
comporte des degrés.
Aucun État n'est dépourvu de puissance, mais elle est
inégalement distribuée [...] », Serge Sur, « Une montée en puissance organisée
», Questions Internationales, n°15, 2005.
-
Son rôle dans les relations internationales : « J'appelle puissance sur la scène
internationale la capacité d'une unité politique d'imposer sa volonté aux autres
unités.
En bref, la puissance n'est pas un absolu, mais une relation aux autres »,
Raymond Aron, Paix et Guerre entre les nations, 1962.
Les caractéristiques universelles de la puissance :
-
Capacité de faire ou de refuser de faire -> souveraineté de ses décisions,
notamment sur la scène internationale :
• États-Unis ont mené une guerre contre l'Irak en 2003, contre l'avis de
certains de leurs allies.
• Inde continue à subventionner son programme alimentaire, contrevenant
aux règles de l'OMC.
-
Capacité de faire faire :
• États-Unis ont structuré les systèmes monétaire et commercial après 1945 > environ 50% des transactions commerciales planétaires se font en dollars.
• UE impose ses normes environnementales et sanitaires aux importateurs
étrangers (interdiction d'importations de viande aux hormones ou de certains
pesticides).
-
Capacité d'empêcher de faire :
• 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU (France, ÉtatsUnis, Russie, Chine, Royaume-Uni) ont la capacité de bloquer par veto toute
décision.
• États-Unis empêchent tout échange commercial avec l'Iran, sous peine de
sanctions économiques.
9 puissances nucléaires (Russie, États-Unis, Chine, France, Royaume-Unis,
Pakistan, Inde, Israël, Corée du Nord) - capacité à empêcher toute agression
de leur territoire.
-
Les fondements de la puissance en évolution :
- Composantes permanentes de la puissance (démographie, superficie du
territoire) -> à relativiser :
• Population nombreuse est un atout si elle constitue une main-d'œuvre et un
marché intérieur au service du développement économique, comme en Chine.
• Territoire étendu n'est un facteur de puissance que s'il est maîtrisé et ses
ressources valorisées (Russie a un immense territoire riche en ressources mais
peine à le contrôler).
Hard power :
• Puissance militaire -> capacité de projection des armées : États-Unis.
Le
Royaume-Uni, la France, Chine, disposent de porte-avions et de bases à l'étranger.
• Puissance économique -› capacité à investir dans les économies concurrentes par
le biais des FTN, des IDE ou des fonds souverains (Qatar avec le PSG).
Soft power joue un rôle croissant :
• American Way of life après 1945 -> fait la promotion du mode de vie étasunien par
le cinéma, la télévision.
• Cool Japan pour le Japon (mangas, films d'animation, jeux, robotique etc.).
• Bollywood pour l'Inde (1er en nombre de films produits).
• « Diplomatie du panda » de la Chine -> véhicule une image pacifiste en prêtant ses
pandas à des pays amis.
Les manifestations contrastées de la puissance :
- Puissances établies structurent l'environnement politique et économique à
l'échelle mondiale.
• Rassemblées dans le G7 (G8 avant l'annexion de la Crimée et l'exclusion de
la Russie en 2014) -> 43% du PIB mondial.
• États-Unis incarne seuls la « superpuissance » par leurs capacités sans
équivalent (diplomate français Hubert Védrine en1991).
- Puissances ascendantes cherchent à contrebalancer l'influence des puissances
établies -> BRIC, BRICS, BRICS+
• Depuis la fin XXème s.
-› affirment leur volonté de peser sur la scène
internationale mais influence inégale.
• Seule la Chine est devenue une puissance mondiale.
• L'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud rayonnent surtout à l'échelle régionale.
• S'allient dans le cadre du G20 à des États comme l'Arabie Saoudite, le
Mexique ou l'Indonésie
• 2015 : fondation de la Nouvelle banque de développement par les BRICS ->
concurrence les organisations internationales jugées dominées par les puissances
établies (FMI, Banque mondiale).
-
Coopération est une solution pour réguler le pouvoir des puissances :
• Multilatéralisme contribue à recomposer la puissance et ses enjeux en créant
des institutions régulatrices (UE, ASEAN, Union africaine).
• ONU reste la seule instance internationale de discussion et de négociation
entre les puissances.
Chapitre 1 : Essor et déclin des puissances, un regard historique
Les interrogations sur le phénomène de construction et disparition des grandes
puissances est ancien et se poursuit aujourd'hui.
-
Antiquité : développement de l'Empire romain au cœur des récits «'historiens
antiques (Polybe, Il -ème av.
J.-C.
; Tite-Live, ler av.
J.-C.).
-
Renaissance :
• Nicolas Machiavel (XVème-XVlème s.) s'inspire dans les discours sur la
première décade de Tite-Live de l'exemple romain pour construire sa réflexion
politique sur la construction de la puissance.
• Francis Bacon (XVlème-XVIlème s.) s'intéresse l'effondrement des empires et
intègre ces successions d'empires et de civilisations dans une théorie des périodes
de l'histoire.
Quelles conclusions ?
- Construction par les conquêtes -> grandes puissances = vastes empires (Rome,
Empire mongol, Chine, Empire ottoman etc.).
- Construction par l'influence -> « âge d'or » de Venise XIllème-XVième s.) repose
sur un immense réseau commercial.
I - L'Empire ottoman, une grande puissance à l'époque moderne.
L'Empire ottoman se distingue par :
- Sa longévité (1299-1922).
- Sa taille (trois continents) -> Asie, en Afrique et Europe.
- Expansion rapide (XIV-XVilème s.) -> s'appuie notamment sur le corps d'élite de
l'armée, les janissaires.
Prise de Constantinople en 1453 -> prend la place de l'Empire gréco-romain.
• Apogée sous Soliman le Magnifique (1520-1566).
- Sa stabilité politique:
• Une dynastie unique -> famille Osmanoglu.
- Une religion -› réunifie la communauté autour de l'islam.
• Autorité de consensus du sultan :
- Conserve les traditions des pays conquis et s'appuie sur leurs élites
- Chrétiens et juifs tolérés sous le statut de dhimmis.
Le déclin de l'Empire ottoman est un long processus qui s'étend sur un peu plus de
trois siècles : XVIIème - XVIllème s.
:
- Série de défaite qui se traduit par de vastes pertes territoriales.
- Échec du siège de Vienne (1683).
• Engrenage de l'échec : finances s'assèchent, logistique de l'armée décroche,
autorité du sultan se fragilise, les revendications autonomistes se multiplient, les
janissaires se révoltent.
-
XIXème s.
: Empire ottoman devient la cible des conquêtes coloniales
européennes.
• État ottoman s'inspire des Européens pour se réformer (Tanzimat occidentalisation de la société).
• Améliore son fonctionnement mais accroit sa dépendance à l'égard de
l'Europe.
-
XXème s.
: difficultés internes
• Émergence d'une forme de nationalisme turc, qui met en avant l'identité
turque face à la conception universelle de l'Empire ottoman.
• Effondrement après l'échec de 1918 (génocide arménien, défaite militaire,
démantèlement de l'empire) - République de Mustapha Kemal achève l'agonie de
l'Empire ottoman en 1923.
II - La Russie après 1991, la reconstitution d'une grande puissance.
Durant toute la seconde moitié du XXème s., l'URSS est l'une des deux
superpuissances (avec....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Synthèse – Fiche d’identité de l’œuvre – Les Cahiers de Douai – Arthur Rimbaud
- Fiche de lecture - Les Globalisations, P.N Giraud
- FICHE BAC : DESIR-BONHEUR
- fiche de lecture manon lescaut 20/20
- Fiche - La sexualité en France dans la deuxième moitié du XXe siècle