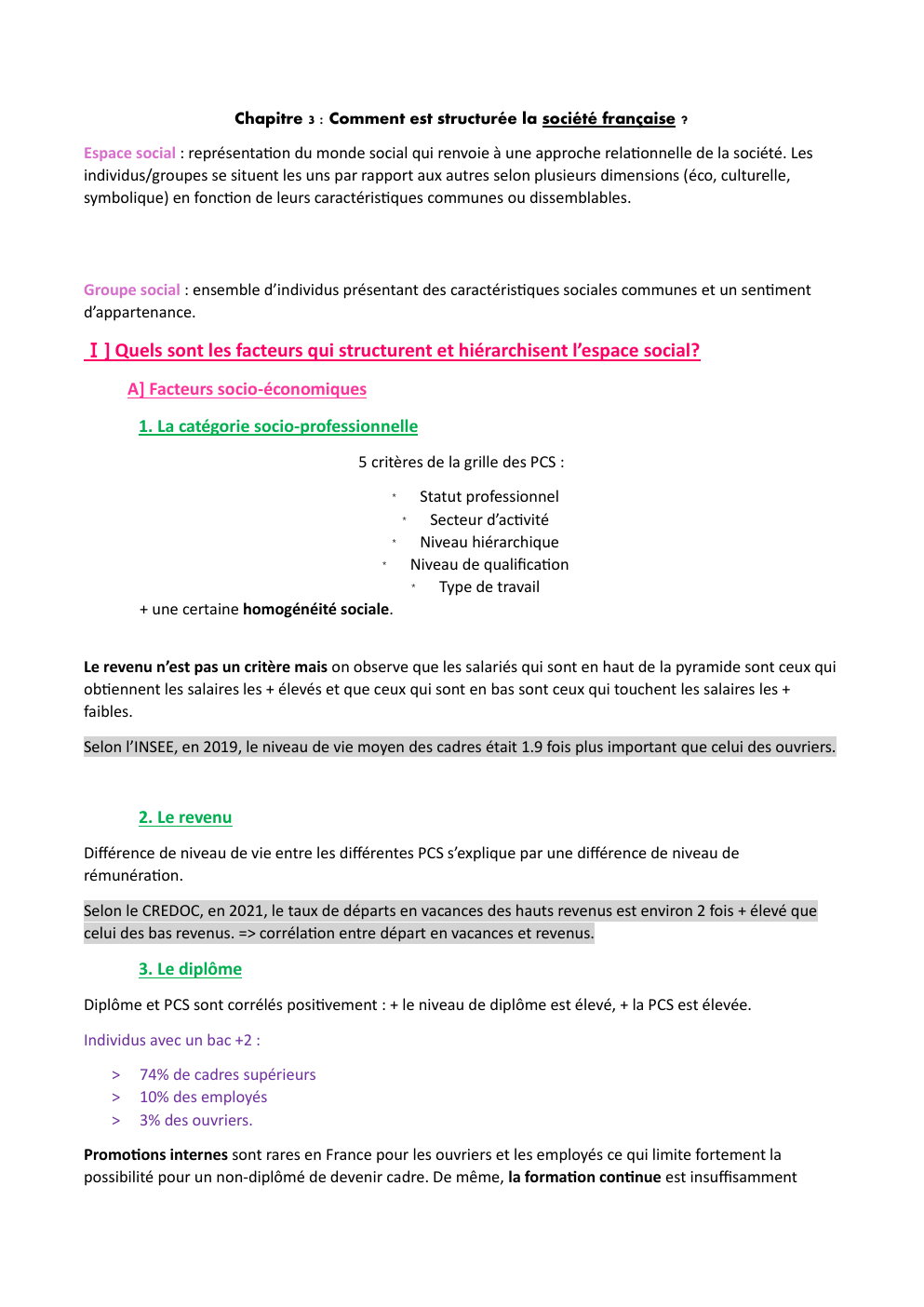La structure sociale (Terminale SES)
Publié le 20/05/2025
Extrait du document
«
Chapitre 3 : Comment est structurée la société française ?
Espace social : représentation du monde social qui renvoie à une approche relationnelle de la société.
Les
individus/groupes se situent les uns par rapport aux autres selon plusieurs dimensions (éco, culturelle,
symbolique) en fonction de leurs caractéristiques communes ou dissemblables.
Individualisation : processus par lequel l’individu s’autonomise dans ses façons de penser et de se
comporter, des prescriptions de ses groupes d’appartenance.
Groupe social : ensemble d’individus présentant des caractéristiques sociales communes et un sentiment
d’appartenance.
Ⅰ] Quels sont les facteurs qui structurent et hiérarchisent l’espace social?
A] Facteurs socio-économiques
1.
La catégorie socio-professionnelle
5 critères de la grille des PCS :
*
Statut professionnel
* Secteur d’activité
* Niveau hiérarchique
* Niveau de qualification
* Type de travail
+ une certaine homogénéité sociale.
Le revenu n’est pas un critère mais on observe que les salariés qui sont en haut de la pyramide sont ceux qui
obtiennent les salaires les + élevés et que ceux qui sont en bas sont ceux qui touchent les salaires les +
faibles.
Selon l’INSEE, en 2019, le niveau de vie moyen des cadres était 1.9 fois plus important que celui des ouvriers.
2.
Le revenu
Différence de niveau de vie entre les différentes PCS s’explique par une différence de niveau de
rémunération.
Selon le CREDOC, en 2021, le taux de départs en vacances des hauts revenus est environ 2 fois + élevé que
celui des bas revenus.
=> corrélation entre départ en vacances et revenus.
3.
Le diplôme
Diplôme et PCS sont corrélés positivement : + le niveau de diplôme est élevé, + la PCS est élevée.
Individus avec un bac +2 :
>
>
>
74% de cadres supérieurs
10% des employés
3% des ouvriers.
Promotions internes sont rares en France pour les ouvriers et les employés ce qui limite fortement la
possibilité pour un non-diplômé de devenir cadre.
De même, la formation continue est insuffisamment
développée en France et + facilement accessible aux cadres déjà diplômes ce qui empêche les ouvriers
d’acquérir des diplômes une fois leur formation initiale terminée.
La catégorie socioprofessionnelle, le revenu et les diplômes structurent et hiérarchisent l’espace social et
sont souvent liés entre eux : par exemple, un cadre possède en moyenne un revenu et un niveau de
diplôme + élevé qu’un ouvrier.
B] Les autres facteurs
1.
Le sexe
Le sexe est un facteur de hiérarchie au sein de la société française car il conduit à catégoriser la population en
2 groupes et qui vont occuper des positions sociales inégales et inégalement valorisées, les femmes se
retrouvant en bas de l’échelle ainsi créée.
Les inégalités touchent : la culture, le travail, la vie familiale, la
politique, le sport et la violence et sont systématiquement en défaveur des femmes.
Exemples :
>Elles sont rémunérées à conditions équivalentes, près de 10% de moins que les hommes.
>Elles font 72% des tâches ménagères au sein de leur foyer et y consacrent 78 minutes de + que les hommes
chaque jour.
>Concernant la politique, seulement 13% des maires sont des femmes.
2.
Le cycle de vie
↳ renvoie à des étapes qui couvrent une période temporelle vaste et qui sont définies socialement.
Ascension sociale de l’enfance à l’âge adulte puis un déclin à mesure que l’on vieillit = certaines positions de
la vie sont socialement + valorisées que d’autres.
Accès inégal à l’emploi lié à l’âge.
Manque d’expérience + chômage de masse des plus jeunes actifs = plus grande précarité lors de l’entrée dans
la vie adulte.
Grande précarité pas compensée par politiques publiques davantage centrées sur la fin du cycle
de vie (retraites).
3.
La composition des ménages
Est un critère de hiérar° & struct° de l’espace social car elle va entraîner des conséquences sur le niveau de
vie du ménage et créer des écarts de niveau de vie.
Ex : le niveau de vie médiant d’un couple sans enfant est 1.7 fois plus élevé que celui d’une famille
monoparentale.
4.
Le lieu de résidence
Les groupes sociaux ne se répartissent pas au hasard dans l’espace : les groupes les + favorisés vont se
concentrer dans les espaces urbains les + favorisés i.e.
des espaces mieux dotés en ressources publiques et
privées => centre-ville (espaces vertes, sport, desservis + + en transports, établissements scolaires de
qualité).
Concentration grp sociaux favorisés dans un quartier => en écarter grp défavorisés => rendre ce quartier
plus attractif ==> ENTRE SOI
⇝ Cela hiérarchise l’espace urbain et creusent les inégalités entre les individus.
En fonction du lieu de
résidence, les individus sont inégalement protégés contre les effets du RC.
Le lieu de résidence devient un
facteur de ségrégation sociale car différents milieux sociaux n’habitent pas les mêmes quartiers et n’ont donc
pas accès aux mm services, cadre de vie et opportunités.
Ces facteurs sont en relation les uns avec les autres et interagissent mais ne se superposent pas.
Les
différences liées à ces 7 facteurs se traduisent par des proximités entre certains individus dans les modes de
vie, le rapport au monde, les contraintes matérielles… Ces différences constituent aussi des inégalités et
contribuent à une hiérarchisation des individus et des groupes, certains étant + dotés, + puissants, +
reconnus que d’autres.
Ⅱ] Quelles sont les principales évolutions de la structure socioprofessionnelle en France
depuis la seconde moitié du 20e siècle?
Structure socioprofessionnelle : répartition des activités professionnelles et des actifs au sein de la société.
A] La salarisation de l’emploi
Salarisation de l’emploi : augmentation de la part des salariés dans la population active.
S’explique par un déclin des petites entreprises agricoles (secteur le + touché), artisanales ou de commerces
au profit d’un mouvement de concentration des entreprises.
Les artisans et commerçants ont subi la
concurrence des grandes entreprises/surfaces qui bénéficient d’économies d’échelles et peuvent vendre
moins cher que les petits indépendants.
Le salariat est devenu au 20e siècle le socle de la protection sociale des actifs : le travailleur tire des droits de
son travail (+ de protection en matière de licenciement, contractualisa° des relations de travail) mais est
subordonné en contrepartie.
Ex : En 1954 on comptait 27% d’indépendants et ils n’étaient plus que 9% en 2022.
En 1954 on comptait 73%
de salariés contre 91% en 2022.
B] La tertiarisation
Tertiarisation : augmentation de la part du secteur tertiaire dans le PIB et dans l’emploi.
Depuis les années 80 : ⬀ créations d’emplois dans la santé, l’action sociale, culturelle et sportive, services
aux particuliers & entreprises, et dans le commerce (⬀conception & marketing).
Le déclin relatif de l’emploi dans le secteur primaire et secondaire, s’explique par des différentiels de gains
de productivité et d’accroissement de la demande selon les secteurs.
Ex : le secteur tertiaire occupait 46% de la pop° active en 1968 contre 80% en 2021.
C] L’élévation du niveau de qualification
Progrès technique + massification scolaire = part des emplois qualifiés et très qualifiés ⬈.
En // part des emplois manuels peu qualifiés a diminué.
Cependant, cette montée des emplois qualifiés a
aussi entrainé une augmentation des emplois de services peu qualifiés pour faire face la demande croissante
de services de ces travailleurs qualifiés mieux rémunérés (ont les moyens de payer un.e babysitter/personnel
de ménage)
Ex : La part des cadres et PIS passe de 5% en 1954 à 22% en 2022.
D] La féminisation des emplois
Les femmes ont toujours travaillé mais leur travail était invisibilisé (notamment agriculture et commerce).
En France, au début du 20e siècle, la féminisation de la pop° active était déjà importante comparativement
aux autres pays mais à partir des années 60, le mouvement s’amplifie.
L’expansion de l’activité féminine est corrélativement liée :
}
}
}
}
}
Dvpt des luttes féministes
Avancées juridiques => émancipation des femmes
Maitrise de la fécondité
Dvpt scolarisation des femmes
Emergence de nouveaux modèles familiaux
De même, la salarisation et la tertiarisation sont des conséquences de l’accroissement de l’activité
féminine mais c’est aussi parce que l’emploi est devenu + salarié et + tertiaire que les femmes y ont eu
accès.
Ex : Le taux d’activité des femmes finit par atteindre 68.2% en 2019 mais elles restent beaucoup + concernées
par le travail à temps partiel (8 femmes sur 10).
Ⅱ] Quelle est la pertinence de la notion de classe sociale ?
A] Les théories des classes et la stratification sociale dans la tradition sociologique.
1.
Les classes sociales chez Marx
Pour....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Chapitre 11. Axe 1. Comment définir et mesurer la mobilité sociale ?
- EC2 : Caractérisez la mobilité sociale des hommes par rapport à leur père.
- Stratification sociale: Chapitre 4 Comment est structurée la société française actuelle ?
- Chapitre de SES : la déviance sociale
- Un débat historique : Histoire versus Structure